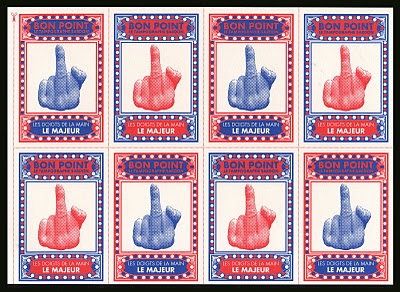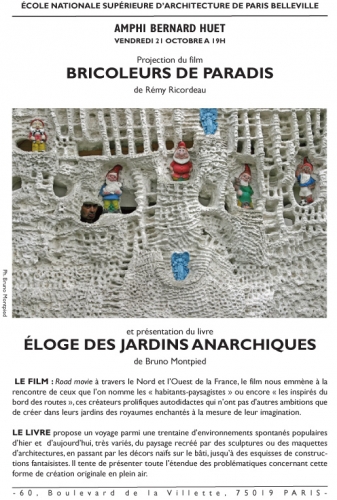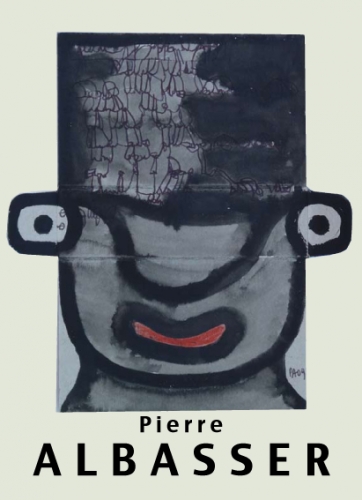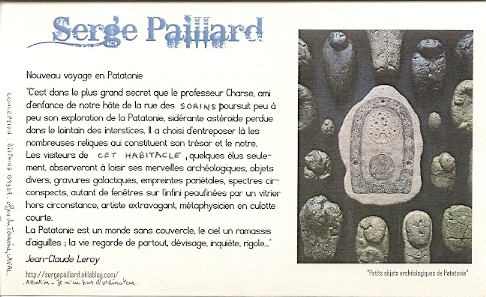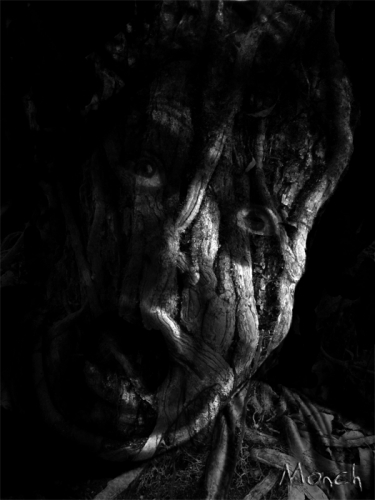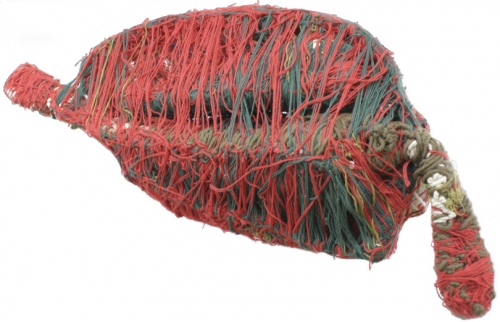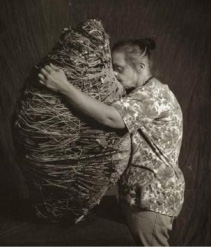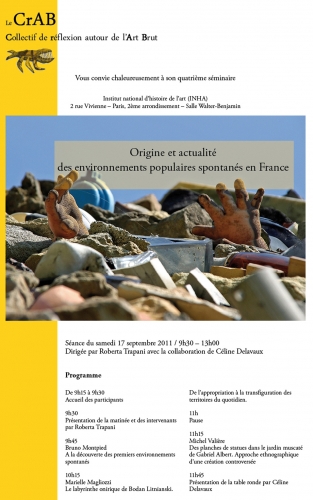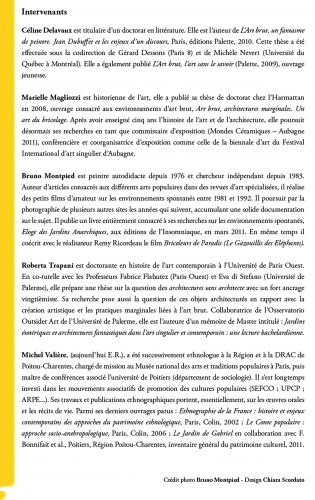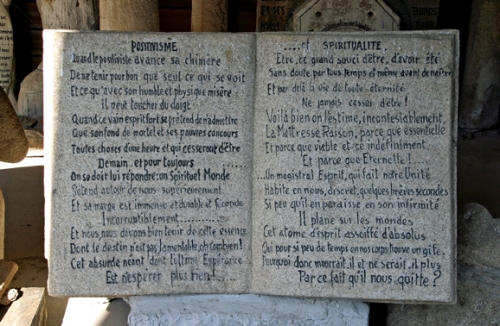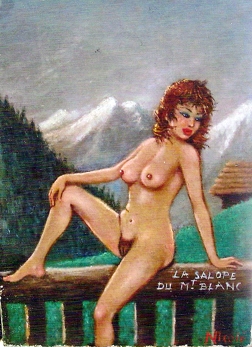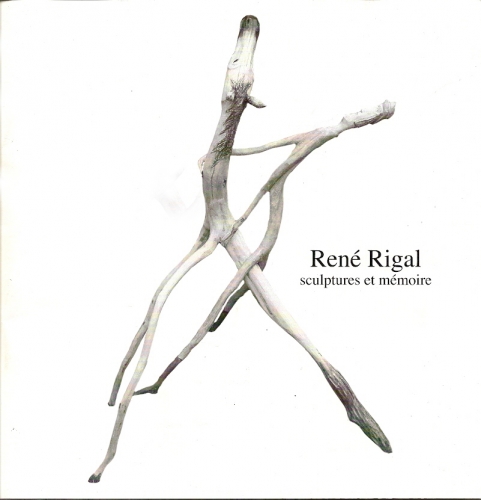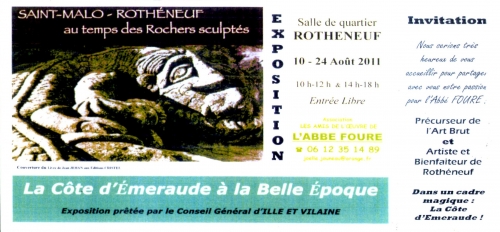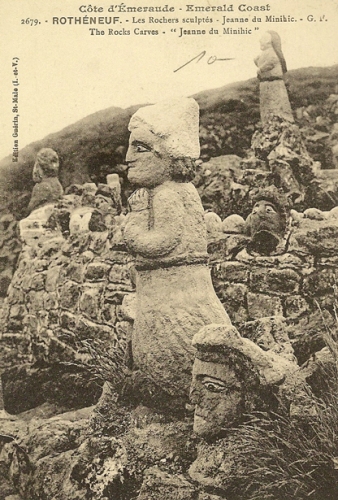17/02/2012
Nouveau jeu... qu'est-ce que c'est?
Il faut que je l'admette, le jeu des 7 différences n'a rien donné... Alors j'en lance un autre, plus dans le style Schmilblic...A gagner la même chose que dans le jeu précédent, puisque les livres sont toujours là à poireauter:
Soit le livre (en italien), abondamment illustré de Gustavo Giacosa, Noi, quessi dessa parola che sempre cammina, sur les inscriptions graffitées de Babylone, Giovanni Bosco, Helga Goetze, Oreste Nannetti, Melina Riccio et Carlo Torrighelli (2010)...
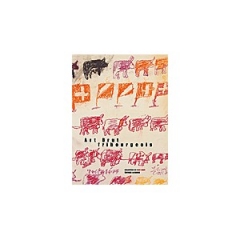
Soit cet autre ouvrage, Art brut fribourgeois, catalogue d'une exposition de la Collection de l'Art Brut en 2008...
Que faut-il trouver cette fois? Eh bien, que signifient les objets ci-dessous, à quoi servaient-ils? Le premier qui trouve la solution gagne un des deux livres.
Photo La Patience, 2012
23:43 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art involontaire, Art populaire insolite, Graffiti, Jeux, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : la patience, art populaire insolite, art brut, gustavo giacosa, art brut fribourgeois, art involontaire, schmilblic |  Imprimer
Imprimer
12/02/2012
"303" n°119
C'est bien énigmatique comme titre, n'est-ce pas?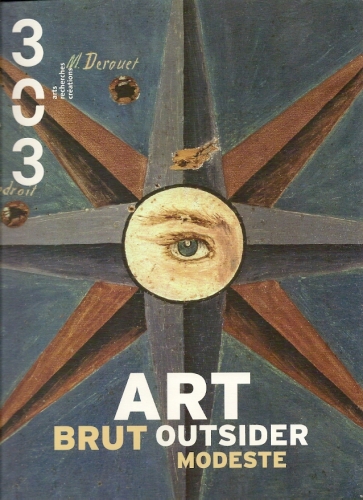
303, arts, recherches et créations est en réalité le titre complet de cette belle revue qui existe depuis au moins trente ans, financée par la région des Pays de la Loire, dans un premier temps consacrée en grande partie au patrimoine de cette région, puis depuis quelques années plus spécialement à la recherche en art. Le n°119, daté de janvier dernier, est un numéro spécial "art brut, outsider, modeste", concocté par Eva Prouteau qui collabore régulièrement à la revue.
Au sommaire, on n'a pas joué forcément la carte du foisonnement comme ce fut le cas lors du numéro spécial de la revue Area sur le même sujet l'année dernière. Les textes sont plus longs que dans ce dernier magazine qui privilégie les entretiens synthétiques plutôt que les textes de fond. Eva Prouteau a préféré placer l'éclairage sur certains points permettant de souligner l'éclectisme des productions classées avec plus ou moins de rigueur dans l'art soi-disant "brut", toutes relevant cependant d'une forme de poésie singulière. Derrière son entreprise de "décloisonnement" des catégories et des appellations –ce qui ne signifie pas pour elle confusion des genres et des catégories, mais plutôt besoin d'établir des passerelles dans le respect de la valeur des uns et des autres– on sent chez elle un goût marqué pour les petites collections secrètes, notamment d'art populaire insolite, comme celle du musée des traditions de la Guérinière à Noirmoutier, ou celle des cibles de tir du Cercle de Chemazé (sud de la Mayenne ; déjà évoquées par Pascale Mitonneau dans le n°78 de la même revue 303 en 2003 avec des illustrations différentes), passionnantes œuvres d'art forain destinées à être criblées de balles, goût également apparent lorsqu'elle évoque avec sagacité l'existence de la Folk Archive, ce collectage par la photographie de "formes esthétiques non valorisées" (graffiti, sculptures de sable, motos et voitures customisées, épouvantails... Que des sujets que sur ce blog nous prisons particulièrement comme nos lecteurs l'ont sûrement remarqué) établi par deux artistes anglais, Jeremy Deller et Allan Kane. Il est aussi question ici et là dans la revue de l'art des douilles d'obus ciselées par les Poilus (article de Laurent Tixador et Eva Prouteau), et aussi d'un environnement belge, celui de Jean-Pierre Schetz, à Jupille, prés de Liège (dont Brigitte Van Den Bossche, collaboratrice du MADmusée dans cette dernière ville, auteur de l'article dans 303 a contribué à sauver des vestiges à la Fabuloserie, comme je l'avais constaté en juillet dernier –voir également la note que j'avais consacrée à ce site sur ce blog ; les quelques sculptures conservées par Caroline Bourbonnais ont été installées sur une sorte de ponton)

Le cochon, 1963, contreplaqué, collection des cibles de l'Union de Chemazé, photo extraite du n°78 de la revue 303 (article de Pascale Mitonneau) en septembre 2003

Cible peinte, collection Jean Estaque, ph. Bruno Montpied, 2009 (collection donc distincte de la collection des cibles de Chemazé)
Fragments préservés de Jean-Pierre Schetz à la Fabuloserie dans le parc d'environnements, et au loin les statues de Camille Vidal, ph. BM, 2011 (ceci n'est pas dans le n° spécial de 303)
A propos d'environnements, j'ai participé à ce numéro avec deux textes, l'un sur les sites d'habitants-paysagistes dans les Pays de la Loire (Aux jardins des délices populaires, texte où sont évoqués Louis Licois, Marcel Baudouin, Camille Jamain, Emile Taugourdeau, André Pailloux, Michel Chauvé, Henri Travert, Bernard Roux, et les maisons de Rossetti et Pennier dans la périphérie du Mans), plus un autre sur Armand Goupil, ce peintre amateur étonnant, ancien instituteur, originaire de la Sarthe, dont j'ai déjà eu l'occasion de donner sur ce blog maints autres aperçus.

Armand Goupil, Barbe blanche, 11-X-61, huile sur carton, rassemblement Jean-Philippe Reverdy (image inédite, non publiée dans le numéro de 303)
Laurent Danchin publie une contribution à propos de la distinction à faire selon lui dans l'art des médiumniques entre les créateurs savants et les créateurs plus populaires. Oubliant peut-être de préciser que l'art brut n'a pas insisté sur cette distinction parce que ses thuriféraires cherchant à mettre en évidence l'existence d'un art intime, surgi des profondeurs de l'inconscient, n'avaient que faire d'opérer de telles distinctions (de même qu'entre art des fous et art des non-fous). En fait, l'intervention de Danchin participe d'une remise en cause de la validité conceptuelle de l'art brut, ce qui peut paraître surprenant de la part de quelqu'un qui fait désormais partie du comité consultatif de la collection d'Art Brut à Lausanne. Personnellement, dans l'art des médiumniques, à qui je trouve généralement de l'unité, (s'il fallait opérer des distinctions, ce serait plutôt au niveau formel, les architectures, les symétrisations d'Augustin Lesage, Fleury-Joseph Crépin, Victor Simon d'un côté, face aux sinuosités botaniques des spirites tchèques par exemple), dans l'art des médiumniques donc, je trouve un raffinement qui n'est lui pas plus le fait des autodidactes populaires que des savants en rupture de ban (comme Victorien Sardou ou Marguerite Burnat-Provins), provenant en fait plutôt du recours à l'automatisme graphique, ce qui avait fasciné André Breton en 1933 (dans Le Message automatique), mais n'avait pas empêché un peintre comme André Masson de pratiquer le dit automatisme dans son dessin et sa peinture dès les années 20.

Cecilie Markova, sans titre, daté 22-5-1960, coll. BM (illustration non insérée dans le numéro de 303)
Ce numéro se focalise sur certains autres points, les écrits de Chaissac, l'art d'Hélène Reimann, le point de vue de Savine Faupin sur la réouverture du LaM avec son extension vouée à l'art brut, et surtout avec son opinion sur l'art brut aujourd'hui, cohérente avec la position d'une conservatrice de musée. Ce qu'elle dit de la façon dont André Breton envisageait l'art brut, et de son clivage avec Dubuffet me paraît discutable mais ce serait trop long d'en parler ici.

Hélène Reimann, sans titre, avant 1987, donation L'Aracine, LaM de Villeneuve-d'Ascq ; reproduit dans 303
La coordonnatrice de ce numéro a également donné l'occasion à Jean-Louis Lanoux alias Animula Vagula (le pseudo a été révélé publiquement sur internet) de se lancer dans un grand numéro impérialiste de "mère des blogs" qu'il espère sans doute, comme à son habitude, masquer sous l'humour (jamais exempt de coups de pied de l'âne). Le chapeau de cette intervention intitulée "les Dérives d'Animula Vagula" définit comment, avec sa femme Catherine Edelman, il a orienté leur projet de blog fin 2005, en élaborant une autofiction campant une "jeune blogueuse affairée" imaginaire, "qui adore jouer avec les codes identitaires de la blogosphère"... [Ce chapeau, rédigé par l'éditeur du dossier sans que cela soit indiqué par un artifice typographique distinctif – voir commentaire de J2L ci-après – reflète assez bien le concept du blog animulesque selon moi, à tel point qu'y sentant à ce point l'influence des auteurs de ce blog, je suis fondé à considérer ce chapeau comme étant écrit par eux...]. Lanoux cherchant ainsi comme souvent à paraître rester "djeune", non déconnecté de la réalité, toujours "in", comme on disait autrefois. Cette explication permet aussi, bénéfice secondaire, de noyer le fait que ce genre de "cybercarnet" n'est en réalité qu'un support d'expression nouveau pour des intellectuels marginaux qui faisaient auparavant, par exemple, des fanzines tapés à la machine, et qui, désolé Jean-Louis, pour le coup, l'avaient du reste cette fois précédé, en particulier dans l'intérêt pour les formes d'art populaire les plus hétéroclites ("Animula" ne cesse de le répéter, elle se veut la prem's, belle imposture). "Mère des blogs", tu parles! Sa dérive dérape vite dans le gonflage de chevilles (comme il s'en aperçoit d'ailleurs, car il est lucide le bougre, trop peut-être), et dans un narcissisme échevelé dont le lecteur n'a que faire. Laissons-le se caresser avec ces qualifications de "référence dans le monde de l'art brut" et passons à autre chose.
On regrettera dans ce numéro spécial, au chapitre des absents, qu'on n'ait pas plutôt interrogé ou demandé des contributions à la Collection ABCD qui s'interroge sur l'art brut aujourd'hui, ou bien qu'on ne se soit pas intéressé à l'évolution, en direction de l'art singulier, du musée d'art naïf de Laval, musée de la région des pays de la Loire pourtant. Etait-ce par manque de place? Le numéro en l'état actuel suscitera déjà, rien que dans les régions ouest, de bien fécondes questions sur les nouvelles façons d'envisager et de pratiquer l'art aujourd'hui.
A signaler le samedi 21 avril, au Lieu Unique à Nantes, la présentation de la revue, dans le cadre d'un "week-end singulier" organisé par Patrick Gyger (auteur également dans la revue d'un article sur Daniel Johnston), où sera également projeté le film Bricoleurs de Paradis, Le Gazouillis des éléphants de Remy Ricordeau, avec un débat pour suivre, animé par Eva Prouteau. Durant la période du 7 mars au 20 mai, se tiendra au Lieu unique une expo consacrée à Daniel Johnston, Welcome to my world! D'autres intervenants sont également annoncés durant ce week-end comme Bruno Decharme, Barbara Safarova, Mario Del Curto, etc. Voir le site web du Lieu unique.
12:47 Publié dans Art Brut, Art forain, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Marine populaire et singulière | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : 303, eva prouteau, cibles de chemazé, art brut, art immédiat, art singulier, bruno montpied, laurent danchin, armand goupil, animula vagula, jean-louis lanoux, cecilie markova, art médiumnique, brigitte van den bossche, environnements spontanés, lam de villeneuve-d'ascq, hélène reimann, lieu unique |  Imprimer
Imprimer
11/02/2012
Art de rue

Montmartre, sept 2011, ph. Bruno Montpied
23:48 Publié dans Art immédiat, Art populaire contemporain, Paris populaire ou insolite, Photographie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art de rue, street art |  Imprimer
Imprimer
15/01/2012
Info-Miettes (14)
Pascal Tassini au Madmusée de Liège
Pascal Tassini quand on voit ça, le truc emberlificoté ci-dessous, on se dit, ah, on tient une Judith Scott made in Europe. Car, objet textile non identifié (OTNI qui mal y pense bien sûr), le parallèle paraît s'imposer, du moins si l'on s'en tient à cette boule bleue effilochée. Or, ce créateur ne s'en tient pas là. il semble que son œuvre majeure soit plutôt une sorte de construction, une "cabane", toujours textile, qualifiée par les rédacteurs du dossier de presse de l'expo de "phénoménale installation à l'aspect organique et tentaculaire", installation qui se développe dans les locaux du Créahm, également installé à Liège (le Madmusée, "émanation" du Créahm, est quant à lui hébergé provisoirement au musée du Grand Curtius en attendant un espace plus adapté à ses collections présentées comme importantes –je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier, cependant l'expo montée il y a peu à Paris à la Maison des Métallos invitait à le penser). Pascal Tassini réalise aussi des coiffes et des tenues de noces plutôt inventives. Une expo se tient actuellement pour en apprendre davantage.
objet textile non identifié (OTNI qui mal y pense bien sûr), le parallèle paraît s'imposer, du moins si l'on s'en tient à cette boule bleue effilochée. Or, ce créateur ne s'en tient pas là. il semble que son œuvre majeure soit plutôt une sorte de construction, une "cabane", toujours textile, qualifiée par les rédacteurs du dossier de presse de l'expo de "phénoménale installation à l'aspect organique et tentaculaire", installation qui se développe dans les locaux du Créahm, également installé à Liège (le Madmusée, "émanation" du Créahm, est quant à lui hébergé provisoirement au musée du Grand Curtius en attendant un espace plus adapté à ses collections présentées comme importantes –je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier, cependant l'expo montée il y a peu à Paris à la Maison des Métallos invitait à le penser). Pascal Tassini réalise aussi des coiffes et des tenues de noces plutôt inventives. Une expo se tient actuellement pour en apprendre davantage.
Expo Pascal Tassini au Madmusée jusqu'au 25 février, un catalogue monographique étant édité à cette occasion. Egalement l'exposition parallèle "Indifférence", qui concerne la collection du Madmusée présentée au Grand Curtius, et qui durera jusqu'au 6 mai.

La cabane de Pascal Tassini
Gérard Sendrey à Langon (Aquitaine)
De son côté Gérard ne chôme pas. Après une expo à Bayonne (que j'ai annoncée il n'y a pas si longtemps) le voici qui remonte près de son cher Bordeaux qu'il n'aimerait guère quitter à ce que sussure la rumeur.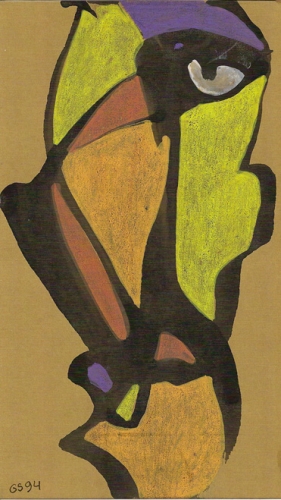 Cela se passe à Langon, dont monsieur le maire s'appelle Vérité. Un politicien appelé à ne jamais mentir, ça ne doit pas être facile tous les jours.
Cela se passe à Langon, dont monsieur le maire s'appelle Vérité. Un politicien appelé à ne jamais mentir, ça ne doit pas être facile tous les jours.
Expo du 12 janvier au 25 février, Salle George Sand au Centre Culturel des Carmes, 8, place des Carmes, 05 56 63 14 45. (Ci-contre "Profil" de 1994 par Gérard Sendrey)
André Robillard à Lyon, toujours par monts et par vaux
On m'annonce une nouvelle exposition d'André Robillard avec des fusils et des dessins à la MAPRA à Lyon, dans le cadre de la Biennale "Musiques en scène" du 2 au 17 mars (où dans le programme parmi des dizaines de compositeurs type Boulez ou Steve Reich on retrouve le nom de notre amateur d'accordéon et de poésie sonore bruts).
Expo du 28 février au 17 mars à la MAPRA de Lyon. Petit-déjeuner André Robillard et Alain Moreau (directeur du théâtre de Villefranche-sur-Saône) le samedi 3 mars à 10h30 au Théâtre Les Ateliers à Lyon.
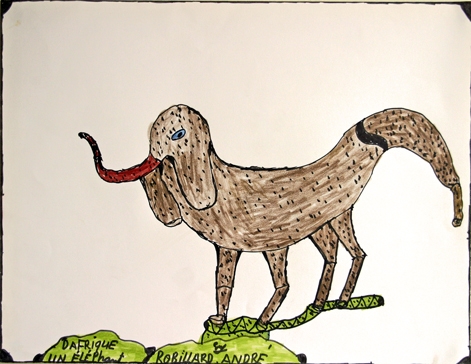
André Robillard, DAFRIQUE UN ELEPhant, coll.Bruno Montpied
Et Guy Brunet dans tout ça?
Eh bien, ce dernier exposera à Villefranche-sur-Saône dans le cadre du "festival de cinéma francophone en Beaujolais", à la fin de l'année. On me signale qu'il y aura des silhouettes (de producteurs, vedettes d'Hollywood comme les affectionne Guy Brunet comme on sait), des affiches de films (la plupart américains comme de juste ; "copies" modifiées involontairement par l'auteur) et ses films bricolés à la maison, comme ceux où il se rêve en speaker de documentaires cinéphiliques. C'est le même Alain Moreau qui sera le conseiller artistique de cette manifestation prévue pour novembre 2012 seulement.
Actualité du Musée de la Création Franche
A Bègles, va bientôt s'achever une exposition Emilie Henry que je n'ai pas eu le temps de signaler ici, bien que j'en apprécie les oeuvres, très proches, dans la technique des encres, des pratiques tachistes, rorschachiennes, voire hugoliennes qui sont autant de pratiques divinatoires ou simplement génératrices d'imaginaires latents (cela dit, Emilie Henry réalise aussi désormais des collages au milieu de ses encres). Cette expo est prévue pour se terminer le 22 janvier, dans une semaine donc, pressez-vous les retardataires (175 dessins vous y attendent).
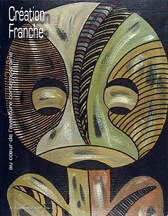 Par ailleurs, à signaler la parution à la fin de l'année dernière du n°35 de la persévérante revue Création Franche dont Gérard Sendrey vient d'annoncer qu'il se retirait du poste de rédacteur en chef, pour se limiter de façon intermittente à des collaborations ponctuelles. J'ai été invité à participer à ce numéro où je propose un article pour découvrir le foyer d'arts plastiques de La Passerelle à Cherbourg (La Passerelle: comme un vol d'étourneaux dans le paysage créatif), foyer par ailleurs déjà évoqué sur ce blog. Le sommaire est à lire ici (à noter qu'on trouve dedans un article de présentation de Pascal Tassini par Teresa Maranzano, et un texte de Deborah Couette, du CRAB, sur Alexis Lippstreu où elle analyse la démarche imitatrice-recréante d'Alexis Lippstreu, analyse qui ne peut que me ravir puisque je l'ai déjà précédée sur la question dans le texte de mon allocution sur les rapports entre arts populaires et art brut dans le cadre du séminaire de Barbara Safarova au Collège International de Philosophie).
Par ailleurs, à signaler la parution à la fin de l'année dernière du n°35 de la persévérante revue Création Franche dont Gérard Sendrey vient d'annoncer qu'il se retirait du poste de rédacteur en chef, pour se limiter de façon intermittente à des collaborations ponctuelles. J'ai été invité à participer à ce numéro où je propose un article pour découvrir le foyer d'arts plastiques de La Passerelle à Cherbourg (La Passerelle: comme un vol d'étourneaux dans le paysage créatif), foyer par ailleurs déjà évoqué sur ce blog. Le sommaire est à lire ici (à noter qu'on trouve dedans un article de présentation de Pascal Tassini par Teresa Maranzano, et un texte de Deborah Couette, du CRAB, sur Alexis Lippstreu où elle analyse la démarche imitatrice-recréante d'Alexis Lippstreu, analyse qui ne peut que me ravir puisque je l'ai déjà précédée sur la question dans le texte de mon allocution sur les rapports entre arts populaires et art brut dans le cadre du séminaire de Barbara Safarova au Collège International de Philosophie).

Yann, sans titre, (créé dans l'atelier de La Passerelle), 50x70 cm, février2011, coll BM
A Lausanne, Sarah Lombardi aux commandes et Lucienne Peiry appelée à de plus hautes responsabilités
A la Collection de l'Art Brut, il y a du mouvement, et je n'y comprends pas grand-chose... Bon, OK, que Sarah Lombardi devienne directrice par intérim pendant un an, ça je vois de quoi il s'agit (ou à peu prés...). Mais Lucienne Peiry qui devient dans le même temps "attachée culturelle-directrice de la recherche et des relations internationales" en poste auprés de la municipalité de Lausanne, ça, je patauge quelque peu sur le sens de cette fonction, en franc béotien que je suis. (ci-contre portrait de Sarah Lombardi, photo Magali Konig, Coll. de l'Art Brut)
Mais Lucienne Peiry qui devient dans le même temps "attachée culturelle-directrice de la recherche et des relations internationales" en poste auprés de la municipalité de Lausanne, ça, je patauge quelque peu sur le sens de cette fonction, en franc béotien que je suis. (ci-contre portrait de Sarah Lombardi, photo Magali Konig, Coll. de l'Art Brut)
Guo Fengyi et Gregory Blackstock à Lausanne
Pendant ce temps dans les locaux de la Collection de l'Art Brut se poursuivent deux expos également intéressantes, Guo Fengyi d'une part (18 nov 2011-29 avril 2012) et Gregory Blackstock (30 septembre 2011-19 février 2012). Les deux sont également au sommaire du dernier fascicule de la Collection, le n°23, paru tout récemment, Guo Fengyi décrite et analysée par Lucienne Peiry et Gregory Blackstock par Philippe Lespinasse, le même Lespinasse qui a réalisé avec Andress Alvarez un duo de courts-métrages sur ces créateurs, réuni en un seul DVD.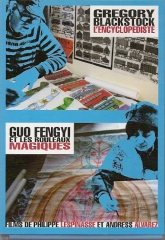 Philippe Lespinasse a le chic d'évoquer des créateurs d'art brut de façon sensible, condensée, dans une durée de film adaptée à une première prise de contact, telle qu'on l'expérimente dans les auditoriums de musée.
Philippe Lespinasse a le chic d'évoquer des créateurs d'art brut de façon sensible, condensée, dans une durée de film adaptée à une première prise de contact, telle qu'on l'expérimente dans les auditoriums de musée.
Si Gregory Blackstock se présente a priori plutôt comme une sorte de naïf encyclopédiste amateur de planches sérielles aux thématiques variées (gratte-ciels, accordéons, corbeaux aux plumages pas toujours réalistes, scarabées, fouets, chaussures, bombardiers...), Guo Fengyi (1942-2010) paraît de son côté avoir commencé son œuvre (qui n'en était pas une au début) dans le but de se soigner avant toute chose. "Elle cherche à soulager ses souffrances dues à des crises d'arthrite aiguë", nous dit le dossier de presse de l'expo.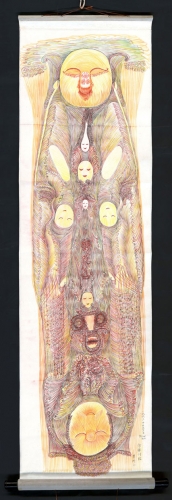 Par la suite, c'est par un esprit d'aventure et d'exploration d'une forme de savoir inconnu qu'elle systémisa sa production. Elle se mit à dessiner à un moment sur des rouleaux de papier fin fabriqué à partir de fibres végétales. Dessinant de façon tout à fait automatique –elle le dit très clairement dans le film de Lespinasse– dans les deux sens du rouleau, elle assimile le surgissement graphique qui s'opère sous ses doigts à la germination des arbres, sans repentir possible.
Par la suite, c'est par un esprit d'aventure et d'exploration d'une forme de savoir inconnu qu'elle systémisa sa production. Elle se mit à dessiner à un moment sur des rouleaux de papier fin fabriqué à partir de fibres végétales. Dessinant de façon tout à fait automatique –elle le dit très clairement dans le film de Lespinasse– dans les deux sens du rouleau, elle assimile le surgissement graphique qui s'opère sous ses doigts à la germination des arbres, sans repentir possible.
Ces rouleaux de dessin à visée thérapeutique peuvent faire songer par analogie aux rouleaux magiques éthiopiens tels qu'ils avaient été présentés par exemple dans l'ex-Musée des Arts Africains et Océaniens à Paris en 1992-1993.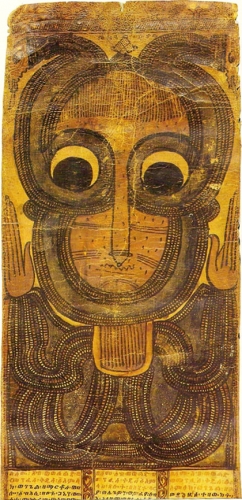 Ces rouleaux, portés à la ceinture par ceux qu'ils étaient destinés à protéger, de la taille d'un homme, étaient des talismans. Guo Fengyi ne se fabriquait-elle pas pour elle seule ses propres talismans? Un peu comme la Madame C. dont nous visitons la maison décorée de dentelles de plâtre dans notre film Bricoleurs de paradis, à Remy Ricordeau et à moi, et qui luttait durant ses nuits blanches de souffrance en sculptant contre son cancer.
Ces rouleaux, portés à la ceinture par ceux qu'ils étaient destinés à protéger, de la taille d'un homme, étaient des talismans. Guo Fengyi ne se fabriquait-elle pas pour elle seule ses propres talismans? Un peu comme la Madame C. dont nous visitons la maison décorée de dentelles de plâtre dans notre film Bricoleurs de paradis, à Remy Ricordeau et à moi, et qui luttait durant ses nuits blanches de souffrance en sculptant contre son cancer.
Illustrations: Ci-dessus, Guo Gengyi, Le Mont Putuo, 1993, encre sur papier, 153,5x52 cm, ph: Caroline Smyrliadis, Coll. de l'Art Brut, Lausanne. Et en dessous, "Ange gardien", rouleau protecteur en parchemin, XIXe siècle, H: 44 cm, L:23,5, ancienne coll; du MAAO.
18:36 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art singulier, Confrontations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal tassini, madmusée, handicapés mentaux, créahm, gérard sendrey, émilie henry, andré robillard, guy brunet, alain moreau, théâtre de villefranche, création franche, art singulier, la passerelle, lucienne peiry, sarah lombardi, guo fengyi, gregory blackstock, philippe lespinasse, rouleaux magiques éthiopiens |  Imprimer
Imprimer
06/01/2012
Tante Chinoise et les autres: "Elle aurait pu s'appeler Fragile, Cocasse, Maladive ou Malice"
Sont curieux les chemins qui mènent aux révélations. Je venais d'entrer au vernissage Marcel Storr en décembre dernier, et voilà que pour fuir l'affluence de la première salle j'avise dans la seconde un éventaire de livres sur l'art brut et consorts organisé par la librairie Le Monte-en-l'air. Au moment où je me dis que je ne vais sans doute rien trouver de nouveau, pan, voilà que mes yeux sont attirés magnétiquement par une couverture qui m'appelle.
Tante chinoise et les autres, c'est le titre de ce reprint à la Table Ronde (2009), d'après un album de croquis légendés d'une plume calligraphique, en 1894, par une enfant apparemment prodige, Marguerite Bonnevay (1882-1903). Un fac-similé qui a tout de même nécessité plus de cent ans pour que cette œuvre passe enfin quelque peu à la postérité! Soixante années s'étaient écoulées avant que l'on en fasse un film, dû à David Perlov, en 1956, qui fut la première occasion de sortir cet étonnant opus de son oubliette familiale (on lira l'éclairante présentation de l'objet par Nathalie Jungerman qui a établi l'édition du livre à la Table Ronde)
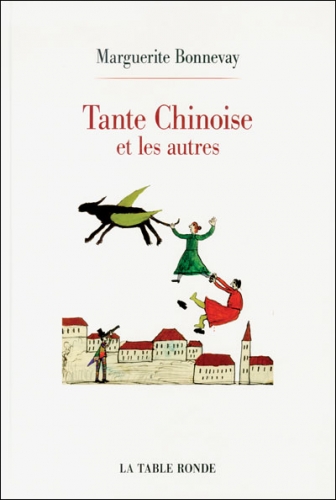
Prodige? Elle avait 12 ans certes, et ne vécut pas longtemps hélas (elle disparut à l'âge de 21 ans des suites d'une tuberculose). Etait élevée à l'époque chez les sœurs que l'on disait "bonnes" et chez qui apparemment elle devait s'ennuyer ferme, de même que pendant ses vacances à Gonfaron dans le Midi, d'après ce qu'en dit sa lointaine parente Nathalie Jungerman. Etait-on prodige lorsqu'on passait ses loisirs à dessiner à une époque où les distractions pour les enfants n'avaient rien de commun avec celles d'aujourd'hui? On devait s'appliquer infiniment plus dans ses travaux de croquis, de même lorsqu'on laissait son imagination gambader dans des récits d'aventures qui avaient un souffle autrement plus épique que ce qu'un enfant d'aujourd'hui peut produire, accaparé qu'il est par d'autres dadas plus électroniques.
Etait-on prodige lorsqu'on passait ses loisirs à dessiner à une époque où les distractions pour les enfants n'avaient rien de commun avec celles d'aujourd'hui? On devait s'appliquer infiniment plus dans ses travaux de croquis, de même lorsqu'on laissait son imagination gambader dans des récits d'aventures qui avaient un souffle autrement plus épique que ce qu'un enfant d'aujourd'hui peut produire, accaparé qu'il est par d'autres dadas plus électroniques.
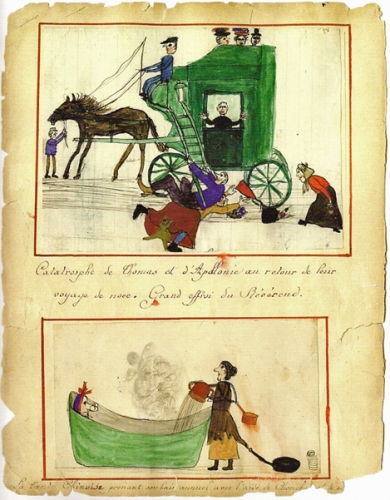
"Catastrophe de Thomas et d'Apollonie au retour de leur voyage de noce. Grand effroi du révérend." Page 7 dans le livre Tante Chinoise et les autres
Ce qui n'empêche pas que ces dessins coloriés à l'aquarelle ou avec des gouaches d'écolière hésitent entre l'art enfantin et ce que l'on n'appelait pas encore, ni art naïf, ni art brut en 1894. Ils entretiennent un rapport de cousinage troublant avec diverses autres expressions populaires naïves, comme ce dessin de la catastrophe du retour de noce des nouveaux épousés "Thomas et Apollonie", qui paraît construit comme un de ces ex-voto que l'on trouvait en abondance à l'époque dans les églises du Midi et que peut-être, très certainement même, Marguerite avait vus.
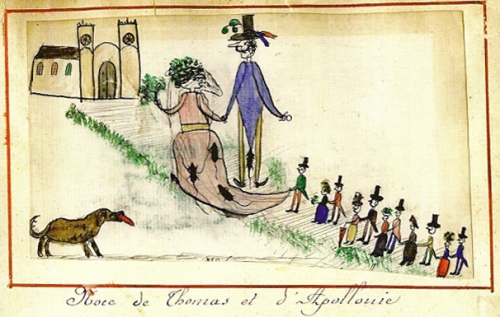
"Noce de Thomas et d'Apollonie", extrait de la page 5 du livre de Marguerite Bonnevay
La "noce de Thomas et d'Apollonie" de même ne va pas sans me rappeler un tableau que j'ai dans ma collection, dû au peintre naïf Louis Roy, déjà évoqué sur ce blog le 12 août 2008, où les personnages sont traités de profil, rapetissés, comme un cortège d'homuncules, tandis que chez Marguerite, la réduction de taille sert plutôt un besoin de traduire la perspective du cortège des mariés.
déjà évoqué sur ce blog le 12 août 2008, où les personnages sont traités de profil, rapetissés, comme un cortège d'homuncules, tandis que chez Marguerite, la réduction de taille sert plutôt un besoin de traduire la perspective du cortège des mariés.
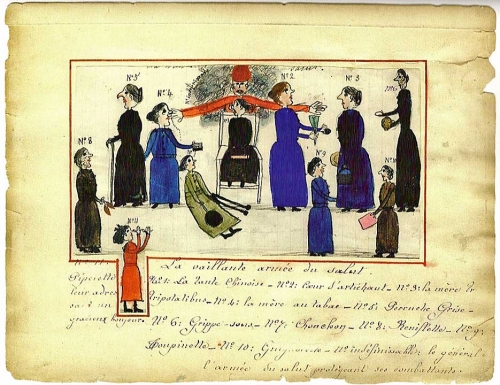
"La vaillante armée du Salut, N°1: La Tante Chinoise, N°2: Coeur d'artichaut, N°3: la mère Tripotatibus, N°4 la mère au tabac, N°5: Perruche Grise, N°6: Grippe-sous, N°7: Chonchon, N°8: Reniflette, N°9: Toupinette, N°10: Guignolette, N°11: Piperette leur adressant un gracieux bonjour, N°indéfinissable: le général de l'armée du Salut protégeant ses combattants." Page 1 de Tante Chinoise et les autres
Les croquis de Marguerite, qui ne sont pas loin de la bande dessinée alors tout juste naissante en France, comme le rappelle Nathalie Jungerman, paraissent aller du côté de la chronique villageoise moquant les aspects des adultes souvent perçus comme grotesques, prétentieux, hypocrites, tels qu'une jeune fille de douze ans, particulièrement lucide (et tendre cependant), était à même de les mettre en évidence, à la distance où elle se trouvait, entre deux âges, avant que les vicissitudes liées à la vie sociale l'aient amenée à plus de concessions (la tuberculose l'en préserva, seul bénéfice de sa sale besogne).
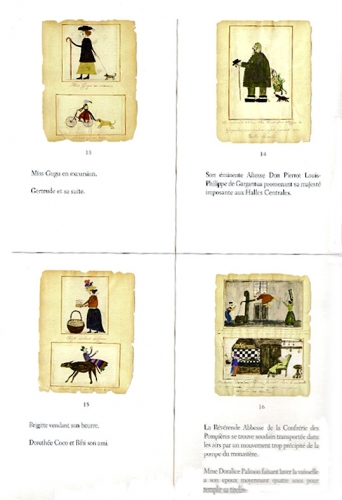
Tous les dessins de l'album de Marguerite Bonnevay font l'objet d'un récapitulatif en fin de première partie avec les légendes transcrites en caractères typographiques pour plus d'intelligibilité comme ci-dessus p.54 du livre
Cet ouvrage en fac-similé est déjà en soi un remarquable plaisir visuel, mais la surprise ne s'arrête pas là. Car, avant que l'album ne soit sorti de l'oubli, un fim de dix-sept minutes fut tourné par David Perlov, jeune cinéaste alors, qui s'était enthousiasmé à la découverte de l'album de Marguerite que lui avait montré la nièce de cette dernière, mère de Nathalie Jungerman. Il put être financé grâce à l'aide d'une nuée d'artistes, de comédiens et de littérateurs, parmi lesquels Prévert (qui signe dans le film un remarquable prologue poétique en prose), Vieira Da Silva et Arpad Szenés, Abrasza Zemsz (ethnologue), Czeslaw Milosz, Jeanne Moreau, Calder, Magnelli, Gabrielle Buffet-Picabia, le docteur Claude Olivenstein, André Heinrich (qui est crédité de "conseiller technique" dans le film), etc... La musique, importante contribution, est composée par Germaine Tailleferre.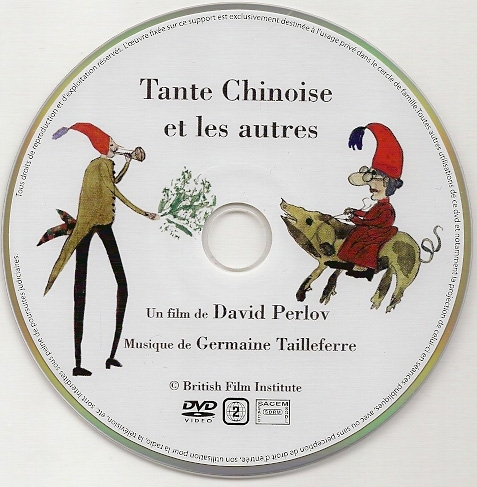 La production et la réalisation furent chaotiques et ne purent être terminées qu'avec l'aide du British Film Institute, ce qui explique que sa première fut donnée d'abord à Londres en 1956 dans une version anglaise. Cependant, une version en français put être ensuite réalisée pour une projection à la Cinémathèque Française en 1957. Et devinez qui prêta sa voix au commentaire en off? L'inévitable et mythique Jacques-Bernard Brunius, le même homme qui avait réalisé le non moins mythique premier film d'art sur les autodidactes comme le facteur Cheval, l'abbé Fouré, et divers Naïfs, Violons d'Ingres en 1939... (Voir ici les notes que je ne cesse de lui consacrer sur ce blog). Ce film, excellente initiative, est donc joint au livre sous la forme d'un DVD fixé à la troisième page de couverture.
La production et la réalisation furent chaotiques et ne purent être terminées qu'avec l'aide du British Film Institute, ce qui explique que sa première fut donnée d'abord à Londres en 1956 dans une version anglaise. Cependant, une version en français put être ensuite réalisée pour une projection à la Cinémathèque Française en 1957. Et devinez qui prêta sa voix au commentaire en off? L'inévitable et mythique Jacques-Bernard Brunius, le même homme qui avait réalisé le non moins mythique premier film d'art sur les autodidactes comme le facteur Cheval, l'abbé Fouré, et divers Naïfs, Violons d'Ingres en 1939... (Voir ici les notes que je ne cesse de lui consacrer sur ce blog). Ce film, excellente initiative, est donc joint au livre sous la forme d'un DVD fixé à la troisième page de couverture.
Le film de David Perlov, Tante Chinoise et les autres sera projeté au festival de cinéma organisé par l'Association Hors-Champ autour des Arts Singuliers qui se tiendra à la Bibliothèque Louis Nucéra et au MAMAC de Nice les vendredi 1er, et samedi 2 juin 2012. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir.
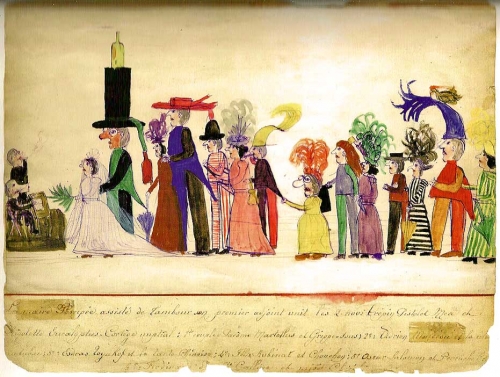
"Le maire Pompée assisté de Tambour, son premier adjoint, unit les deux novices: Crépin Pistolet Mea et Rigolette Eucalyptus...", page 21 de l'album Tante Chinoise et les autres
*
"Au début du siècle, dans un village de Provence, il y avait une pauvre petite fée.
Elle aurait pu s'appeler Fragile, Cocasse, Maladive ou Malice. Mais elle s'appelait tout bonnement Marguerite et n'avait pour toute baguette magique qu'un crayon à changer les gens..."
(Jacques Prévert, extrait de son Prologue dans le film de David Perlov )
23:56 Publié dans Art Brut, Art de l'enfance, Art immédiat, Art naïf, Cahiers et manuscrits naïfs ou bruts | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marguerite bonnevay, tante chinoise, art enfantin, art naïf, art brut, art immédiat, caricature, grotesque, david perlov, jacques brunius, jacques prévert, andré heinrich, gonfaron, tuberculose, nathalie jungerman, ex-voto, art populaire insolite, manuscrits naïfs enluminés |  Imprimer
Imprimer
25/12/2011
Marcel Storr, les tours de Babel du pauvre
 (Cette note contient une mise à jour)
(Cette note contient une mise à jour)
Quel magnifique créateur que ce Marcel Storr dont l'oeuvre rare et précieuse fut sauvée par les époux Kempf, Liliane et Bertrand, exhibée petit à petit, vingt-deux ans après la disparition de l'auteur, la première fois à la Halle Saint-Pierre en 2001-2002 (expo Aux Frontières de l'Art Brut II), avec le soutien incontournable du spécialiste français en chef des arts populaires spontanés, Laurent Danchin (qui le présenta au même moment dans Raw Vision n°36), puis par la suite dans son intégralité à la mairie du IXe ardt en 2005, plus partiellement à la Triennale d'art insitic à Bratislava en 2007, etc, sans oublier l'éclairage précieux apporté récemment par l'écrivain, peintre et psychanalyste François Cloarec (un livre chez Phébus à conseiller: Storr, architecte de l'ailleurs, qui a apporté d'utiles aperçus biographiques repêchés avec patience par l'auteur dans diverses archives). Voici donc l'œuvre du cantonnier Storr à nouveau exposée dans son ensemble, cette fois au Pavillon Carré de Baudouin.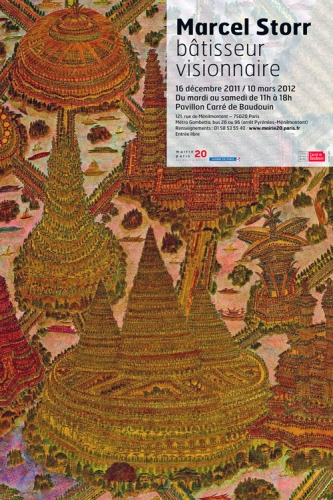
Des églises sages de ses débuts, on passe par degrés à des architectures plus exaltées, les flèches se multipliant, s'élevant toujours plus haut, telles des orgues prises de fiévre, comme démarquées de la Sagrada Familia de Gaudi, ou de palais d'Extrême-Orient comme ceux d'Angkor (Storr feuilletait l'Illustration paraît-il, féru de ses images, cela a pu l'inspirer). Le dessinateur se prend au jeu progressivement, ne se contentant plus au fil des années de ces représentations fidèles de lieux de culte. Il se concentre sur la couleur (quel prodigieux coloriste, inventant ses techniques, son vernis particulier) et sur l'envol de ses bâtiments atteints de gigantisme, construisant au besoin des sortes de diptyques ou triptyques, par feuilles rajoutées. On nous parle de 72 dessins tout au plus, réalisés avec une méticulosité de bénédictin sur une durée de quarante années (les premiers dessins conservés date de 1932, et Marcel Storr s'éteint à l'Hôpital Tenon en 1976).
Marcel Storr, sans titre, 1964, 37x30cm, crayon et encres de couleur, vernis, © Liliane et Bertrand Kempf
Les cathédrales de cet homme sourd, le plus souvent enfermé en lui-même, torturé par l'abandon par ses parents à l'âge de trois ans (il fut un pupille de l'Assistance Publique, atteint de surdité des suites de mauvais traitements dans des familles de mauvais accueil, et sur le tard victime d'une tendance au délire de persécution bien excusable étant donné sa vie saccagée), à un moment, qui paraît concomitant de l'érection des tours de la Défense qui dans les années 60 se mirent à émerger derrières les cîmes des arbres dont Storr balayait les feuilles dans le Bois de Boulogne, à un moment les cathédrales se métamorphosent magiquement en constructions végétales fourmillantes, se mettent à proliférer, s'affranchissant de leurs modèles initiaux. Leurs flèches paraissent aussi prêtes à s'envoler telles les fusées de Werner Von Braun que la NASA dans ces années 60 lance vers la Lune (premier homme sur la Lune, 1969).
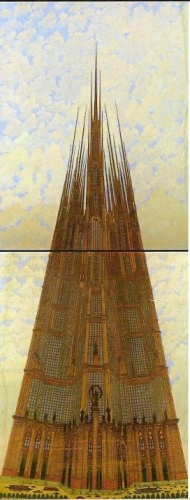 Des villes futuristes, des mégalopoles aux tours sans fin, parfois reliées par des passerelles, naissent ainsi dans ses dessins aux dimensions imposantes. Dessins auxquels il donnait toute son énergie, toute son âme, s'y concentrant dans l'écart le plus absolu vis-à-vis du reste du monde, au point qu'on peut se demander –avec Françoise Cloarec dans son livre– si la reconnaissance dont il commença à sentir les effets au début des années 70, après que les époux Kempf eurent montré certains blocs de dessin à divers critiques d'art, n'eut pas inconsciemment un effet négatif sur lui (il mourut cinq ans plus tard, d'usure physique et psychique apparemment ; cependant l'exhibition de cette oeuvre resta fort limitée, les Kempf la mettant au secret dans un coffre de 1971 à 1981, ayant peut-être senti la nécessité de la laisser ainsi reposer par égard à son créateur hyper-sensible, un écorché littéralement). Mais comment imaginer qu'on n'ait pas voulu faire connaître de tous une telle œuvre une fois mis en sa présence? D'autant que Marcel Storr accepta de laisser les Kempf montrer son travail, et leur confia même sa production. La véritable cause de cette vie gâchée étant plutôt à rechercher dans le faisceau d'irresponsabilités et de stupidités qui se liguèrent dans la jeunesse de Marcel Storr pour lui ruiner son existence. Il y répondit, en reconstruisant à partir de ces ruines justement, des palais fantastiques, un monde architectural destiné à remplacer l'actuel, se mesurant ainsi d'égal à égal avec tant d'autres créateurs de l'art brut, Achilles Rizzoli, le Facteur Cheval, Bodys Isek Kingelez et ses maquettes utopistes, Simon Rodia et ses Tours de Watts, le petit peintre naïf polonais Nikifor aux ambitions architecturales plus modestes mais dont on peut rapprocher du style graphique les dessins de Storr je trouve, ou encore ce peintre américain étonnant Erasmus Salisbury Field, auteur d'un extraordinaire collage de monuments, comme si du néant d'une vie piétinée on ne pouvait que faire surgir, dans une révolte salvatrice, une surenchère germinative de bâtiments tous plus géants les uns que les autres, proportionnés à la taille du préjudice existentiel.
Des villes futuristes, des mégalopoles aux tours sans fin, parfois reliées par des passerelles, naissent ainsi dans ses dessins aux dimensions imposantes. Dessins auxquels il donnait toute son énergie, toute son âme, s'y concentrant dans l'écart le plus absolu vis-à-vis du reste du monde, au point qu'on peut se demander –avec Françoise Cloarec dans son livre– si la reconnaissance dont il commença à sentir les effets au début des années 70, après que les époux Kempf eurent montré certains blocs de dessin à divers critiques d'art, n'eut pas inconsciemment un effet négatif sur lui (il mourut cinq ans plus tard, d'usure physique et psychique apparemment ; cependant l'exhibition de cette oeuvre resta fort limitée, les Kempf la mettant au secret dans un coffre de 1971 à 1981, ayant peut-être senti la nécessité de la laisser ainsi reposer par égard à son créateur hyper-sensible, un écorché littéralement). Mais comment imaginer qu'on n'ait pas voulu faire connaître de tous une telle œuvre une fois mis en sa présence? D'autant que Marcel Storr accepta de laisser les Kempf montrer son travail, et leur confia même sa production. La véritable cause de cette vie gâchée étant plutôt à rechercher dans le faisceau d'irresponsabilités et de stupidités qui se liguèrent dans la jeunesse de Marcel Storr pour lui ruiner son existence. Il y répondit, en reconstruisant à partir de ces ruines justement, des palais fantastiques, un monde architectural destiné à remplacer l'actuel, se mesurant ainsi d'égal à égal avec tant d'autres créateurs de l'art brut, Achilles Rizzoli, le Facteur Cheval, Bodys Isek Kingelez et ses maquettes utopistes, Simon Rodia et ses Tours de Watts, le petit peintre naïf polonais Nikifor aux ambitions architecturales plus modestes mais dont on peut rapprocher du style graphique les dessins de Storr je trouve, ou encore ce peintre américain étonnant Erasmus Salisbury Field, auteur d'un extraordinaire collage de monuments, comme si du néant d'une vie piétinée on ne pouvait que faire surgir, dans une révolte salvatrice, une surenchère germinative de bâtiments tous plus géants les uns que les autres, proportionnés à la taille du préjudice existentiel.
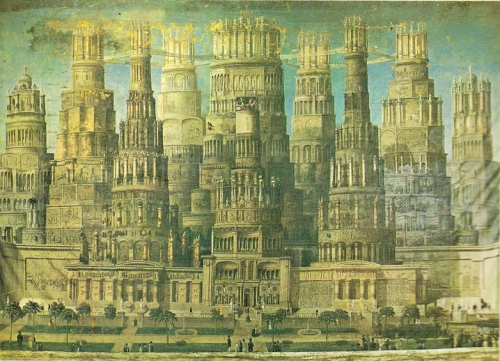
Erasmus Salisbury Field, Le Monument Historique de la République Américaine, vers 1875 (des passerelles reliant les tours à leurs sommets transportent des trains!), extrait du livre d'Oto Bihalji-Merin, Les Maîtres de l'Art Naïf, La Connaissance, Bruxelles, 1972
Exposition Marcel Storr, bâtisseur visionnaire, du 16 décembre 2011 au 31 mars 2012. Renseignements plus précis ici (dossier de presse, informations pratiques, diaporama, événements (dont une mini programmation "bâtisseurs sauvages" par Pierre-Jean Würtz de l'Association Hors-Champ dans l'auditorium du pavillon Carré de Baudouin le samedi 28 janvier à 15h).
A lire sur Storr les deux ouvrages suivants, une monographie où disons-le, les reproductions sont complètement ratées côté restitution des couleurs originales, et le roman biographique de Françoise Cloarec, tous deux publiés par le même éditeur, Phébus:
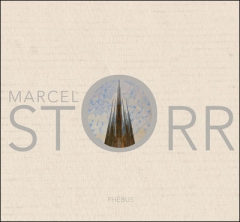
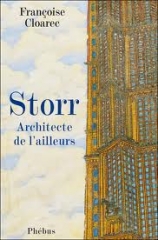
Les illustrations de cette note (le portrait de Marcel Storr, le diptyque en deux parties de 105x80 cm chacune, et le dessin ci-dessus non daté de 61x50cm) sont tous sous le © de Liliane et Bertrand Kempf
16:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : marcel storr, bertrand et liliane kempf, pavillon carré de baudouin, art brut, architecture fantastique, gaudi, laurent danchin, françois cloarec |  Imprimer
Imprimer
20/12/2011
La Passerelle et les Bricoleurs à la Maison Rouge
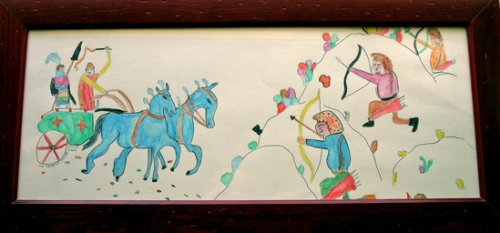 Voici donc que s'annonce une exposition des créatifs du foyer d'art plastique de la Passerelle à Cherbourg (Nicolas, Pascal, Christine, Patrice, etc.) dont j'ai maintes fois eu l'occasion de parler dans cette colonne sans fin (ou presque). Et pas n'importe où puisqu'il s'agit cette fois des locaux de la Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, et plus exactement de son "Vestibule", qui est en fait la dernière salle du parcours d'exposition...
Voici donc que s'annonce une exposition des créatifs du foyer d'art plastique de la Passerelle à Cherbourg (Nicolas, Pascal, Christine, Patrice, etc.) dont j'ai maintes fois eu l'occasion de parler dans cette colonne sans fin (ou presque). Et pas n'importe où puisqu'il s'agit cette fois des locaux de la Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, et plus exactement de son "Vestibule", qui est en fait la dernière salle du parcours d'exposition...
Plusieurs productions de l'atelier seront présentées, et en parallèle, ceux qui ne le connaîtraient pas auront aussi l'occasion de voir le documentaire, désormais "célèbre" sur ce blog, de Remy Ricordeau, coécrit par votre serviteur, Bricoleurs de paradis, consacré à des créateurs populaires d'environnements, et diffusé dans le cinéma de poche du bout de ce "vestibule". Le tout devant se tenir du 21 décembre 2011 jusqu'au 15 janvier 2012 (vernissage le jeudi 22 à partir de 17h). A noter que cette manifestation est à l'initiative d'un membre du personnel, Sophie Gaucher, selon une politique de l'établissement qui souhaite donner aux différents membres de son équipe le droit de proposer telle ou telle exposition de leur choix.
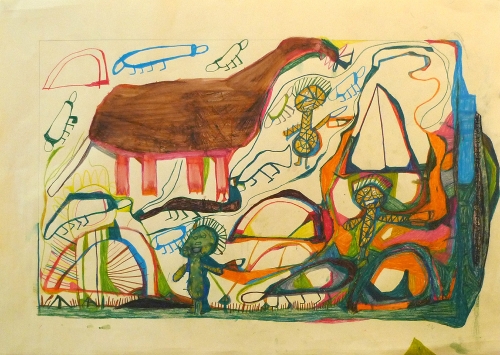
Kévin, Dinosaures, 50x70cm, 2010, ph La Passerelle ; et au-dessus, successivement, Nicolas, Les Romains, 2006, puis Pascal, chaise décorée, ph. Bruno Montpied
Comme on le constatera, ce petit événement ne cloisonne pas les créateurs autodidactes entre eux, et surtout pas ceux qui proviennent des ateliers d'art pour handicapés, n'est-ce pas, Mme Dubarry, de la Mairie de Paris? (Voir note précédente du 11 décembre)
18:39 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la passerelle à cherbourg, romuald reutimann, art des handicapés mentaux, art différencié, handicap, maison rouge-fondation antoine de galbert, bricoleurs de paradis |  Imprimer
Imprimer
16/12/2011
Des bricoleurs de paradis au pays de Lourdes, un miracle à coup sûr
Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé des tribulations de notre film à Remy Ricordeau et à moi. Cette fois, trois rencontres sont au programme pour les amis pyrénéens, le film Bricoleurs de Paradis (le Gazouillis des Eléphants) est projeté le 17 décembre, aujourd'hui même (vite, lâchez votre ordinateur et filez-y!) à la Médiathèque du Pays de Lourdes à 19h, puis à la Maison de la Vallée de Luz le lundi 19 décembre à 21h, enfin à L'Hospitalet à Barèges le jeudi 22 décembre à 21h. Le livre Eloge des Jardins Anarchiques,qui contient le DVD du film faut-il le rappeler, sera évidemment présenté par la même occasion. Toutes ces projections se feront en présence du seul réalisateur du film Remy Ricordeau, son coauteur étant appelé vers d'autres cieux...
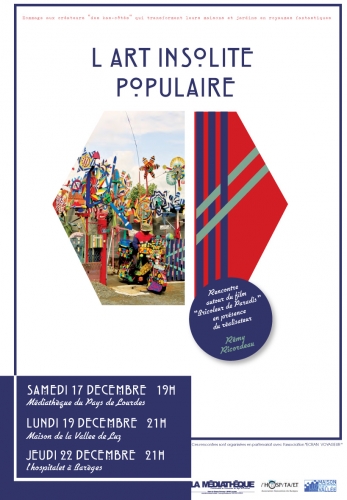
Hommage aux créateurs des bas-côtés qui transforment leurs maisons et jardins en royaumes fantastiques... (Phrase liminaire tout en haut de cette affiche, imprimée en rouge)
Par ailleurs, signalons l'épuisement du premier tirage d'Eloge, et félicitons tous ceux qui auront acquis cette première édition en passe de devenir collector. Un deuxième tirage est prévu pour aujourd'hui, on a pensé à vous, les retardataires.
23:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bricoleurs de paradis, eloge des jardins anarchiques, environnements spontanés, médiathèque du pays de lourdes, remy ricordeau |  Imprimer
Imprimer
06/12/2011
Que rien ne délie plus nos amours
Nouvelle coutume aperçue sans nul doute par beaucoup de flâneurs parisiens ces temps-ci, le Poignard se doit de l'évoquer, car cela l'a touché, on accroche par centaines des cadenas aux grilles des rambardes de certains ponts de Paname ces temps-ci.
Ph. BM, novembre 2011, pont de l'Archevéché, derrière Notre-Dame, 5e ardt, Paris
Qui ça "on"? Des couples d'amoureux probablement qui usent de cadenas de formes, couleurs et aspects variés, sur lesquels ils tracent parfois leurs deux prénoms, plus parfois un petit mot, en les fermant à clé, attachés pour toujours aux brins de fer. Je les imagine fiers de leur acte, ayant ainsi symboliquement scellé le nœud de leur amour, et jetant dans les flots sombres de la Seine la petite clé qui risquerait de dénouer ce lien qu'ils veulent voir naïvement éternel. On s'aimera toujours, dit le cadenas rivé au pont, malgré le fleuve du temps qui coule par dessous. La barque de l'amour ne s'échouera pas, Maïakovsky.

Ph. BM, 2011
D'où vint ce rituel? Quand a-t-il commencé? Je parierai que ce n'est pas très vieux (même si cela a pris, notamment au pont de l'Archevéché, un tour assez massif ; j'ai vu la même pratique sur la passerelle du Pont des Arts). Et que cela procède de coutumes importées par des touristes étrangers. Paris étant vue comme une ville romantique. C'est un peu semblable aux piècettes propitiatoires que l'on jette au fond des fontaines. La monnaie a été ici remplacée par une clé. C'est plus joli.
26/11/2011
Jaber au Louvre?
Jaber Al Mahjoub, ça vous dit quelque chose? L'Aracine autrefois dans les années 80 l'exposait, surtout des pièces en trois dimensions, des sortes de totems malingres faits avec des gros cernes et de la bande plâtrée, des bouts de miroir...

Jaber au Musée de la Création Franche, Bègles, photo Bruno Montpied, octobre 2010
Et puis, le temps a passé. Je croisais quelquefois ses traces semées sous forme de peintures dans le centre de Paris, pas mal rue Quincampoix, ou chez les soldeurs de livres, Le Carnaval des Affaires près de l'Hôtel de Ville ou chez Mona Lisait. Toutes les échoppes lui étaient bonnes à cet enfant des rues un peu malicieux. On en arrivait presque à croire qu'il allait squatter par un entregent terrible toutes les épiceries autour de Beaubourg qu'il encerclait méthodiquement.
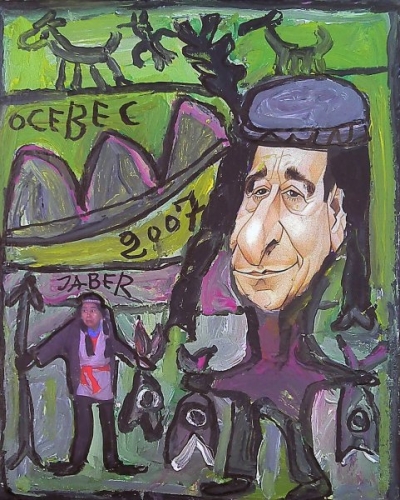
Jaber, Delanoë, 30x40 cm, exposé quai du Louvre
Ses œuvres me parurent à la longue faites un peu trop vite, comme s'il se pressait, ou était pris d'une frénésie de peindre boulimique. Un jour dans un café, je rencontrai même un individu qui en distribuait à la volée. Le temps continuait de s'écouler. Et voilà-t-y pas qu'il change son fusil d'épaule. Il pointe le Louvre à présent. Il a une galerie en plein vent, un bouquiniste l'expose le long de la Seine, juste à côté du Louvre. Et ce que l'on y voit est plutôt agréable à regarder. C'est toujours la même joie de vivre, les couleurs en goguette et les inscriptions jetées pêle-mêle sans s'arrêter outre mesure à leur sens. Les mots ne comptent pas, on dirait, seuls le jeu et la joie de vivre restent en partage. Il paraît que Jaber vit à nouveau des jours difficiles (problèmes d'argent, problèmes d'hébergement). On peut contacter le site du monsieur bouquiniste-galeriste en plein vent (après le Pont-Neuf, 20, quai du Louvre), il y a des peintures à vendre et une adresse pour les contacts. Si vous avez une piaule à louer...
C'est toujours la même joie de vivre, les couleurs en goguette et les inscriptions jetées pêle-mêle sans s'arrêter outre mesure à leur sens. Les mots ne comptent pas, on dirait, seuls le jeu et la joie de vivre restent en partage. Il paraît que Jaber vit à nouveau des jours difficiles (problèmes d'argent, problèmes d'hébergement). On peut contacter le site du monsieur bouquiniste-galeriste en plein vent (après le Pont-Neuf, 20, quai du Louvre), il y a des peintures à vendre et une adresse pour les contacts. Si vous avez une piaule à louer...
23:26 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Fantastique social | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jaber, figures de la rue, bouquiniste |  Imprimer
Imprimer
25/11/2011
Le vert et son envers

Bruno Montpied, La Forêt Lumineuse, 24x25 cm, encre, marqueurs et laque pulvérisée sur papier pur chiffon, 2006
Je n'aime pas le vert, je ne le porte pas dans mon coeur, je ne sais pourquoi, j'ai du mal à l'utiliser. Ici, c'est une sorte de vert plutôt flashy, presque fluo. A la limite du vert qui me repousse généralement, utilisé ici en repoussoir justement, en réserve, par dessus lequel j'ai bombé au noir, pulvérisant... Quoi au juste? Je ne sais pas. En fait, tout se passe comme si, conscient du fait qu'il se passe plus de "drame" dans une peinture qu'on crée quand on se bat contre ce que l'on n'aime pas (les peintures achevées les plus "décevantes" se révèlent à la longue aussi les plus réussies), je recourais de temps à autre à ce moyen, une couleur qui me donne des boutons, pour me faire réagir, surmonter l'obstacle et à la faveur du combat capter quelque chose d'un drame, d'une intensité. Une forêt sombre par contraste ave ses arbres et ses revenants, êtres étranges luminescents, est ainsi née ici, gagnée sur une couleur servant d'appât.
00:18 Publié dans Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bruno montpied, faire-valoir, couleur verte, peinture automatique, repoussoirs |  Imprimer
Imprimer
22/11/2011
Jeu de familles au Père-Lachaise
Il faut de temps à autre aller visiter le blog du Tampographe Sardon, toujours acide et réjouissant. Il dit habiter rue du Repos, et c'est le long du Père-Lachaise. Des photos de caveaux de famille aux noms choisis, qu'il a mises en ligne au mois d'août, m'ont bien fait rigoler, comme celle ci-dessous (trop belle pour être vraie?):
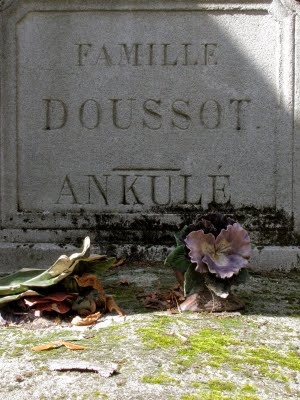
Photo Sardon
N'hésitez donc pas à aller chez lui, et à passer aussi dans les bonnes librairies qui vendent son livre récemment édité de "bons points" à distribuer à tous vos amis ou ennemis.
Extrait des "bons points" du Tampographe Sardon
15/11/2011
Pierre Dange, un Naïf dans un habitat brut
Cela fait quelques années que je collectionne, ou plutôt que j'amasse, en dilettante, des cartes postales anciennes représentant des sites façonnés par des excentriques oubliés, édifices babéliens à la signification perdue, musées de racines sculptées, ou de préhistoire populaire, falaises interprétées, églises psychédéliques avant l'heure, Luna-parks bricolés dans des coins perdus. Sur ce blog j'ai récemment évoqué par exemple l'Auberge des Soeurs Moisy, le Cabaret des Décapités dans l'île de Bréhat, et il y a déjà plus longtemps, le monument aux morts de l'Abbé Cognet, ou le "Tour du Monde Globe de la Paix"...
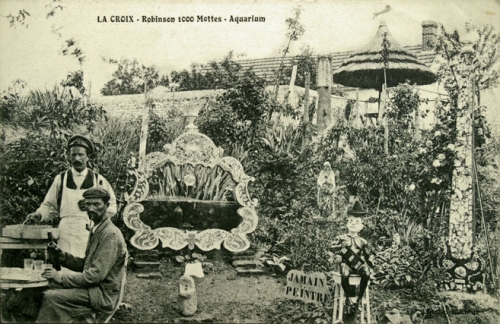
Camille Jamain "Peintre", l'Aquarium de sa "base de loisirs" bricolée, "Robinson 1000 Mottes" anciennement située à La Croix (Indre-et-Loire) ; site disparu dans les années 30 malgré le legs à la commune en 1912...
Ces bouts de papier vieillots sont parfois tout ce qui reste de ces constructions insolites, et aussi, dans d'autres cas, sont les premiers indices d'un site encore à découvrir (sont-ils toujours debout?, se demande l'imagination aiguillonnée par le démon de la curiosité).
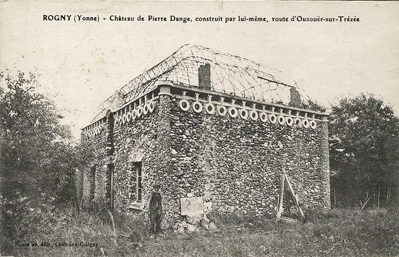
Pierre Dange, son "Château" comme il est dit en légende, coll.BM
Parmi ces cas, se dresse le "château", parfois aussi appelé, de façon toujours aussi grandiloquente ou pompeuse, le "palais artistique" du dénommé Pierre Dange (Ô, le joli nom!) qui était situé "sur la route d'Ouzouër-sur-Trézée", dans une zone proche de Rogny-les-Sept-Écluses, dans l'Yonne. Dans le temps, Feu André Escard, je ne sais plus trop où (peut-être le Bulletin des Amis de François Ozenda?), avait tenté des recherches assez infructueuses sur ce personnage. La revue Gazogène en a aussi parlé dans ses numéros 24 et hors-série "N'oubliez pas l'artiste...", où l'on peut voir d'un numéro à l'autre quatre images rares. Le collectionneur et artiste Jean-Michel Chesné a également très récemment sur son blog apporté quelques renseignements supplémentaires sur le personnage dont on sait que la maison visible sur la carte ci-dessus a disparu. En particulier il a recueilli un intéressant témoignage d'un témoin oculaire qui avait rencontré le sieur Dange (actif au début du XXe siècle) dans les années 1930.
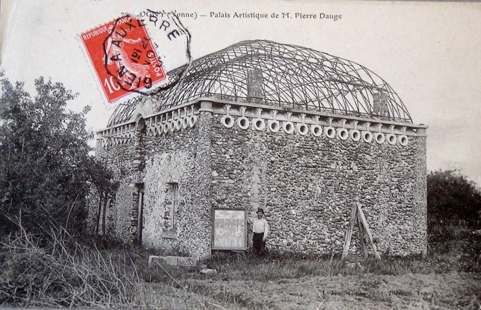
Autre carte montrant ce qui est cette fois appelé le "palais artistique" de Pierre Dange, vers 1910
Pierre Dange, qui apparaît comme un pauvre hère sur les cartes postales représentant son "palais" sans autre toit semble-t-il qu'une charpente d'arceaux métalliques laissée à l'état d'ébauche, Pierre Dange, à ce qui est clairement signifié d'une carte à l'autre était avant tout un peintre. Il pose sur ces cartes à côté de divers tableaux de grand format, qu'il veut à l'évidence faire connaître grâce à ce support de communication populaire qu'était la carte postale en ces années du début de l'autre siècle. Et c'était à mes yeux un grand peintre populaire et naïf. Bien entendu, on aimerait fort voir en vrai ces oeuvres que l'on ne fait que deviner sur les cartes. Avait-il, comme l'écrit Gazogène de son côté, un talent "mystique, inspiré, médiumnique"? C'est peut-être vite dit. Je vais ajouter personnellement ici même une pièce au dossier qui montrera qu'il pouvait aussi traiter des sujets tout à fait profanes, comme ce portrait de vigneron, nommé "Olivier Alfroid", qui est signé de "Pierre Dange" et daté de "mars 1910" (format 75x78 cm), reproduit par mes bons offices ci-dessous.
Pierre Dange, Olivier Alfroid, mars 1910, exposition "Tableaux étranges et naïfs" (1984) ; on notera que le tableau comporte deux signatures, l'une tracée au pinceau et l'autre ciselée dans le bois du cadre ("Par Pierre Dange en mars 1910")
D'où sort ce tableau, me direz-vous? Je l'ai extrait d'un catalogue édité à l'occasion d'une exposition intitulée "Tableaux étranges et naïfs, 1820-1920", sous-titrée "Portraits d'enfants, d'adultes et de maisons", qui s'était tenue à la Galerie Geneviève Rolde à Paris en juin 1984. C'était le marchand de poupées anciennes (et merveilleuses), Alain Renard, qui avait organisé le catalogue, probablement à partir de sa propre collection de tableaux (dans le livre, il ne le dit pas). Ce portrait d'un vigneron, deux fois cerné de grappes de raisin, peintes autour du portrait en médaillon et sculptées sur le cadre, paraît de même style que les peintures que l'on voit sur certaines des cartes postales (surtout celle ci-contre qui représente l'artiste posant à côté d'un tableau représentant un roi ou une reine, elle-même inscrite dans un médaillon surmonté de trois autres personnages ; ce procédé du médaillon paraît récurrent dans le travail de Dange).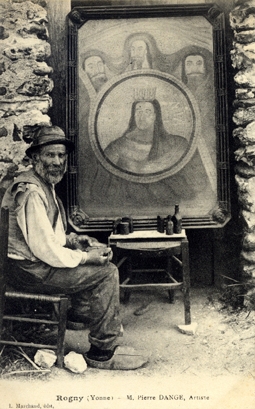 La date de 1910 correspond à l'époque où furent éditées les cartes postales. Enfin, il paraît peu probable qu'il ait pu exister deux Pierre Dange, tous deux peintres naïfs et populaires.
La date de 1910 correspond à l'époque où furent éditées les cartes postales. Enfin, il paraît peu probable qu'il ait pu exister deux Pierre Dange, tous deux peintres naïfs et populaires.
Je suis donc à peu près sûr que nous sommes là en présence d'un tableau non perdu (tout du moins en 1984!) du peintre naïf Pierre Dange, habitant par ailleurs cette très étrange maison de Rogny-les-Sept-Ecluses, au confort plus que sommaire, sans fenêtres apparentes, comme favorisant le repli de son propriétaire concentré sur lui-même...
Qu'est devenu ce tableau? Depuis cette exposition datant de trente ans, c'est difficile à dire. Je n'ai pas d'information là-dessus. Juste cette image à reproduire en ligne. Mais c'est déjà beaucoup.
*
Petit ajout du 17 nov. (que j'espère comme le début d'une longue liste...?):
J'ai suivi le commentaire de Jean-Christophe Belotti apposé après cette note (publiée le 15 novembre), et je reproduis donc ci-dessous une image, à dire vrai assez floue (mais ne soyons pas difficile, car cela cadre bien aussi avec ce genre de sujet) d'un autre tableau signé de Pierre Dange, intitulé "La Denisière à (Rogny?)", un paysage, lui aussi encadré d'un bois sculpté où l'on retrouve des raisins, dont une photo a été mise en ligne par le blog Vasavoir-Afga, qui s'intéresse à l'histoire de la ville de Rogny-les-Sept-Ecluses.

Ph. extraite du site Vasavoir-Afga.
Et puis, ce blog, qui a retrouvé la trace d'une famille Baudrier qui a conservé quelques souvenirs de Pierre Dange, par suite du rachat de sa maison en mauvais état et "quasi en ruines" (à une date non précisée sur le blog, qui reste quand même passablement en survol sur la question malheureusement), ce blog publie aussi un autre document émouvant, la plaque avec le nom DANGE qui se trouvait sur la porte de cette maison étrange (étredange, devrait-on écrire...).

Ph extraite du site Vasavoir-Afga.
23:43 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : pierre dange, cartes postales d'environnements, olivier alfroid, art naïf, art populaire, environnements spontanés, habitants-paysagistes, rogny-les-sept-écluses, camille jamain, alain renard |  Imprimer
Imprimer
13/11/2011
Maria Angelés, dite "Les Petites Peintures" (2)
Hervé Couton retourne régulièrement sur les lieux, non pas de ses crimes, mais de ses découvertes, surtout lorsque celles-ci demandent à être suivies (voir notre note du 29 juin 2010). Comme c'est le cas avec les peintures à même les murs d'un bâtiment désaffecté situé en Espagne, à Arguedas, peintures mêlées d'inscriptions qui évoluent sans cesse, dans un processus qui fait toute la passion de son auteur, Maria Angelés Fernandez, surnommée par ses voisins, "Las Pinturitas" ("Les Petites Peintures"). Je ne m'attribuerai pas le commentaire sur ce travail. Seulement doit-on souligner ici à quel point ce travail en constant renouvellement illustre la spécificité de ce que l'on nomme ailleurs l'art brut, ou de mon côté, l'art immédiat. Un art sans artiste, qui est avant tout action créative, bien avant toute médiation, tout morcélement à des fins commerciales (même si quelque beurre dans les épinards reste souhaitable, cela reste un but secondaire). Il emprunte à ce que l'on appelle ailleurs le street art, mais d'une façon qui me paraît, même si je n'ai jamais vu le lieu originel, très personnelle. Je laisse à présent la parole à Hervé Couton lui-même, qui m'a envoyé le nouveau texte suivant :
La « Pinturitas » d'Arguedas, une artiste hors du commun
Depuis ma découverte du travail pictural de la « Pinturitas » en 2009, je reviens chaque année à Arguedas, en Espagne, pour voir et photographier l'évolution de son œuvre peinte extraordinaire.
Ph. Hervé Couton, 2011
Maria Angeles Fernandez Cuesta dite « Las Pinturitas » (les petites peintures), créatrice instinctive à classer parmi les artistes d'art brut fascinants, poursuit opiniâtrement l'élaboration d'une œuvre colorée originale vouée à l'éphémère car peinte sur un unique support que constituent les murs d'un restaurant désaffecté destiné à la destruction.

Ph. Hervé Couton, 2010
En 2010 j'avais été surpris de constater que les peintures et dessins photographiés en 2009 avaient pratiquement tous disparu dans leur forme originale, parce que modifiés, enrichis de nouveaux apports, ou encore complètement effacés, faute de place, pour permettre l'ajout de nouvelles formes. Le phénomène s'est renouvelé en 2011 si bien que chaque année, on peut assister in situ à une « nouvelle exposition » de son travail qu'elle prend soin, tel le guide de son propre musée, de décrire et d'expliquer en détail avec une réelle passion.
Ph. Hervé Couton, 2010
Dans cet acte de mort et de renaissance de l'œuvre, comme savent souvent le faire les artistes instinctifs, on se trouve confronté à la création artistique absolue, qui semble être la seule préoccupation de Maria Angeles. L'emplacement du bâtiment désaffecté sur lequel elle peint, situé dans un endroit un peu désolé à la sortie d'Arguedas sur la route nationale Pampelune - Zaragosse, lui offre une position stratégique idéale pour échanger régulièrement avec les automobilistes curieux qui s'arrêtent, attirés par cette fresque colorée unique d'environ cinquante mètres de long. Le contact avec ce public de passage procède assurément à un encouragement à poursuivre l'acte de création.
Ph. Hervé Couton, 2011
Depuis 2010, après [qu’on l’eut] encouragée à peindre sur d'autres supports en petit format, des panneaux de bois peints commencent à sortir de sa production, cependant les itérations picturales qu'elle pratique sur la fresque manquent à ces nouvelles œuvres qui sont sans doute à renforcer ; car c'est bien l'apport permanent, en continu qui donne à cet immense tableau mural son caractère extraordinaire et puissant. En marge de la fresque, mais intégrés à l'une des façades peintes, les barreaux de protection de certaines fenêtres du bâtiment continuent d'être des « vitrines » pour présenter de façon dynamique d'autres éléments créatifs que sont des panneaux en carton qu'elle décore, ou tout autres effets personnels lui appartenant.

Ph. H.C. 2011
Sur la fresque actuelle, toujours dominée par la représentation d'animaux et de personnages hallucinants, de nombreux textes aux lettres stylisées en forme de corps d'animaux, se multiplient. Ils illustrent les noms de joueurs de football, des évènements qui l'ont touchée personnellement ou signifient son état civil comme le récurrent « soy de Toledo, 61 anos». Depuis 2010 on peut constater que Maria Angeles vit et crée avec son temps car les noms d'« Internet », « Facebook » ou « Youtube », media qui véhiculent depuis peu son image et son œuvre, peuplent de manière répétitive sa fresque. En effet, un compte au nom de la « Pinturitas » est consultable sur Facebook, des vidéos prises par les automobilistes de passage commencent à être déposées sur Youtube et des articles publiés dans la presse navarraise se font l'écho de cette création atypique.

Photo H.C. 2011
Les blogs les Friches de l'Art et le Poignard Subtil, animés[respectivement] par les spécialistes de l'art brut que sont Joe Ryczko et Bruno Montpied¹, présentent depuis 2010 les informations que je leur ai fournies sur la « Pinturitas ». Grâce au concours de Laurent Danchin, correspondant français de la revue trimestrielle anglo-saxonne d'art brut « Raw Vision », un article sur la « Pinturitas » accompagné des photographies prises en 2009 a pu être publié dans son numéro de l'été 2010 – cet événement rapporté auprès de Maria Angeles en 2010 sous la forme d'un exemplaire de la prestigieuse revue a immédiatement fait l'objet d'une inscription dans un coin de la fresque. A l'issue de cette publication, la Collection de l'Art Brut, musée suisse spécialisé dans cette forme de création et situé à Lausanne m'a contacté et a souhaité obtenir pour son fonds des informations et une vingtaine de mes photographies sur la fresque de Maria Angeles.

Photo H.C. 2010
Sur place, les relations de Maria Angeles « la marginale » avec la population locale semblent s'être apaisées, peut être aussi du fait d'une certaine résonance médiatique de son travail. Les habitants manifestent leur sympathie en l'apostrophant amicalement dans les rues d'Arguedas ou par un coup de klaxon en passant près de l'artiste au travail.
Pour Maria Angeles le travail créateur se poursuit sans relâche, cet être attachant et généreux que la vie n'a pas ménagé et qui produit inlassablement une œuvre forte, originale et très personnelle, mérite bien que son engagement pictural soit de plus en plus connu et reconnu comme celui d'une artiste à part entière².
Hervé Couton – septembre 2011
____
(1). Je ne me présente pas de moi-même comme un "spécialiste", je m'empresse de le préciser. En argot, un spécialiste, c'est un tueur.
(2). Je laisse la responsabilité de cette opinion à son auteur. Que Maria Angelés Fernandez soit ou non reconnu comme artiste (avec tout ce que cela implique de professionalisation, de séparation avec le reste de la population) n'est pas du tout ma tasse de thé. C'est même à mes yeux complètement contre-productif, et constitue un contresens.
30/10/2011
Une collection d'art immédiat dans "L'Or aux 13 îles" n°2, et un vernissage le 6 novembre prochain
L'Or aux 13 îles, je vous en ai déjà parlé lorsqu'était sorti en janvier 2010 son n°1 qui concernait grandement les passionnés d'art populaire brut et des environnements spontanés parce qu'y était inséré un dossier volumineux sur le musée disparu de l'abbé Fouré consacré à ses bois sculptés à Rothéneuf (ce fut l'occasion surtout de republier un document rare, le Guide de ce petit Musée étonnant, guide paru en 1919 ; par la même occasion, nous commémorâmes ainsi -les premiers!- le centième anniversaire de la disparition de l'abbé, mort en 1910).
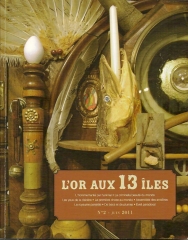 Voici que paraît son n°2 (cliquez sur ce lien et vous obtiendrez le formulaire de commande du numéro, voire des deux numéros), cette fois dominé par un thème "L'homme hanté par l'animal". Jean-Christophe Belotti est toujours aux commandes du navire, Vincent Lefèvre est toujours le maquettiste, élément important qui assure à la revue sa belle et élégante livrée. Le sommaire est varié, après une introduction de Belotti sur le pourquoi du comment du thème choisi, qu'il a illustrée de fort charmantes cibles foraines tchécoslovaques, on découvre les magnifiques photographies d'oiseaux naturalisés de Pierre Bérenger qu'il fit à la fin des années 1960 dans les locaux alors désaffectés du Museum d'Histoire Naturelle, avant que ce dernier lieu ne soit restauré et transformé en Grande Galerie de l'Evolution (comme le rappelle François-René Simon dans son texte de présentation). Suivent divers textes de Vincent Bounoure, Anne Fourreau et Jean-Yves Bériou. Je m'arrête plus particulièrement sur les dessins d'une certaine Mélanie Delattre-Vogt.
Voici que paraît son n°2 (cliquez sur ce lien et vous obtiendrez le formulaire de commande du numéro, voire des deux numéros), cette fois dominé par un thème "L'homme hanté par l'animal". Jean-Christophe Belotti est toujours aux commandes du navire, Vincent Lefèvre est toujours le maquettiste, élément important qui assure à la revue sa belle et élégante livrée. Le sommaire est varié, après une introduction de Belotti sur le pourquoi du comment du thème choisi, qu'il a illustrée de fort charmantes cibles foraines tchécoslovaques, on découvre les magnifiques photographies d'oiseaux naturalisés de Pierre Bérenger qu'il fit à la fin des années 1960 dans les locaux alors désaffectés du Museum d'Histoire Naturelle, avant que ce dernier lieu ne soit restauré et transformé en Grande Galerie de l'Evolution (comme le rappelle François-René Simon dans son texte de présentation). Suivent divers textes de Vincent Bounoure, Anne Fourreau et Jean-Yves Bériou. Je m'arrête plus particulièrement sur les dessins d'une certaine Mélanie Delattre-Vogt.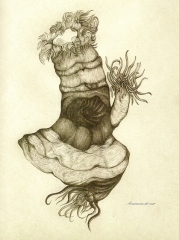
Puis suit un grand dossier sur Pierre Peuchmaurd, poète estimable disparu tout récemment (comme dans le n°1 était inséré un dossier sur Jean Terrossian). Les poèmes nombreux sélectionnés par Belotti dans l'œuvre de Peuchmaurd ont tous un lien avec l'animal.
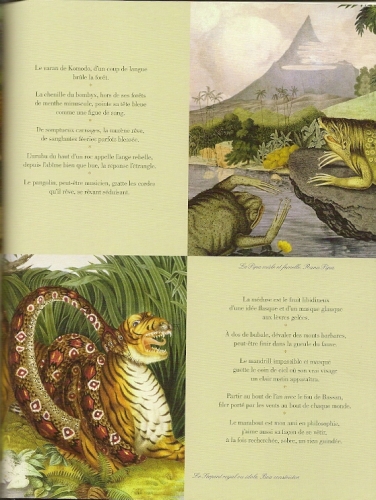 Des poèmes inédits de Guy Cabanel sont flanqués d'aquarelles d'Aloys Zötl, extraites du livre de Victor Francés récemment paru aux éditions Langlaude (Contrées d'Aloys Zötl, à un prix défiant toute concurrence grâce à des Chinois sous-payés), cet obscur teinturier autrichien qui se passionna de 1831 à 1887 pour des animaux qu'il dessinait plus réels qu'en vérité, les plaçant dans des décors naturels peu réalistes mais somptueusement veloutés et d'une puissance de suggestion sur l'imagination à nulle autre pareille.
Des poèmes inédits de Guy Cabanel sont flanqués d'aquarelles d'Aloys Zötl, extraites du livre de Victor Francés récemment paru aux éditions Langlaude (Contrées d'Aloys Zötl, à un prix défiant toute concurrence grâce à des Chinois sous-payés), cet obscur teinturier autrichien qui se passionna de 1831 à 1887 pour des animaux qu'il dessinait plus réels qu'en vérité, les plaçant dans des décors naturels peu réalistes mais somptueusement veloutés et d'une puissance de suggestion sur l'imagination à nulle autre pareille.
Ce numéro 2 est aussi pour moi l'occasion d'entrouvrir une porte sur une collection "d'art immédiat" dans le texte de 40 pages que j'ai intitulé Le Royaume parallèle.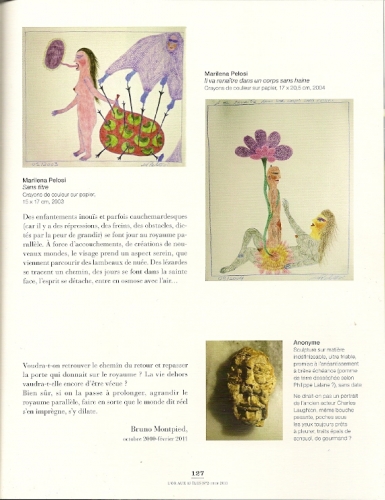 Dérivant derrière cette porte, j'invite le lecteur à découvrir des créateurs aussi variés que Guy Girard, Marilena Pelosi, Gérald Stehr, Armand Goupil, le sergent Louis Mathieu, le peintre naïf Louis Roy, le "patenteux" québécois Charles Lacombe, Christine Séfolosha, divers pratiquants de l'atelier pour handicapés mentaux de la Passerelle (l'atelier animé par Romuald Reutimann à Cherbourg), des objets d'art populaire anonyme, des collages d'un "anonyme américain" (que j'ai identifié depuis peu grâce à l'amabilité de Frédéric Lux comme étant de l'autodidacte américain Javier Mayoral, voir le blog de Laurent Jacquy Les Beaux Dimanches qui y parle d'un blog tenu par ce créateur, appelé Locus Solus 1 où Mayoral parle de ses créations très diverses, ex-voto décalés, catcheurs, phénomènes à la Barnum ; le monsieur en question paraît beaucoup jouer de la distanciation tout en restant friand d'ingénuité: curieux!), un jeu de massacre forain, une poupée rescapée de tribulations dans des greniers oubliés, Jean Estaque, Serge Paillard, l'inévitable et mirifique Joël Lorand, Jean-Louis Cerisier, soit autant de figures ou de sujets que les lecteurs fidèles et attentifs du Poignard reconnaîtront sans coup férir comme rôdeurs dans ces parages...
Dérivant derrière cette porte, j'invite le lecteur à découvrir des créateurs aussi variés que Guy Girard, Marilena Pelosi, Gérald Stehr, Armand Goupil, le sergent Louis Mathieu, le peintre naïf Louis Roy, le "patenteux" québécois Charles Lacombe, Christine Séfolosha, divers pratiquants de l'atelier pour handicapés mentaux de la Passerelle (l'atelier animé par Romuald Reutimann à Cherbourg), des objets d'art populaire anonyme, des collages d'un "anonyme américain" (que j'ai identifié depuis peu grâce à l'amabilité de Frédéric Lux comme étant de l'autodidacte américain Javier Mayoral, voir le blog de Laurent Jacquy Les Beaux Dimanches qui y parle d'un blog tenu par ce créateur, appelé Locus Solus 1 où Mayoral parle de ses créations très diverses, ex-voto décalés, catcheurs, phénomènes à la Barnum ; le monsieur en question paraît beaucoup jouer de la distanciation tout en restant friand d'ingénuité: curieux!), un jeu de massacre forain, une poupée rescapée de tribulations dans des greniers oubliés, Jean Estaque, Serge Paillard, l'inévitable et mirifique Joël Lorand, Jean-Louis Cerisier, soit autant de figures ou de sujets que les lecteurs fidèles et attentifs du Poignard reconnaîtront sans coup férir comme rôdeurs dans ces parages...
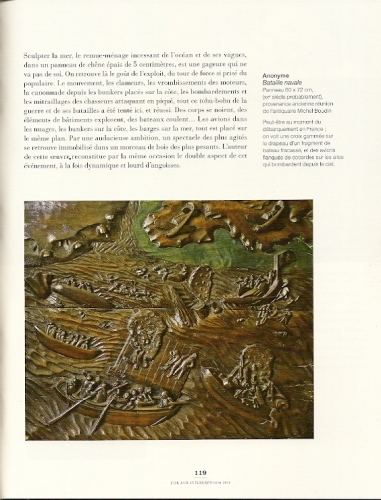 A noter que je viendrai à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre à 15h le dimanche 6 novembre (dans une semaine donc) en compagnie de Jean-Christophe Belotti qui dédicacera ce numéro tandis que je proposerai aux personnes présentes une dérive en une centaine d'images sur cette collection d'art immédiat (cela ne se limitera pas, étant donné le nombre, aux images présentes dans la revue). A bientôt donc.
A noter que je viendrai à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre à 15h le dimanche 6 novembre (dans une semaine donc) en compagnie de Jean-Christophe Belotti qui dédicacera ce numéro tandis que je proposerai aux personnes présentes une dérive en une centaine d'images sur cette collection d'art immédiat (cela ne se limitera pas, étant donné le nombre, aux images présentes dans la revue). A bientôt donc.
Les illustrations qui accompagnent cette note sont, pour ce qui concerne les dernières des pages extraites de la revue.
20:29 Publié dans Art Brut, Art de l'enfance, Art forain, Art immédiat, Art inclassable, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art populaire insolite, Art singulier, Confrontations, Environnements populaires spontanés, Littérature, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : l'or aux 13 îles n°2, jean-christophe belotti, art immédiat, bruno montpied, armand goupil, marilena pelosi, joël lorand, gérald stehr, hérold jeune, la passerelle, maugri, jean-lous cerisier, charles lacombe, sefolosha, émilie henry, louis roy, art naïf, lobanov, donadello, sirènes, manero, ruzena, bernard javoy, serge paillard, monique le chapelain, pépé vignes, paul duhem, javier mayoral, guy girard |  Imprimer
Imprimer
18/10/2011
Des jardins anarchiques aux étudiants en architecture de Belleville
Suite de la tournée de présentation du livre et du film dont je vous abreuve sur ce blog depuis un certain temps, aura lieu vendredi 21 octobre, à la fin de cette semaine, une nouvelle séance de présentation à 19h à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville (60, bd de la Villette, 19e), avec mézigue et Remy Ricordeau.
Ce sera peut-être, entre autres, l'occasion de relever ce qui, outre les habitats plus purement paysagistes, relèverait plus précisément de l'architecture dans les environnements évoqués dans le livre et le film. Dans une liste provisoire, je citerais ici le jardin de colonnades d'objets récupérés (ou réemployés comme on dit aujourd'hui de façon plus neutre) de Bohdan Litnianski, la maison de Mme C. (dont on voit un détail sur l'affiche ci-dessus de la manifestation dont je vous cause), la Tour Eiffel de M. Henri Travert, l'habitat troglodytique de Bernard Roux, le Palais Idéal de Cheval, la maison de Monsieur G., le Jardin de Nous Deux de Pauline et Charles Billy, les cabanes du meunier Debord, l'Eglise vivante et Parlante du curé Paysant, le petit musée privé de la famille Montégudet, la fantaisie médiévale de Joseph Meyer, sans compter les fresquistes en mosaïque ou peinture qui recouvrent leurs maisons d'une prolifération de décors colorés.

Tour Travert dans le Maine-et-Loire, ph. Bruno Montpied, 2003
10:20 Publié dans Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ensba, bricoleurs de paradis, eloge des jardins anarchiques, remy ricordeau, bruno montpied, environnements spontanés, tour travert, troglodytes, architecture spontanée |  Imprimer
Imprimer
14/10/2011
Albasser à La Rochelle depuis la Saint-Bruno
Pierre Albasser continue de produire à la régularité d'un métronome, là-bas du côté des tours de La Rochelle, une œuvre assez proche de celle d'un Gaston Chaissac, assez proche quoique pas identique pour autant.
Pierre Albasser, Je garde, 2005
J'évoque souvent son cas (sur papier, dès ses premières expositions au musée de la Création Franche, en 1999, comme sur ce blog), et son travail qui demande, comme une contrainte librement assumée (il pourrait incarner à lui tout seul un membre autodidacte et anarchique de l'OUPEINPO), d'être exécuté sur des papiers ou cartonnages d'emballage alimentaire, avec des instruments de traçage qui soient gratuits, feutres usagés, stylos hors d'âge, marqueurs exsangues...
PA, Sans titre, 2007 (cette œuvre, et celle au-dessus, ainsi que la troisième ci-dessous ne sont pas forcément exposées à La Rochelle actuellement)
Les résultats sont assez erratiques et vagabonds. Des grosses têtes aux yeux dilatés, des écritures abstraites, des entrelacs possédés d'une sorte d'ivresse de la recherche de forme, des esquisses de totems parfois... En tout cas, un goût extrême de la dérive graphique qui se joue des cadres imposés (de la part de quelqu'un qui fut lui-même un cadre) et plus généralement peut-être du support même de nos vies contraintes. Le choix que fait Albasser de s'imposer une contrainte n'est là semble-t-il que pour montrer sa liberté à l'œuvre, sa capacité de dépassement.
En tout cas, un goût extrême de la dérive graphique qui se joue des cadres imposés (de la part de quelqu'un qui fut lui-même un cadre) et plus généralement peut-être du support même de nos vies contraintes. Le choix que fait Albasser de s'imposer une contrainte n'est là semble-t-il que pour montrer sa liberté à l'œuvre, sa capacité de dépassement.
Expo Pierre Albasser à la Galerie Brigitte Ruffin - Art Espace 83 du 6 octobre (St-Bruno) au 5 novembre 2011, 83, ave du 11 novembre, 17000 La Rochelle. Tél: 06 14 81 48 81. E-mail: brigitteruffin@art-espace83.com. Pendant cette manifestation, est annoncé un "colloque autour de l'art singulier", le 22 octobre avec, seule faute de casting, Jean-François Maurice à 17h.

Pierre (le créateur) et Gudrun Albasser (créatrice et impresario), 2008, sur la Côte Sauvage, ph. Bruno Montpied
10:57 Publié dans Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pierre albasser, art singulier, art immédiat, création franche, galerie brigitte ruffin-art espace 83, automatisme dans l'art singulier |  Imprimer
Imprimer
04/10/2011
Un Monch et un Paillard s'exhibent à Montreuil
Hasard du calendrier et des événements, deux créateurs fort inventifs vont bientôt pouvoir montrer aux curieux leurs productions que personnellement j'apprécie déjà hautement, sans attendre l'assentiment général. Dans la même ville, le même week-end, c'est-à-dire dans le XXIe arrondissement de Paris à Montreuil-sous-Bois.
Cela se passera les 15 et 16 octobre après-midi pour Serge Paillard, 12, rue des Sorins (c'est près du métro Croix-de-Chavaux). C'est dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d'artistes de cette bonne ville. Serge Paillard expose depuis quelques années les images qu'il confectionne de retour de ses explorations dans un pays imaginaire créé par lui, la Patatonie. On nous promet rue des Sorins que l'on pourra à nouveau observer des "merveilles archéologiques" venues de cette Patatonie, "objets divers, gravures galactiques, empreintes pariétales, spectres circonspects, autant de fenêtres sur l'infini peaufinées par un vitrier hors circonstance, artiste extravagant, métaphysicien en culotte courte" (Jean-Claude Leroy). Peut-être seront-elles assez semblables aux dessins à l'encre ci-dessous.
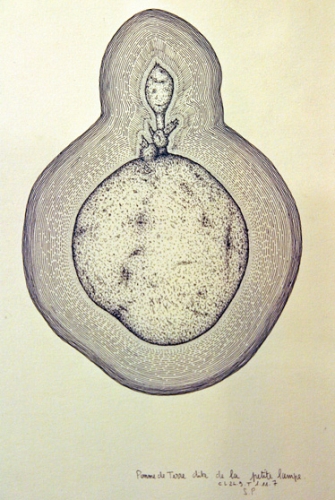 Serge Paillard, Pomme de terre dite de la petite lampe, 2007
Serge Paillard, Pomme de terre dite de la petite lampe, 2007
SP, Pomme de Terre en Cosmos, 2007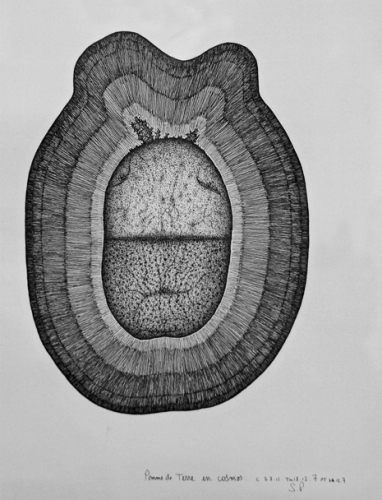
Ces Portes Ouvertes sont donc également un autre prétexte d'exhibition pour les travaux photographiques de Monch, que j'avais découverts je ne sais plus trop comment, par son intermédiaire direct je crois, par mail, voici déjà quelque temps. J'aime beaucoup le travail de celui-ci, tel qu'on peut le découvrir sur son site web. Surtout parce qu'il travaille sur les formes naturelles, des pierres ou du bois, faisant des séries de photos non retouchées des formes visionnarisées dans la nature (l'angle de vue, et l'instant où l'éclairage est propice, sont autant de "retouches" apportées au réel, ce qui remet quelque peu en cause l'aspect de "non retouché" absolu, qui est une vue de l'esprit en définitive ; il y a finalement toujours une projection de l'esprit du photographe). Ces visions naturelles, il les appelle des pareidolies, je ne connaissais pas le mot (pour la définition, allez faire un petit tour sur Wikipédia).
faisant des séries de photos non retouchées des formes visionnarisées dans la nature (l'angle de vue, et l'instant où l'éclairage est propice, sont autant de "retouches" apportées au réel, ce qui remet quelque peu en cause l'aspect de "non retouché" absolu, qui est une vue de l'esprit en définitive ; il y a finalement toujours une projection de l'esprit du photographe). Ces visions naturelles, il les appelle des pareidolies, je ne connaissais pas le mot (pour la définition, allez faire un petit tour sur Wikipédia). Monch, connaissant les limites de l'objectivité humaine en matière de regard, compose aussi des séries de photos sciemment retouchées (mais si peu). Le photographe joue alors à se mesurer davantage avec l'inconscient naturel dans lequel il avait commencé à se plonger avec innocence (mais y a-t-il un inconscient naturel?).
Monch, connaissant les limites de l'objectivité humaine en matière de regard, compose aussi des séries de photos sciemment retouchées (mais si peu). Le photographe joue alors à se mesurer davantage avec l'inconscient naturel dans lequel il avait commencé à se plonger avec innocence (mais y a-t-il un inconscient naturel?).
Monch, Mais où est passée Mère-Grand
Une autre série sur le site de Monch concerne des portraits interprétés, réalisés à partir de photos que lui ont confiées volontairement divers amis ou relations. Je me suis personnellement prêté au jeu. Un des résultats de la métamorphose que m'a fait subir Monch est paru dans la revue L'Or aux 13 îles n°2 dont je parlerai bientôt sur ce blog. Voici l'autoportait de Monch de cette série:
Monch, Retour aux racines...
Comme on le voit, amateurs de poésie naturelle et autres pareidolies, le monsieur a un certain talent qui mérite un petit détour par Montreuil. Monch, 14h-20h, 15-16-17 octobre (vernissage le 15, à partir de 14h), à l'Usine Chapal, 2, rue Marcellin Berthelot, Esc. D, 4e étage, M° Crois-de-Chavaux, Montreuil.
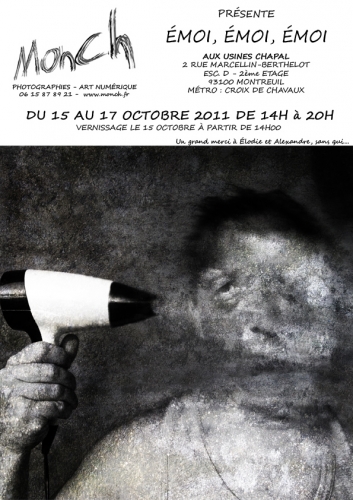
Annonce expo Monch, "Emoi, émoi, émoi"
00:06 Publié dans Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art singulier, Photographie, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : monch, poésie naturelle, pareidolies, photographie modifiée, serge paillard, art singulier, patatonie |  Imprimer
Imprimer
30/09/2011
Les femmes à l'honneur, Marie et Judith, des branches et des cocons
Le hasard veut qu'aux cimaises de deux lieux voués à l'art, à Cahors et à Paris, vont être montrées au même moment deux créatrices que l'on peut ranger toutes deux dans l'art brut, Marie Espalieu (1923-2007) qui sculptait les morceaux de bois qu'elle trouvait dans les châtaigneraies du Ségala (dans le Lot), et Judith Scott, auteur d'intriguants et remuants "cocons" (c'est moi qui les appelle ainsi) aux USA (elle est défendue par les animateurs du Creative Growth Center qui comme je l'avais signalé en son temps avaient ouvert durant une courte période la Galerie Impaire à Paris).

Sculptures de Marie Espalieu (photo Nelly Blaya), reproduite ssur l'affiche de l'expo "L'Esprit des Branches" au musée Henri Martin à Cahors du 15 octobre 2011 au 31 janvier 2012
Marie Espalieu est exposée bientôt avec environ 120 sculptures au musée Henri Martin de Cahors. Un catalogue (et ici je cite le blog de J-M. Chesné), "réalisé par Jean-Michel Chesné sous la houlette", notamment, du conservateur du lieu, Laurent Guillaut, sort à cette occasion, apparemment cette fois davantage centré sur des reproductions des sculptures peintes de cette dame que dans les publications qui ont précédemment parlé de cette créatrice (c'est du moins ce que je souhaite, comme je l'ai déjà dit). N'est-ce pas en effet l'essentiel, révéler d'abord à quoi ressemblent les statues que cette dame nous a laissées, plutôt que d'apprendre sur l'air des lampions qu'elle a été photographiée par le célèbre Doisneau?
Judith Scott, fil et matériaux divers, expo à la Galerie Impaire en juin 2008 (rien ne dit que cette pièce fera partie des oeuvres bientôt exposées au Collège des Bernardins à Paris), ph. Bruno Montpied
Pour Judith Scott (1943-2005), c'est moins d'oeuvres (une douzaine sont annoncées), mais qu'importe la quantité en ce qui la concerne. Ses emberlificotages sont tellement prenants, au delà de la surprise déroutée qu'ils font de prime abord naître, que le nombre n'a aucune importance. Dans le Collège des Bernardins qui les accueille du 11 octobre au 18 décembre 2011, dans cet espace quelque peu ascétique et désincarnée, nul doute que le contraste jouera en faveur des cocons de Mlle Scott, et qu'ils persisteront à cheminer longtemps dans le coeur des spectateurs présents. Et cela n'aura rien à voir, n'en déplaise au commentateur qui a pondu le texte du dossier de presse, avec le reste de l'art contemporain. Parce que toute la personne de cette créatrice (non, nous ne sommes pas dans le cas de figure d'une "artiste", une fois de plus avec l'art brut) est investie dans l'objet produit (l'objet, pas "l'œuvre", monsieur le chargé de communication), mystérieusement, inexplicablement. Sans le moindre recul, sans la moindre distance.
Photo communication Collège des Bernardins
Pour plus d'informations sur l'expo Judith Scott, cliquez sur les termes "dossier de presse" (surlignés) ci-dessus. Et pour une biographie voir le site de Creative Growth Center aux USA. Une programmation "d'événements" est également prévue au Collège des Bernardins: 17 octobre: « A la frontière de l’art : les sculptures de Judith Scott ? », conférence avec Tom Di Maria, Bruno Decharme, et Barbara Safarova, 20h-22h. 9 novembre « L’art de la dissimulation : la notion de "secret" dans l’œuvre de Judith Scott », conférence avec Jean de Loisy, Jérôme Alexandre, et Bertrand Hell, 20h-22h. 11 décembre, visite guidée de l’expo avec le directeur du Creative Growth Center, Tom Di Maria.
00:10 Publié dans Art Brut, Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie espalieu, judith scott, collège des bernardins, musée henri martin |  Imprimer
Imprimer
18/09/2011
Nuit des musées à la Collection de l'Art Brut avec les Bricoleurs de paradis
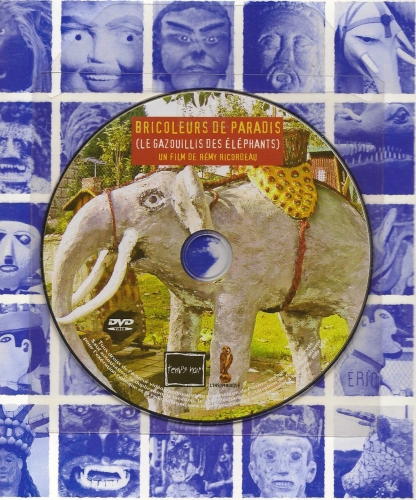 La Collection de l'Art Brut propose de projeter Bricoleurs de paradis (le Gazouillis des Eléphants) samedi 24 septembre prochain, et ce à trois reprises dans la soirée, la fermeture de la Collection n'étant pas prévue avant 2 heures du mat'...
La Collection de l'Art Brut propose de projeter Bricoleurs de paradis (le Gazouillis des Eléphants) samedi 24 septembre prochain, et ce à trois reprises dans la soirée, la fermeture de la Collection n'étant pas prévue avant 2 heures du mat'...
La projection, comme à l'occasion de précédentes présentations, sera précédée de courts speechs du réalisateur et du coauteur du film, très honorés de se déplacer pour l'événement. Cela permettra de transporter quelques nouveaux cas d'inspirés du bord des routes dans les locaux de la célèbre Collection suisse, où ce type de créations n'était pas revenu depuis un certain temps. Un petit débat est prévu après chaque séance. Et rappel encore, on trouve à la librairie de la Collection d'art brut quelques exemplaires d'Eloge des Jardins Anarchiques où l'on trouve le DVD du film sous un rabat (voir ci-dessus).
Quelques nouvelles de la Collection par la même occasion: La Collection abrite encore pour quelques jours une exposition consacrée au graffiteur Nanetti, qui avait gravé les murs de son hôpital psychiatrique à Volterra. Un fort beau catalogue a été édité à cette occasion (on peut se référer aussi au livre en italien et en anglais de Gustavo Giacosa, Noi quelli della parola che sempre cammina, éd. Contemporart edizioni, 2010 où Nanetti est évoqué en même temps que d'autres écrivants bruts, Riccio, Bosco, Helga Goetze, Babylone, Torrighelli). Par ailleurs, on apprend aussi qu'un masque de Maisonneuve, le Diable, a fait l'objet d'un prêt au musée de Zoologie de Lausanne pour l'exposition qui a débuté le 20 mai de cette année dans cette institution, Gare aux coquilles!, prévue pour s'achever le 30 octobre prochain.
Pascal-Désir Maisonneuve, Le Diable, hauteur 25 cm, vers 1927-1928, Collection de l'Art Brut, Lausanne, ph. Claude Bornand
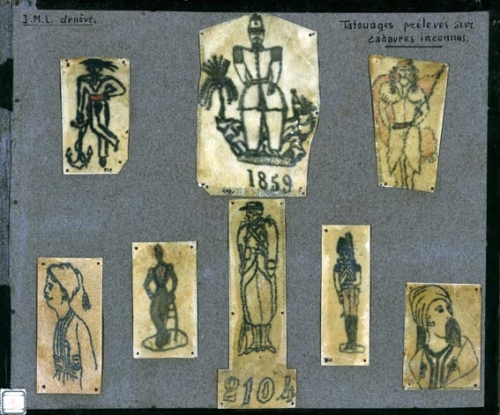
Tatouages sur peau, provenant de cadavres inconnus, fin XIXe, 36,4x44,2x1,5cm, ph.Arnaud Conne, Collection de l'Art Brut, Lausanne
Autre actualité extrêmement intéressante, c'est le prêt de tatouages sur peau, également en provenance de la collection de l'Art Brut, mais cette fois plus précisément depuis ses archives, ainsi que d'une photo sur le même sujet (une évasion de forçats) pour l'expo consacrée au thème de la peau à la Fondation Verdan (qui est aussi le Musée de la Main...), toujours à Lausanne (elle a commencé le 15 juin et se terminera le 29 avril 2012). Je ne savais personnellement pas −où je l'avais oublié...− que la Collection abritait de telles oeuvres (probablement récoltées par Dubuffet dans les débuts de sa prospection en vue d'établir une collection représentative de ce qu'il cherchait obscurément à défendre depuis les années 40). Cela me confirme dans le récent parallèle que j'ai tiré entre les dessins de Monsiel et les tatouages du bagnard Ricardo photographié par Doisneau dans le cadre du séminaire organisée par Barbara Safarova au Collège international de philosophie, où je voulais tresser des passerelles de l'art populaire à l'art brut. A noter (inscrivez-le sur vos tablettes, car ça m'étonnerait que j'y revienne!) que le 13 mars 2012 à 18h30, Michel Thévoz himself viendra dans le cadre de cette expo faire une conférence sur "la peau surface d'inscription" ; on se souvient, enfin les vieux de la vieille dans mon genre..., que Michel Thévoz a du reste publié un livre sur "le corps peint" chez Skira, en 1984, soit il ya des lunes...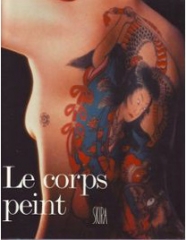
18:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Graffiti | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : environnements spontanés, bricoleurs de paradis, collection ce l'art brut, nuit des musées, nanetti, tatouages, graffiti, pascal-désir maisonneuve, michel thévoz |  Imprimer
Imprimer
12/09/2011
Rendez-vous samedi 17 au matin à l'INHA, à la découverte des premiers environnements spontanés, et des sites de Bohdan Litnianski et de Gabriel Albert
18:31 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberta trapani, environnements spontanés, bruno montpied, marielle magliozzi, michel valière, bohdan litnianski, gabriel albert, crab |  Imprimer
Imprimer
04/09/2011
A Clermont-Ferrand pour écouter le gazouillis des éléphants
Nouvelle occasion pour les amateurs de tous poils de venir discuter avec les auteurs du film Bricoleurs de paradis: ce sera à Clermont-Ferrand, samedi 10 septembre à 20h30, au cinéma le Rio, situé 178 rue Sous les Vignes, dans la bonne ville rouge et noire au dessous du volcan, où le film sera projeté, et le livre Eloge des jardins anarchiques mis en vente pour ceux qui souhaiteraient garder de la documentation sur la question des environnements naïfs (je rappelle que le film Bricoleurs de paradis (le gazouillis des éléphants) est édité en DVD dans le livre). En première partie, nous souhaitons aussi passer le film de Jacques Brunius, Violons d'Ingres (de 1939). En cas d'indisponibilité de ce dernier, nous passerions Le Faiseur de marmots de Jacques Malnou et Catherine Varoqui, consacré à François Michaud, sculpteur naïvo-brut de la Creuse entre 1850 et 1880. Les projections devraient durer environ une heure trente.
Pierre Maïllis-Laval, l'opérateur du film et Remy Ricordeau pendant le tournage de Bricoleurs de paradis, chez Yvette et Pierre Darcel en Bretagne, ph. Bruno Montpied, juillet 2010
15:41 Publié dans Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bricoleurs de paradis, remy ricordeau, cinéma le rio, environnements spontanés, françois michaud, pierre darcel, jacques brunius, violons d'ingres |  Imprimer
Imprimer
03/09/2011
Un corps exquis en morceaux
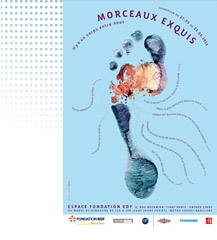
Il n'y a pas à barguigner, l'expo qui s'achèvera le 25 septembre à l'Espace Fondation EDF, rue Récamier à Paris dans le 6e ardt, est un fort beau cabinet de curiosités. Le prétexte de ce rassemblement d'objets insolites, venus de divers arts populaires autour de la Méditerranée, est le corps, à travers les objets, mais aussi les dictons ou proverbes piochés dans des langues elles aussi diverses. Voici du reste un petit florilège de ces proverbes ou maximes:
Un cerveau vide est la boutique du diable (anglais) ; Quand tu traverses le pays des aveugles, ferme un oeil (roumain) ; Écoute ce qui est bien dit, même venant d'un ennemi (grec) ; La timidité est la prison du coeur (espagnol) ; Le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ventre (arabe) ; La vie d'un homme est semblable à un oeuf dans les mains d'un enfant (portugais) ; Le mensonge a les jambes courtes, il n'ira pas loin (tchèque) ; La beauté est à fleur de peau mais la laideur va jusqu'à l'os (anglais).
Mais c'est en même temps une surprise que de voir tout à coup resurgir dans cette exposition des objets extirpés des collections de l'ancien musée des arts et traditions populaires, autrefois ouvert au public dans le bois de Boulogne et maintenant, selon la rumeur, embastillée dans des caisses ou des entrepôts on ne sait trop où, entre Paris et Marseille. Sur le web, pendant plusieurs années (depuis 2003, je crois), on avait l'impression que le nouveau musée, rebaptisé de l'acronyme ronflant de MUCEM (Musée des Civilisations Européennes et Méditerranéennes), n'était qu'une réalisation virtuelle, tant le chantier du nouveau bâtiment transparent conçu par l'architecte Ricciotti tardait à sortir de terre. La collection incroyablement riche des ex-ATP, armoires normandes, pichets berrichons, poteries berbères, charettes siciliennes, objets de dévotion, quilles de conscrits, ouvrages en cheveux, ex-voto yougoslaves, etc., végètait depuis pas mal de temps, attendant l'année 2013 et le projet de Marseille ville de la culture.
Chantier du MUCEM à côté du fort St-Jean, près du port de Marseille, ph. A. Laurençon-Picca
Justifié par l'ambition de bâtir un trait d'union muséal entre civilisations populaires du sud et du nord, le nouveau musée a vu cependant sa première pierre posée par Frédéric Mitterrand en 2009. Le chantier a commencé... Mais n'est-ce pas un rêve un peu trop grand? Surtout à l'heure où l'indifférence pour la culture populaire ancienne, la rurale, paraît atteindre des sommets. Curieusement, le MIAM, Musée International des Art Modestes, au projet très voisin de certains du MUCEM (un des collectionneurs-fondateurs du MIAM, Bernard Belluc a du reste monté une petite exposition, vers 2006, dans des locaux provisoires du nouveau MUCEM au fort St-Jean), MIAM lui aussi implanté dans le Midi, à Sète, avec des ambitions plus... modestes, réussit davantage à faire connaître son discours auprès des amateurs d'art populaire contemporain. Peut-être parce qu'il est avant tout affaire de gens passionnés et réalistes (Di Rosa, Belluc, Pascal Saumade), et non de bureaucrates caressant du fond de leurs placards des rêves mégalos seulement destinés à se faire bien voir d'une poignée de professionnels muséaux, et plus secrètement encore, de la part des politiques (François Fillon a réaffirmé son soutien à la création du MUCEM), destinés à couvrir d'un voile culturel le désir de donner un coup d'accélérateur libéral au marché étendu à une nouvelle Méditerranée des "printemps arabes".
Il est cependant agréable de revoir certains objets resurgis des malles et des coffres où on les avait enfouis dans cette expo de "Morceaux exquis": Cape de pluie sarde tressée de pailles, hésitant entre l'apparence d'une figure de carnaval quotidien et un épouvantail noyé dans la brume, coloquinte en forme de nez de Pinocchio (ci-dessous, provenant de France, XVIIIe-XIXe siècle, cliché Christophe Fouin, coll MUCEM), œil amulette, ex-voto d'argent ou de cire, dessins du bagnard Lagrange, chefs-d'œuvre de sabotier, poupée d'envoûtement, pain sculpté de Calabre, têtes de marionnettes, accessoire pédologique insolite de clown, enseigne de gantier à la main rouge géante (prêtée par le musée rural des arts populaires de Laduz, enfin reconnu à sa juste valeur ici, pour la qualité de ses collections), et en particulier parmi tant d'autres objets insolites, deux sculptures, celles d'Adam et Eve par le sculpteur autodidacte Fernand Duplan (ci-dessous, pierre sculptée et peinte vers 1970 à Ruoms en Ardèche, coll MUCEM, © Christophe Fouin),
œil amulette, ex-voto d'argent ou de cire, dessins du bagnard Lagrange, chefs-d'œuvre de sabotier, poupée d'envoûtement, pain sculpté de Calabre, têtes de marionnettes, accessoire pédologique insolite de clown, enseigne de gantier à la main rouge géante (prêtée par le musée rural des arts populaires de Laduz, enfin reconnu à sa juste valeur ici, pour la qualité de ses collections), et en particulier parmi tant d'autres objets insolites, deux sculptures, celles d'Adam et Eve par le sculpteur autodidacte Fernand Duplan (ci-dessous, pierre sculptée et peinte vers 1970 à Ruoms en Ardèche, coll MUCEM, © Christophe Fouin), et un outil sculpté de Xavier Parguey, qui entra avec d'autres œuvres dans la collection initiale d'art brut de Jean Dubuffet, avant d'y être oublié...
et un outil sculpté de Xavier Parguey, qui entra avec d'autres œuvres dans la collection initiale d'art brut de Jean Dubuffet, avant d'y être oublié...
Pupazza, femme à trois seins, pain sculpté, provenance Calabre, vers 1960, dépôt du Musée de l'Homme, © MUCEM, ph Christophe Fouin
Dommage cependant que le catalogue ait été conçu de façon vraiment un peu trop cheap, dans une maquette des plus banales, et surtout sans beaucoup d'illustrations.
15:29 Publié dans Art forain, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Confrontations, Curiosités, modifications et divertissements langa, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fondation edf, morceaux exquis, mucem, marseille 2013, miam, fernand duplan, xavier parguey, art populaire, musée de laduz |  Imprimer
Imprimer
27/08/2011
Kadhafi squelettisé et bandit manchot emplumé
Dans la transmission récente de photos estivales d'un genre particulier, mais bien plus réjouissantes que les usuelles, le hasard (qui n'existe pas comme on sait) a voulu que me parviennent deux effigies au garde-à-vous qui ont pour point commun, outre une rigidité longiligne, celui de venger, au moins symboliquement de vieilles haines à l'égard de figures répressives. L'une vient de Tripoli, et l'autre du XIVe ardt de Paris.
Ph. Tahar Hani, source France 24 (signalée par Régis Gayraud); vision prophétique de Kadhafi par un bricoleur spontané des rues prénommé Mohamed
Apparition nocturne, rue Gazan (XIVe ardt), punition à base de goudron et plumes sur la personne d'un horrordateur par un usager en colère contre l'augmentation actuelle des amendes ; ph. Mathilde Maraninchi
18:42 Publié dans Art immédiat, Art involontaire, Art populaire contemporain, Confrontations, Danse macabre, art et coutumes funéraires, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art involontaire, art populaire politique, khadafi, poésie naturelle et de hasard, horodateurs |  Imprimer
Imprimer
21/08/2011
Le musée d'Antoine Paucard, limousinant, ancien communiste, poète et sculpteur autodidacte, patriotard et spiritualiste
Cette note est dédiée à la personne signant "les freluquets farfelus" qui m'a mis sur la piste d'Antoine Paucard, qu'elle en soit donc remerciée ici.
Que d'étiquettes à coller sur le dos de cet étonnant personnage qui vécut une grande partie de sa vie à Saint-Salvadour, en Corrèze... Antoine Paucard, né en 1886, disparu en 1980, à l'âge respectable de 94 ans, fut en effet, nous dit-on sur internet (sources blogs Algerazur, Jean Maury et Wikipédia, dont les informations sont à réactualiser, je m'y emploie ici même), "tour à tour cultivateur, maçon, révolutionnaire, voyageur, auteur de chansons limousinantes, poète", et surtout pour ce qui me concerne un sculpteur naïf de première qualité...
né en 1886, disparu en 1980, à l'âge respectable de 94 ans, fut en effet, nous dit-on sur internet (sources blogs Algerazur, Jean Maury et Wikipédia, dont les informations sont à réactualiser, je m'y emploie ici même), "tour à tour cultivateur, maçon, révolutionnaire, voyageur, auteur de chansons limousinantes, poète", et surtout pour ce qui me concerne un sculpteur naïf de première qualité...
Antoine Paucard, autoportrait avec un ami, Roger Cronnier, avec commentaires inscrits sur les côtés, et au revers un bas-relief montrant "Minerve, déesse de la sagesse et des arts", (cette statue, difficile à déplacer, était à cet emplacement, devant l'ancienne maison de l'auteur, d'une manière toute transitoire), ph. Bruno Montpied, juillet 2011
En effet, venu sur le tard semble-t-il à cette dernière forme d'expression, il créa un ensemble de statues taillées pour leur majorité dans le granit qu'il décida d'exposer dans un petit musée bricolé par ses soins dans une petite dépendance de sa maison principale (voir image ci-contre, ph.BM). L'entrée était libre, une pierre indiquait un "musée Paucard",
L'entrée était libre, une pierre indiquait un "musée Paucard", ouvert tous les jours, et un panneau proclamait, paraît-il: "Entrez comme chez vous, mais refermez le clidou" (à mon passage, en juillet dernier, je ne l'ai plus vu, et pour cause, le musée avait été vidé de son contenu, par suite de la vente de la propriété par le fils d'Antoine Paucard et le transfert des collections dans un local également derrière la mairie du bourg où elles sont actuellement en cours de réinstallation).
ouvert tous les jours, et un panneau proclamait, paraît-il: "Entrez comme chez vous, mais refermez le clidou" (à mon passage, en juillet dernier, je ne l'ai plus vu, et pour cause, le musée avait été vidé de son contenu, par suite de la vente de la propriété par le fils d'Antoine Paucard et le transfert des collections dans un local également derrière la mairie du bourg où elles sont actuellement en cours de réinstallation).

Cherchez le nouvel emplacement du musée Paucard... Ph. BM

Le voici de nouveau à l'abri (chantier en cours... a priori non visitable pour l'heure), ph. BM
Les statues transférées, une trentaine à peu près, pas toutes encore installées au moment de ma visite... Ph. BM, juillet 2011
Depuis 2008, la commune, consciente de l'importance de ce patrimoine, a racheté le musée, ainsi que les archives d'Antoine Paucard, qui comptent notamment 120 carnets, contenant des notes et des réflexions personnelles, des aphorismes, des souvenirs, des poèmes, des chansons, le tout écrit entre 1930 et 1975... Peut-être la commune possède-t-elle un exemplaire, voire le manuscrit même, du livre qu'écrivit Paucard de retour d'URSS en 1933 (il n'y a pas que des Gide à en être "revenu"), intitulé "Un mois en Russie, par un paysan de la Corrèze". Je donnerais cher pour pouvoir lire ça...
Coffre d'Antoine Paucard couvert de poèmes ayant trait à ses carnets de notes, que ce coffre était vraisemblablement chargé de conserver, ph.BM
Cependant, on peut se faire un début d'idée sur la personnalité et les opinions d'Antoine Paucard tant ce dernier a laissé ailleurs que dans ces carnets des traces de ses pensées. Il a inventé en particulier une très originale façon de les exprimer: des statues-poèmes (c'est moi qui les appelle ainsi). De nombreuses effigies sont striées d'inscriptions gravées et soulignées en noir, qui sont autant d'étapes dans l'histoire paucardienne de ses admirations, de son panthéon personnel, de sa philosophie, de ses convictions.
Musée Antoine Paucard, de Napoléon à Sédulix... Ph.BM
Les généraux Margueritte et Nivelle, Sédulix et autres... Ph BM
Parmi ces effigies, on retrouve Napoléon, Charlemagne, Richelieu, deux généraux de la guerre de 14, Margueritte et Nivelle, un chef gaulois particulièrement vénéré par Paucard, nommé Sédulix (sorte de Vercingétorix du Limousin), Saint Salvadour, le père et la grand-mère de l'auteur, des chasseurs d'Afrique (vraisemblablement, étant donné que c'est le corps dans lequel servit Paucard de 1906 à 1909, et où il perdit un œil au Maroc), Confucius, etc.
Antoine Paucard, "Positivisme...et spiritualité", ph.BM
Mais aussi, il n'est pas rare de rencontrer des pierres entièrement vouées aux inscriptions, l'auteur gravant ses écrits dans la matière, affichant ainsi sa volonté de représenter plus solidement l'éternité de l'esprit qu'il n'a de cesse de proclamer dans sa littérature (dont la postérité lui paraissait sans doute peu assurée), et particulièrement aussi au cimetière du village où il a pu sculpter son tombeau et celui de sa famille, et de surcroît la stèle commémorant la mort d'un de ses compagnons résistants du "combat de La Servantie" (où cela se passait-il? Dans quelle région ou maquis? On aimerait davantage de renseignements là-dessus...),
et de surcroît la stèle commémorant la mort d'un de ses compagnons résistants du "combat de La Servantie" (où cela se passait-il? Dans quelle région ou maquis? On aimerait davantage de renseignements là-dessus...), un Géorgien au calot étoilé, Datiko Verouachvili, à qui il a consacré dans son musée un buste également.
un Géorgien au calot étoilé, Datiko Verouachvili, à qui il a consacré dans son musée un buste également.
Bibliographie:
Françoise Etay, Les chansons du temps de mon grand-père, in L'ethnomusicologie de la France, Editions L'Harmattan, 2008, pp. 225–226.
Robert Joudoux, Évocation d'Antoine Paucard, écrivain, sculpteur et chansonnier limousin de Saint Salvadour, Lemouzi, n°147, juillet 1998, p. 21.
Jean-Loup Lemaître, Michelle et Stéphane Vallière, Corrèze, 100 lieux pour les curieux, Guide Bonneton insolite, juin 2010, chapitre "Souvenirs d'un anticonformiste", pp. 167-169.
Illustrations du bas de cette note: Datiko Verouachvili en photo sur sa tombe au cimetière dont l'épitaphe a été rédigée et gravée par Paucard, et aussi en buste, taillé dans le granit par Paucard dans son musée.
19:12 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Littérature, Napoléon et l'art populaire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : antoine paucard, musée paucard, st-salvadour, corrèze insolite, art immédiat, sculpture naïve, environnements spontanés, littérature prolétarienne, chansons traditionnelles, sédulix, charlemagne, margueritte, nivelle, chasseurs d'afrique |  Imprimer
Imprimer
15/08/2011
Qui est aveugle?
That is the question, en effet. Posée par le Centre d'Etude de l'Expression dans les caves voûtées du musée Singer-Polignac, situé dans l'enceinte de l'Hôpital Sainte-Anne (on peut y entrer et en sortir, pas d'inquiétude...). Et ce du 17 septembre prochain jusqu'au 20 novembre (début de l'expo pour la journée du patrimoine le jeudi 15). C'est visiblement une expo de confrontations entre diverses appellations plus ou moins contrôlées.
Fresque de Le Gouïc, escalier d'accès au musée Singer-Polignac, ph.Bruno Montpied, 2009
Voici la liste des créateurs ou artistes (on répartira ces deux termes en fonction du degré de professionalisation de chacun) exposés à cette occasion:
Albino Braz, Noëlle Defages, Madeleine Dujardin, Even, Anna Hackel, André Le Hien, Alexandre Nelidoff, Neveu, Fernando Pau, Nicholas Sarley, Charles Schley, Joseph Barbiero, Aristide Cailliaud, Patrick Chapelière, Jill Gallieni, Vincent Germani, Charles Lanert, Frédéric Léglise, Michel Nedjar, Jean-Christophe Philippi, Abdelkader Rifi ; ainsi que les artistes du Créative Growth (USA) : Dwight Mackintosh, Donald Mitchell, William Tyler, Aurie Ramirez.
Albino Braz, brésilien, j'admire ses femmes nues aux chevelures hirsutes, aux corps striés comme si c'était des femmes velues et sauvages.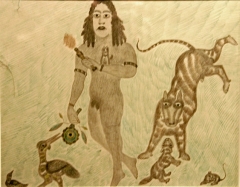 Beaucoup d'autres noms de cette liste ne m'évoquent rien par contre. Charles Schley figure dans les créateurs mentionnés par Anne-Marie Dubois dans ses livres sur la collection du Centre d'Etude de l'Expression (Braz aussi). Joseph Barbiero, j'en ai causé il n'y a pas longtemps ici. Aristide Caillaud est connu depuis des lustres comme un artiste original parfois rangé dans les Naïfs (épithète non infâmante pour moi), ou parmi les singuliers naïfs...
Beaucoup d'autres noms de cette liste ne m'évoquent rien par contre. Charles Schley figure dans les créateurs mentionnés par Anne-Marie Dubois dans ses livres sur la collection du Centre d'Etude de l'Expression (Braz aussi). Joseph Barbiero, j'en ai causé il n'y a pas longtemps ici. Aristide Caillaud est connu depuis des lustres comme un artiste original parfois rangé dans les Naïfs (épithète non infâmante pour moi), ou parmi les singuliers naïfs...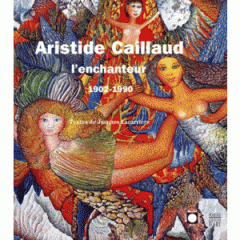 Patrick Chapelière, je viens de le mentionner comme vu récemment au musée des Arts Buissonniers en Aveyron, son oeuvre hésite entre naïvisme et poésie brute, quoique je pencherai plutôt pour la première catégorie (ci-dessous une repro d'un œuvre alliant évocations d'éléphant et de poignard, coll. privée).
Patrick Chapelière, je viens de le mentionner comme vu récemment au musée des Arts Buissonniers en Aveyron, son oeuvre hésite entre naïvisme et poésie brute, quoique je pencherai plutôt pour la première catégorie (ci-dessous une repro d'un œuvre alliant évocations d'éléphant et de poignard, coll. privée). Charles Lanert (1902-1995) est un cas curieux d'artiste qui n'a jamais réussi à se faire connaître. Ancien radiologue au service de l'armée de terre (ça me rappelle Gabritschewsky qui avait été biologiste), il produisit beaucoup de peintures qui ressemblent à des réminiscences de vues microscopiques genre cellulaires.
Charles Lanert (1902-1995) est un cas curieux d'artiste qui n'a jamais réussi à se faire connaître. Ancien radiologue au service de l'armée de terre (ça me rappelle Gabritschewsky qui avait été biologiste), il produisit beaucoup de peintures qui ressemblent à des réminiscences de vues microscopiques genre cellulaires.
Son oeuvre qu'on peut découvrir sur le net surtout grâce une vidéo sur Youtube paraît imprégnée de références à divers courants de l'art moderne, et a priori ne ressemblerait pas à quelque chose qu'on peut ranger dans l'art brut, pas plus qu'une œuvre de Michaux, de Wols ou de Gorki en tout cas. Mais elle peut par contre contribuer à propager la confusion des genres, comme c'est la mode actuellement...
© Michel Nedjar, 2001

Jean-Christophe Philippi, coll.privée, ph.BM 2008 (ces deux peintures ne renvoient pas à ce qui est montré à l'expo, elles sont nettement antérieures)
Michel Nedjar se retrouve embarqué dans cette réunion, ainsi que Jean-Christophe Philippi, tous deux excellents artistes singuliers entretenant des rapports esthétiques certains. Abdelkader Rifi est plus rare ici. Car avant tout créateur d'un environnement en mosaïque à Gagny, il a aussi laissé (il est mort en 2005) des oeuvres transportables qu'on ne voit jamais, c'est peut-être ce qui m'intrigue personnellement le plus dans cette expo. Les créateurs du Creative Growth Center sont eux beaucoup moins inconnus, si l'on se souvient, par exemple, des expos montées à Paris dans l'ex-Galerie Impaire de la rue Lancry dans le Xe ardt.
Abdelkader Rifi, composition florale, 59x80cm, œuvre présente à une vente chez Tajan en 2008
17:27 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art singulier, Confrontations, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : musée singer polignac, centre d'étude et de l'expression, anne-marie dubois, joseph barbiero, albino braz, nedjar, philippi, abdelkader rifi, charles lanert, art singulier, art naïf, art brut |  Imprimer
Imprimer
13/08/2011
Créature du Mont-Blanc
Rousse bien sûr, à l'aise, outrageusement fardée, si échauffée qu'elle ne craint pas de s'exposer à l'air vif des montagnes. Les neiges éternelles à l'arrière-plan se mettent devant un tel spectacle à prendre des rotondités suggestives. On imagine monsieur Nicoli, lui qui l'a peinte et nommée si crûment, dans un certain état de surexcitation. L'ivresse de l'altitude? Concentrée en un seul mot à l'ambivalence intense...
Nicoli, La salope du Mt-Blanc, sans date (merci à PL et Dominique H. pour la transmission de l'image)
16:29 Publié dans Art des croûtes, art des dépôts-ventes, Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art des dépôts-vente, art populaire érotique, curiosa, nicoli |  Imprimer
Imprimer
11/08/2011
René Rigal, ou la sculpture-phasme
Qu'il est doux de vagabonder dans le labyrinthe des minuscules départementales, bien loin des autoroutes où comme de juste, on ne trouve aucun inspiré du bord des autoroutes, cela tombe sous le sens. On voyage au cœur du néant sur ces rails de ciment, hors géographie, si loin de toute réalité que les régions et édifices que l'on aurait pu rencontrer n'existent que sur le papier, je veux dire, sur ces panneaux couleur de fèces qui nous donnent l'impression de flotter dans un monde virtuel. Sur les autoroutes, on ne sort pas de son ordinateur.

Ph. Bruno Montpied
Je vois tout à coup une flèche, "Musée éclaté". Je murmure dans ma barbe, on ne va pas aller voir bien sûr ce musée éclaté, pourtant, c'est un drôle de nom... Et surprise, mon camarade au volant braque aussitôt, enfilant une route encore plus minuscule qui serpente en grimpant sur des collines en direction d'un village nommé Cardaillac. On est au nord de Figeac, et non loin de Capdenac. Le "Musée éclaté" se fait désirer, et l'on finit par y pénétrer, alors que ce n'est pas l'heure d'ouverture. Il y a un sculpteur à l'intérieur qui pourrait m'intéresser, me dit une dame qui anime ce musée, qui est en réalité "éclaté" parce qu'en plusieurs parties, genre écomusée rural sur les métiers et les écoles de jadis. Marie Mage, c'est son nom magnifique, nous conduit à la partie brocante, musée de tout (des museums of everything, y en a aussi dans nos belles provinces, y a pas qu'à Londres), où elle me montre le sculpteur en question, ou du moins ses oeuvres. Et je reconnais subitement les figures filiformes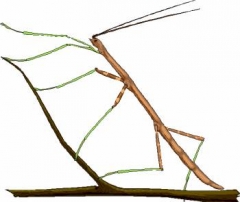 aussi dégingandées que des phasmes humains saisis dans le bois, c'est de René Rigal!
aussi dégingandées que des phasmes humains saisis dans le bois, c'est de René Rigal!
René Rigal, Si tous les gars du monde voulaient se donner la main... Expositon le Musée éclaté, Cardaillac, été 2011, ph. BM
Ô, la belle coïncidence... Je n'en avais jamais vu autrement que sous la forme d'un charmant petit documentaire projeté dans un festival Hors-Champ à Nice (René ne tape pas la belote de Philippe Macary et Jean-Marc Pennet, 13 min, 2000 ; à noter que René Rigal apparaît aussi plus briévement dans un film de Paolo Mucciarelli, Truc d'esprit, art singulier en France, 30 min, 2006).

Ph.BM
Des sculpteurs autodidactes exploitant les formes naturelles du bois, les racines, les branches ou les souches, il en existe souvent. Dans le cas de René Rigal, disparu hélas tout récemment (il sculpta de 1978, date de sa mise à la retraite de conducteur de train, jusqu'à sa mort, survenue apparemment en novembre 2008 –voir commentaire ci-après), on a affaire à un exceptionnel créateur du fait de son choix de bois aux formes étirées, tendant au filiforme, à la liane serpentine, ce qui ne l'empêchait pas pour autant de voir en eux divers personnages ou animaux. Dans le musée éclaté, c'était surtout des personnages humains qui avaient colonisé l'espace pour une période sans doute transitoire (je ne me rappelle plus très bien ce que Mme Mage nous a dit, c'était comme un tourbillon de rencontrer ces statues si étonnantes, si dansantes).
Dans le musée éclaté, c'était surtout des personnages humains qui avaient colonisé l'espace pour une période sans doute transitoire (je ne me rappelle plus très bien ce que Mme Mage nous a dit, c'était comme un tourbillon de rencontrer ces statues si étonnantes, si dansantes).
Dans le livre édité par l'association Hors-Champ, le Petit Dictionnaire Hors-Champ de l'Art Brut au Cinéma, Gilbert Fenouille fait une remarque fort plausible: "René Rigal en a eu assez de suivre les rails du conformisme social et les horaires rigides. C'est peut-être pour ça qu'au moment de la retraite, il s'est mis à sculpter les bois tordus." La sinuosité de ses chevaliers à longues figures renvoie probablement à la capricieuse ligne de vie qu'il avait dû suivre dès le travail abandonné.

Ph.BM
Le film de Pennet et Macary ne durait qu'une douzaine de minutes et les renseignements sur M.Rigal manquent aujourd'hui passablement. Il faudrait probablement s'adresser à la galerie La Menuiserie à Rodez pour en apprendre un peu plus. Ce sculpteur a eu ses œuvres fort bien servies par un excellent photographe, Jean-Michel Deslettres. Des clichés de ce dernier ont été notamment publiésdans un petit catalogue non daté que réalisa la galerie La Menuiserie après la mort du créateur (donc cette année). Il est souhaitable cependant qu'on consacre un jour un peu plus de papier à l'évocation de l'ensemble des pièces sculptées de cet excellent créateur.
Photo Jean-Michel Deslettres sur la couverture du catalogue de La Menuiserie
Comment accéder au Musée Eclaté? On va jusqu'à la place de la Tour, 46100, Cardaillac. Tél 05 65 40 10 63 ou 05 65 40 15 65. www.musee-eclate-cardaillac.fr (7 lieux "chargés d'histoire" à visiter avec des guides, maison du semalier, saboterie, moulin à huile de noix, l'étuve à pruneaux...). Le village de Cardaillac est très charmant, et il y a un bistrot si je me souviens bien...
21:31 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Cinéma et arts (notamment populaires), Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musée éclaté, rené rigal, association hors-champ, marie mage, macary et pennet, galerie la menuiserie, jean-michel deslettres |  Imprimer
Imprimer
06/08/2011
Les amis de l'oeuvre de l'abbé Fouré au Sémaphore de la Pointe du Grouin
Joëlle Jouneau et son Association des Amis de l'Œuvre de l'abbé Fouré remettent le couvert pour une expo du 10 au 24 août à Rothéneuf (dans la salle de quartier) sur le cher Ermite (pas si ermite que ça puisqu'il avait une bonne, a-t-on appris grâce au livre de Jean Jéhan...). C'est le prolongement de l'expo de décembre 2010 dont j'avais parlé et que peu de monde avait pu aller voir. Elle est en outre complétée d'une présentation de la Côte d'Emeraude à la Belle Epoque. Espérons que comme en décembre dernier, à cette occasion on puisse voir surgir d'on ne sait quel placard quelque petite oeuvre d'Adofe-Julien Fouré revenue faire un tour devant nos yeux ébahis.
De plus Mme Jouneau m'apprend que l'association occupera le Sémaphore de la Pointe du Grouin, situé entre Rothéneuf et Cancale, non loin de St-Coulomb, de septembre à novembre. Qu'on se le dise, si l'on passe par là cet automne. Ce sera l'occasion pour ceux que la visite des rochers sculptés aurait laissés sur leur faim d'en apprendre un peu plus sur le sens de ces rochers qui n'ont que très peu à voir avec l'histoire de corsaires que les gérants du lieu véhiculent à leur propos depuis cent ans.
Rochers sculptés de l'abbé Fouré, une vache, des généraux de la Guerre des Boers, ph Bruno Montpied, 2009
Jeanne du Minihic (un type sculpté par l'abbé ici, la femme du marin qui attend le retour de son mari, les yeux anxieux fixés sur l'horizon) ; sculpture disparue aujourd'hui, carte postale Guérin, St-Malo, peut-être années 1910?
Et un rappel...:
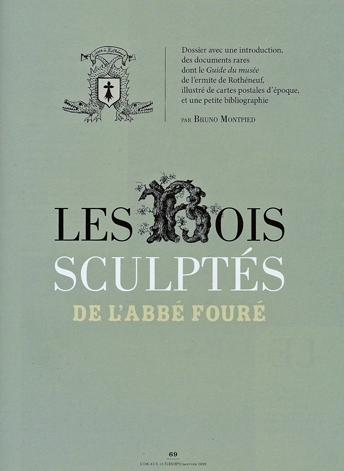
Dossier paru en janvier 2010 dans la revue L'Or aux 13 îles n°1 (Jean-Christophe Belotti, 7, rue de la Houzelle, 77250, Veneux-les-Sablons)
05/08/2011
Le Musée des Arts Buissonniers
Joli nom que celui de ce musée situé dans le village sympathique de Saint-Sever-du-Moustier dans l'Aveyron, près des monts de Lacaune, au nord du Languedoc, dans une zone qui a fait parler d'elle pour la découverte depuis plusieurs années de statues-menhirs  aux dessins en relief passionnants (voir ci-contre photo Anna Galore).
aux dessins en relief passionnants (voir ci-contre photo Anna Galore).
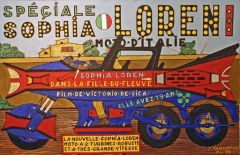 Le musée qui organise des expositions temporaires chaque été possède une collection permanente, apparemment réduite certes, mais de très grande promesse (ci-dessus une moto "Spéciale Sophia Loren" de Jean Tourlonias par exemple, ph. B.M.).
Le musée qui organise des expositions temporaires chaque été possède une collection permanente, apparemment réduite certes, mais de très grande promesse (ci-dessus une moto "Spéciale Sophia Loren" de Jean Tourlonias par exemple, ph. B.M.).
Annie Tolliver, Musée des Arts buissonniers, ph. B.Montpied, 2011
Ses responsables, qui ne cherchent pas particulièrement à se mettre en avant, sont soucieux de qualité et d'originalité, sans non plus tomber dans des débats sans fin sur la terminologie qu'il conviendrait d'adopter quant à leurs choix et leurs goûts, leurs rencontres avec telle ou telle création. "Art buissonnier" est le seul terme qu'ils mettent au premier plan, et c'est fort bien choisi, très poétique, je leur envie ce mot... Le public saura ainsi s'y retrouver de loin, il aura affaire ici à des créateurs qui fréquentent les chemins de traverse, et les collections inspirées.
Patrick Chapelière, 2007, Musée des Arts Buissonniers, ph.BM, 2011
Le musée est animé par une association, Les Nouveaux Troubadours, qui ne se contente pas de bâtir une collection d'œuvres mais organise aussi des stages accueillant divers groupes qui sont conviés à participer au chantier érigeant petit à petit une "construction insolite" (terme utilisé provisoirement?).  C'est un work in progress collectif en somme, dont j'ai déjà parlé il y a peu, qui tient à la fois du musée de Robert Tatin, de la maison de Jacques Lucas (lui-même émule de Tatin, je crois), du jardin des Tarots de Nikki de Saint-Phalle (c'est le toboggan dans un coin qui m'y fait penser), du Palais Idéal aussi, par moments on peut même lui trouver un vague côté Nek Chand, ou simplement hindou (toujours le toboggan avec son visage au-dessus), etc...
C'est un work in progress collectif en somme, dont j'ai déjà parlé il y a peu, qui tient à la fois du musée de Robert Tatin, de la maison de Jacques Lucas (lui-même émule de Tatin, je crois), du jardin des Tarots de Nikki de Saint-Phalle (c'est le toboggan dans un coin qui m'y fait penser), du Palais Idéal aussi, par moments on peut même lui trouver un vague côté Nek Chand, ou simplement hindou (toujours le toboggan avec son visage au-dessus), etc...
Un mur sur la terrasse supérieure avec des galets peints et assemblés, réalisation récente semble-t-il..., ph. BM, 2011
Ça part en feux d'artifice, dans tous les sens, en fonction des multiples et variés intervenants, plasticiens qui s'y collent de façon intermittente ou continue.
L'église en contrebas de la Construction Insolite à St-Sever-du-Moustier, ph.BM, 2011
La construction en question est située sur une colline qui domine le village, de là-haut on voit fort bien l'église et le bourg qui se nichent en contrebas, une comparaison s'esquisse de l'architecture de l'église à celle de la Construction Insolite.
Et très probablement deux nouveaux troubadours..., ph. BM, 2011