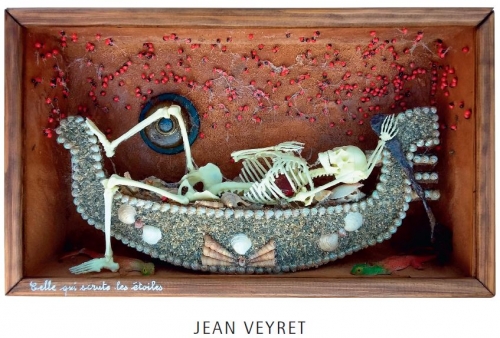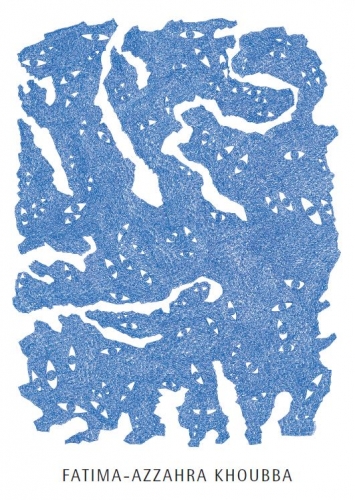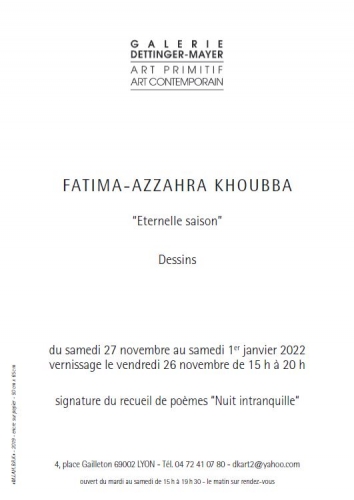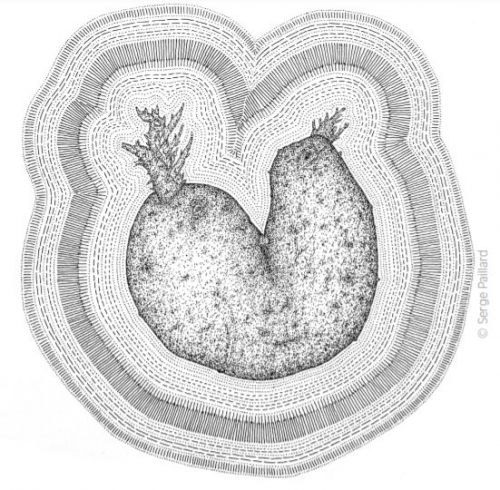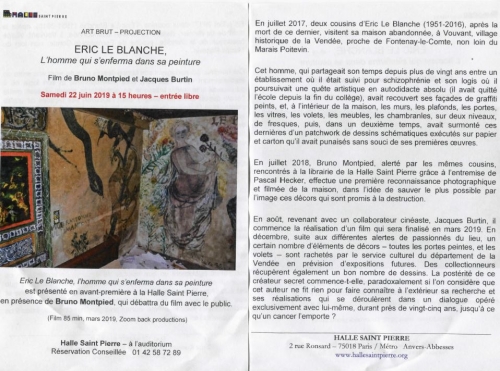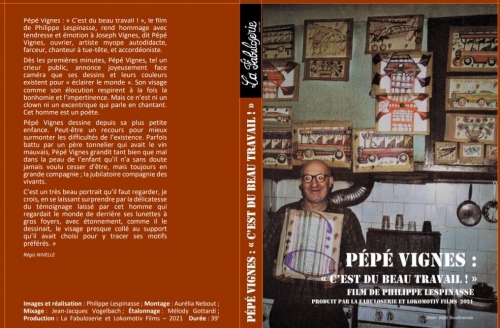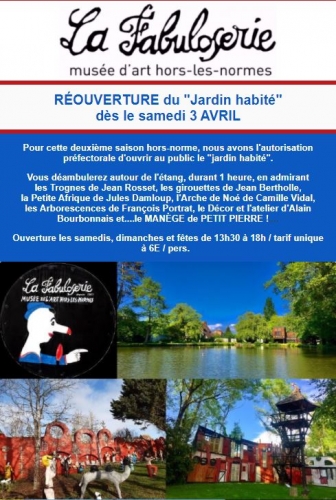13/10/2021
Info-miettes (39)
Encore des Info-miettes, va-t-on me dire... Mais c'est qu'ils se passe des choses, des expos, des salons, des publications... Alors, j'ai préféré diviser les sous-notes en plusieurs notes. Deuxième brassée ci-dessous:
Yves Elléouët, à la Galerie Plein-Jour, Douarnenez
Le vernissage de cette exposition du poète et peintre Elléouët (1932-1975), que l'on associe au surréalisme, aura lieu le 16 octobre, en présence d'Aube Breton-Elléouët et Oona Elléouët. L'expo est prévue pour durer du 16 octobre au 28 novembre 2021. On trouvera plus d'information (le dossier de presse en particulier) à cette adresse: www.galeriepleinjour.fr/yves-elleouet

Yves Elléouët, une peinture de 1958.
Galerie Plein-Jour, 4 rue Eugène Kérivel, 29100 Douarnenez. Tél: 07 81 73 41 85.
*
Janet Sobel à la Galerie de Toutes Choses (Gallery of Everything)
Montrée en France à l'occasion du premier salon d'art outsider tenu à l'Hôtel le A (voir ma note de l'époque ici) en 2013, Janet Sobel (1893-1968), précurseuse de l'expressionnisme abstrait et du dripping de Jackson Pollock, revient en Europe, à Londres plus précisément, du 10 octobre au 14 novembre, à la galerie de James Brett et affidés, avec d'autres femmes créatrices (dont Unica Zürn, Hilma af Klint, Emma Kunz,Anna Zemánková, ou bien Judith Scott), ainsi que dans le salon Frieze Masters qui se tient dans Regent's Park (mais dans ce lieu un peu moins longtemps, des peintures de Sobel seront exposées du 13 au 17 octobre). On aura plus de renseignements sur le site de la Gallery of Everything.
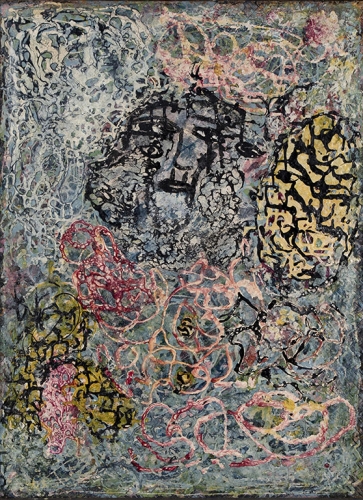
Janet Sobel, sans titre, huile sur cannage sur panneau, 76,5 x 56,3 cm, visuel Gallery of Everything.
*
Escale Nomad, nouvelle exposition entre République et Strasbourg-Saint-Denis
Pas d'Outsider Art fair cet automne, suite sans doute aux incertitudes qui pesaient en début d'année sur les mois d'automne quant à la possibilité de monter cette foire avec de nombreuses galeries à contacter (de plus, n'y aurait-il pas quelque vent de fronde chez certains galeristes trouvant la place bien chère...?). Certaines galeries d'art brut (Berst, Ritsch-Fisch) se tournent vers la FIAC qui elle se tient aux dates prévues. Cependant, il se murmure que l'Outsider Art Fair ne serait pas remise non plus aux calendes grecques, ce serait pour le printemps prochain, après tout, une saison plus en rapport avec l'éternelle jeunesse des pulsions brutes...

Vue de certaines oeuvres proposées par Escale Nomad.
D'autres, en attendant cette foire printanière, font cavalier seul durant l'automne, comme Escale Nomad de Philippe Saada qui revient présenter ses découvertes d'art brut d'un peu partout à côté des poulains auxquels il reste fidèle (Babahoum). Ce sera du 14 (demain) au 24 octobre, à la Galerie L'Œil Bleu.
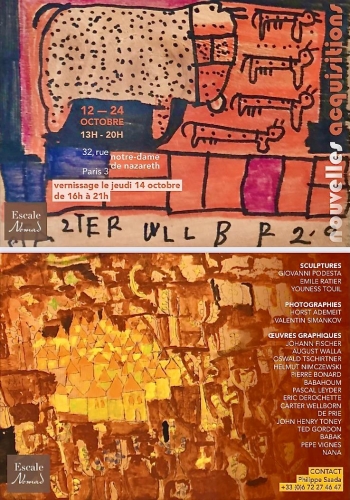
Galerie l’OEIL BLEU, 32 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 (Métro République ou Arts et Métiers). Apparemment, c'est tous les jours...
*
Et la Galerie Pol Lemétais revient chez Soulié d'un bon pas
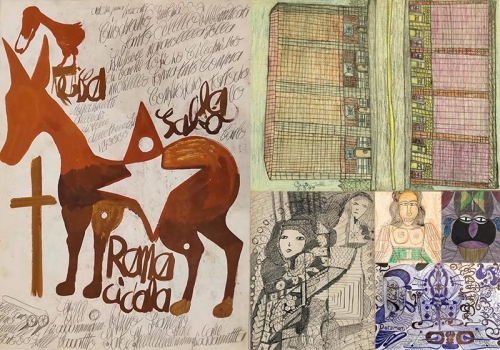
Pour sa part Pol Lemétais proposera aussi un large éventail de créateurs et artistes (Noviadi Angkasapura, Anselm Boix-Vives, Kenneth Brown, Jean Crié, Darédo, Olivier Daunat, Paul Duhem, Anaïs Eychenne, Madge Gill, Daniel Gonçalves, Johann Hauser, Alain Kieffer, Dwight Mackintosh, Mina Mond, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Lewis Smith, Henry Speller, Carter Todd, August Walla, Scottie Wilson, Zefrino, Carlo Zinelli...), du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021 dans le local de la Galerie Béatrice Soulié (21 rue Guénégaud 75006 Paris), de 13h à 20h, et sur rendez-vous.
Pol Lemétais, tél : 06 72 95 60 18. http://www.lemetais.com
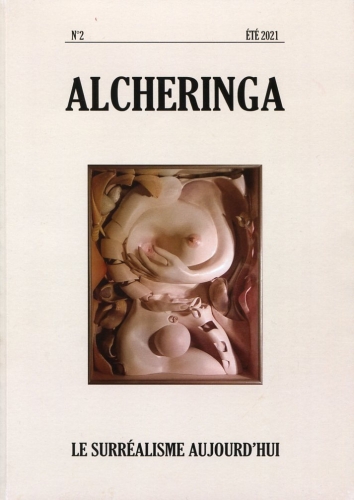
Alcheringa n°2, sous titré 'Le surréalisme aujourd'hui", été 2021.
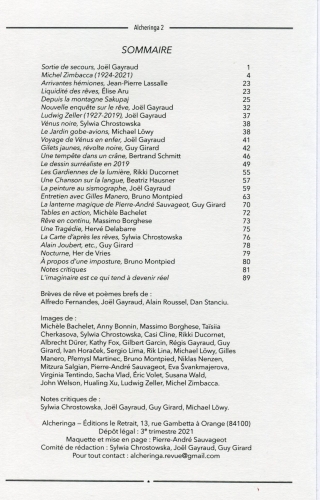
Pour se procurer la revue (tirée à 300 exemplaires, mieux vaut s'adresser directement à l'éditeur, les éditions du Retrait, basées à Orange (on trouve le bulletin de commande ici, sur leur site web).
Signalons aussi une exposition actuelle, "Le Tarot de cocagne", du peintre-théoricien-poète du groupe surréaliste Guy Girard à la Maison Rignault (librairie de la Maison André Breton), à Saint-Cirq-Lapopie, consistant en une réinterprétation sous forme de toiles des différentes lames du tarot. L'expo est prévue pour aller jusqu'au 29 octobre.

Guy Girard, une des peintures de l'expo actuelle.
*
Et chez Dettinger, qu'est-ce qu'on y voit? Jean Veyret, puis Fatima-Azzahra Khoubba, bientôt...
Celle qui scrute les étoiles, une boîte de Jean Veyret, Galerie Dettinger-Mayer.
Après une expo consacrée au grand peintre surréaliste lyonnais Max Schoendorff, qui s'est terminée le 9 octobre, Alain Dettinger continue dans sa galerie de la place Gailleton (Lyon 2e ardt) de proposer de réjouissants menus, puisqu'à partir du 30 octobre, on retrouvera de nouvelles boîtes pleines d'onirisme de Jean Veyret, visibles jusqu'au 20 novembre, date après laquelle l'intrigante Fatima-Azzahra Khoubba (on fait un prénom mot-valise à partir de son prénom composé quand on lui écrit ou lui parle: Fatimazara, sinon on s'épuise...), qui exposait naguère des tableaux semblant illustrer la théorie des fractales (voici déjà huit ans que je n'en avais pas revus, mais elle a peut-être été réexposée depuis), prendra la suite du samedi 27 novembre 2021 au 1er janvier 2022 (elle a mis des yeux à ses bras de terre et cela change tout dans ces fjörds bleus). C'est elle qui sera donc le cadeau de fin d'année à la galerie. Il se murmure qu'elle devrait également au vernissage de son expo signer un livre de ses poèmes, Nuit intranquille, que l'on attend avec curiosité. Y retrouvera-t-on sa gentillesse et son humour légers?
19:46 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Hommages, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : yves elléouët, galerie plein-jour, gallery of everything, janet sobel, escale nomad, philippe saada, art brut, galerie pol lemétais, alcheringa n°2, groupe de paris du mouvement surréaliste, guy girad, michel zimbacca, joël gayraud, gilles manero, bruno montpied, hey!, maison andré breton, galerie dettinger-mayer, jean veyret, fatima-azzahra khoubba, nuit intranquille, poèmes |  Imprimer
Imprimer
07/10/2021
Le petit musée de monsieur Costecalde
Cette note contient une mise à jour du 9 octobre
Cela fait déjà quelque temps (quatre ans environ) que j'ai dans mes collections de cartes postales une image qui montre l'intérieur d'une habitation à Lapanouse de Sévérac (Aveyron), à l'est de Rodez, organisé en forme de petit musée privé (on en a déjà rencontré sur ce blog de ces petits musées ultra personnels). Parmi un capharnaüm d'objets et d'œuvres sculptées, on y aperçoit l'auteur – ou le "conservateur", un certain François Costecalde – d'une étonnante collection d'allure hétéroclite.
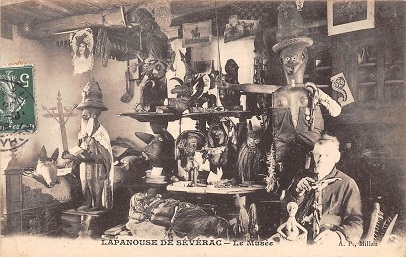
Lapanouse de Sévérac, le musée ; c.p. A.P., Millau, coll. Bruno Montpied.

Agrandissement où l'on s'aperçoit que le visage de ce monsieur Costecalde, en train de manipuler une canne (semble-t-il) de sa collection, paraît avoir été traité surexposé (à dessein ?).
Cette carte m'avait été signalée par un autre amateur de créations populaires, dijonnais, Julien Gonzalez, par ailleurs grand dénicheur d'autodidactes inconnus présents sur des cartes postales anciennes, ou décrits dans des journaux ou magazines peu repérés. Je reprends dans les renseignements ci-après des citations d'après les mails que m'avait adressés ce chercheur distingué en 2017 puis en 2020, et tout récemment encore en 2021 (tracées en vert)...
Ce monsieur Costecalde, ancien menuisier (ce qui doit aider pour tailler du bois), né à Saint-Grégoire, commune de Lavernhe en 1835, est décédé en 1916. "Les enfants de celui-ci prenaient leur père pour [un "foulatras" ( ça sonne comme fou la trace), comme on dit en Aveyron¹]. Ils ont brûlé toutes ses créations peu après sa mort. Ne reste plus que la carte postale que nous avons pu trouver sur internet. Le lieu était très visité au début du XXe siècle, il y avait un restaurant juste à côté et les clients de celui-ci allaient visiter le musée après leur repas. Il avait été baptisé le musée de la sorcellerie."
"...il reste encore une réalisation sauvegardée de cet autodidacte : une armoire avec des scènes et des visages humains sculptés qui a été rachetée par un habitant du village après son décès..."
Après ces informations, Julien m'adressa une reproduction de la même carte que ci-dessus, augmentée de précieuses annotations d'un visiteur anonyme du musée – musée que cet anonyme qualifie de "ridicule" (on ne sait lequel des deux, du visiteur ou du "conservateur" l'était le plus, ridicule, d'autant que ses autres commentaires, comme on le voit ci-après, sont d'une tonalité descriptive assez précise, même si légèrement condescendants par endroits ; on retrouve ici une ambivalence analogue à celle de l'archéologue Léon Coutil lorsqu'il tomba sur les sculptures d'Antoine Rabany à Chambon-sur-Lac, cf. mon enquête sur l'auteur des Barbus Müller).
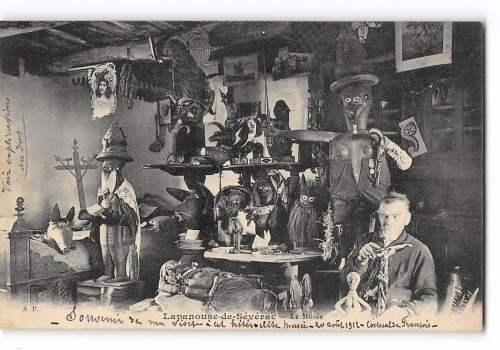
Voir les annotations du visiteur anonyme (du 20 août 1912) en bas de la carte, et à gauche, celle qui invite à lire "l'explication" au dos de la carte (voir ci-dessous). C.p.collection Julien Gonzalez.
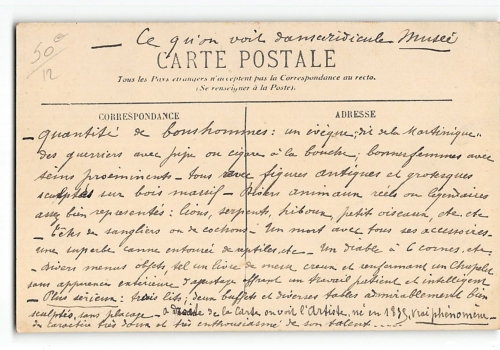
"Ce que l'on voit dans ce ridicule musée...", verso de la c.p. de la coll. Julien Gonzalez ; transcription ci-dessous.
Transcription de la description du musée par le visiteur ci-dessus :
"- Quantité de bonshommes : un évêque, dit de la Martinique ; des guerriers avec pipe ou cigare à la bouche ; bonnes femmes avec seins proéminents - tous avec figures antiques et grotesques sculptées sur bois massif - divers animaux réels ou légendaires assez bien représentés: lions, serpents, hiboux, petits oiseaux, etc, etc.
- Têtes de sangliers ou de cochons - Un mort avec tous ses accessoires - Une superbe canne entourée de reptiles, etc. - Un diable à 6 cornes, etc.
- Divers menus objets, tel un livre de messe creux renfermant un chapelet sans apparence extérieure d'ajustage offrant un travail patient et intelligent.
- Plus sérieux : Trois lits ; deux buffets et divers tables admirablement sculptés, sans placage - A droite de la carte on voit l'Artiste, né en 183(9? ou 5?), vrai phénomène - De caractère très doux et très enthousiasmé de son talent..."
Qui était ce visiteur, écrivant sans faute d'orthographe, passablement outrecuidant (cf. ces soulignements sur ce qui lui paraissait plus sérieux dans la production de Costecalde, à savoir des meubles, donc des objets utilitaires, les objets plus artistiques ne trouvant que mépris aux yeux de ce visiteur instruit, mépris à peine tempéré par la reconnaissance de l'habileté et de "l'intelligence" du sculpteur improvisé...)? On ne peut que deviner un personnage quelque peu dérouté en creux (voire scandalisé...) par l'audace de ce créateur ne s'étant autorisé de personne, hors lui-même, pour confectionner et ouvrir son musée personnel.
Plus récemment, Julien Gonzalez, m'a également envoyé une autre description du "Musée" - datée de novembre 2017 - par une habitante de Lapanouse (tracée ici en violet), propriétaire de l'armoire rescapée de l'imbécile autodafé des héritiers de Costecalde (voir photo ci-après), intéressante parce qu'on peut la recouper avec la description de l'annotation ci-dessus:
"Monsieur, je vous envoie un peu de la vie d'un Musée de mon village Lapanouse où se trouvait ce Musée.
Je ne peux vous faire la photocopie du journal dont je vous avais parlé, elle est trop fripée et n'a rien donné. C'était [dans] le journal L'Union catholique (février 1905 ou 1906) : "Ce menuisier ébéniste n'a eu d'autre guide que son imagination, sur la carte postale on aperçoit le général Pélissier avec son sabre, l'évêque de la Martinique, Saint-Roch et son chien, Robespierre à cheval sur une chèvre, etc. (illisible), au second plan : un sanglier, un ânon, un crocodile, une tête de bœuf, un écureuil grignotant une noix, des lapins, des poules, (etc...) Nous ne saurions trop recommander aux touristes sillonnant notre pays, et ils sont nombreux, et à tous les amis du beau qu'une visite dans les ateliers de cet artiste, (etc...), ils trouveront toujours quelque objet digne de leur convoitise".
L'auteur de cet article serait un Dominique de Saint-Léon, écrivain de la région.
A savoir dans une pièce obscure il y avait une chambre mortuaire, 2 cierges, un Christ, un bénitier, un lit, et sur ce lit, un mort en bois bien sûr, les visiteurs qui voulaient bien sûr, devaient faire le signe de la croix et bénir le mort, il paraît que c'était très lugubre, et juste que la lueur des chandelles, ce lit aussi avait une tête de mort à chaque pied de lit, un corbillard, un fossoyeur, mon grand-père l'avait acheté mais ni mon oncle, ni mon père ne voulait y dormir, ils l'ont vendu à un antiquaire de Béziers contre une chambre à coucher (armoire à glace)... Ma grand-mère était fière, car ils avaient fait une affaire.
Des quatre enfants Costecalde, aucun n’est resté au pays et, à son décès, ils vendirent quelques meubles et tout le reste [est parti] au feu... Ils avaient honte que leur père soit un "foudralas" [foulatras, plutôt, non ?], mot patois qui veut dire "dérangé".
Que reste-t-il aujourd'hui ici : deux ou trois armoires et une pierre sculptée mais que l'usure du temps a détériorée".
"Cette dame m'a envoyé joint à son courrier une photo de l'armoire sculptée qu'elle possède encore aujourd'hui." (Julien Gonzalez). Voir ci-après la carte du musée que j'ai enrichie de légendes apposées près des effigies évoquées dans les descriptions, plus la photo de l'armoire évoquée mon correspondant Julien.
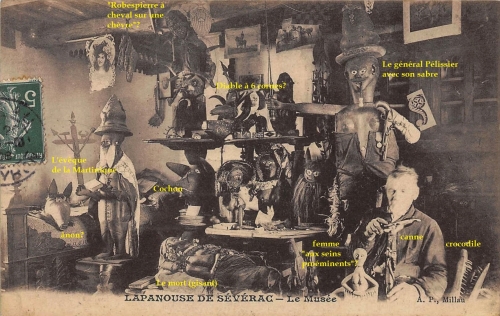
Carte avec légendes incrustées sur la photo par B.M.

Magnifique armoire actuellement conservée chez une habitante de Lapanouse, ph. transmise par Julien Gonzalez.
______
¹ Ce mot de "foulatras", je ne sais trop d'où il vient. En fouillant sommairement sur Internet, j'ai trouvé, sans être sûr de moi, que le mot était courant dans le parler Gaga de la région de Saint-Etienne, désignant quelqu'un de dérangé, d'anormal, de pas comme tout le monde, etc. Régis Gayraud me propose une dérivation occitane de "folâtre"... Ô, comme nous manquent les conseils avisés de ce distingué occitaniste qu'était Michel Valière...
14:21 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le petit musée costecalde, lapanouse de sévérac, musée d'art populaire personnel, julien gonzalez, cartes postales, environnements intérieurs spontanés |  Imprimer
Imprimer
04/10/2021
Info-Miettes (38)
Bientôt un livre consacré à Pierre Albasser
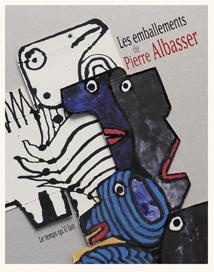 Quelle chance a Pierre Albasser. Un éditeur de talent a décidé de consacrer une monographie à sa ludique production artistique, toute d'expérimentations diverses – j'ai nommé les Editions Le Temps qu'il Fait, de Georges Monti, déjà connues pour avoir publié divers livres en rapport avec la création spontanée de divers autodidactes (les livres de Charles Soubeyran – Les Révoltés du Merveilleux –, de Patrick Cloux, de Denis Montebello, la correspondance de Gaston Chaissac avec l'abbé Coutant...). C'est prévu pour novembre prochain, avec des contributions, de votre serviteur, mais aussi de GEHA (son "archiviste et impresaria" comme dit l'éditeur), de Pascal Rigeade, Dino Menozzi, Denis Montebello, etc - voir le lien que j'ai mis ci-dessus renvoyant au site du Temps Qu'il Fait. Le livre est actuellement en souscription (jusqu'au 19 novembre, notamment pour le tirage de tête – 50 ex. numérotés, accompagnés d'un dessin original sur carton d’emballage, signé par l’artiste). Ah... Je suis jaloux!
Quelle chance a Pierre Albasser. Un éditeur de talent a décidé de consacrer une monographie à sa ludique production artistique, toute d'expérimentations diverses – j'ai nommé les Editions Le Temps qu'il Fait, de Georges Monti, déjà connues pour avoir publié divers livres en rapport avec la création spontanée de divers autodidactes (les livres de Charles Soubeyran – Les Révoltés du Merveilleux –, de Patrick Cloux, de Denis Montebello, la correspondance de Gaston Chaissac avec l'abbé Coutant...). C'est prévu pour novembre prochain, avec des contributions, de votre serviteur, mais aussi de GEHA (son "archiviste et impresaria" comme dit l'éditeur), de Pascal Rigeade, Dino Menozzi, Denis Montebello, etc - voir le lien que j'ai mis ci-dessus renvoyant au site du Temps Qu'il Fait. Le livre est actuellement en souscription (jusqu'au 19 novembre, notamment pour le tirage de tête – 50 ex. numérotés, accompagnés d'un dessin original sur carton d’emballage, signé par l’artiste). Ah... Je suis jaloux!
Six peintures de Pierre Albasser.
"Dans un pli du temps", une exposition chez Art et marges, à Bruxelles, avec, entre autres, Serge Paillard
Serge Paillard
Du 7 octobre 2021 au 13 mars 2022, "Profitez d’une expérience contemplative hors du temps ! La brèche ouverte par l’exposition "Dans un pli du temps" invite à une réappropriation de la lenteur. Découvrez des œuvres réalisées dans une infinie patience, qui évoluent au fil de l’exposition ou convoquent d’autres temporalités." Parmi les artistes ou créateurs exposés, je relève notamment les noms de Serge Paillard, souvent évoqué et défendu sur ce blog, mais aussi de Augustin Lesage, Fanny Viollet, Joseph Crépin, Juliette Zanon, Kunizo Matsumoto, Lionel Vinche, Raphaël Lonné, ou encore des travaux anonymes venus d'un HP belge... Cet éloge de la lenteur, ceci dit, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler ailleurs (ne serait-ce pas à la galerie d'ABCD à Montreuil, à côté de Paris, il y a quelques années? Mais oui, cela eut lieu en 2013, et cela s'appelait "De la lenteur avant toute chose", et le commissariat en avait été confié à Marion Alluchon, Emilie Bouvard, Camille Paulhan, Sonia Recasens et Septembre Tiberghien... ; on trouvait déjà dans cette dernière exposition au moins un exposant en commun - Kunizo Matsumoto). Pour lire le dossier de presse, c'est par ici.

Une peinture sans titre de Juliette Zanon, 30 x 40 cm, vers 2016 (?), photo et collection Bruno Montpied.
Une autre exposition de Pape Diop
On se souviendra peut-être que j'ai déjà signalé ce créateur, actif dans un quartier déshérité de Dakar, nommé Pape Diop. Je l'avais découvert dans une première expo qui avait été montée par Sophie Bourbonnais dans sa galerie parisienne de la Fabuloserie. Voici qu'il est à nouveau présenté, cette fois à la Galerie du Moineau Ecarlate d'Eric Gauthier, au 82 rue des Cascades dans le 20e ardt. La galerie du moineau écarlate et Yaatal Art présentent:
Pape « Médina » Diop
Du 7 octobre au 20 novembre 2021.
Un petit film tourné par Modboye, la personne qui suit Pape Diop, dans un montage d'Eric Gauthier, est disponible sur Viméo (il y en a un autre après):
Musique (à signaler, pour Darnish, entre autres): Lee Scratch Perry, qui vient de nous quitter, un vrai créateur musical proche de l'art brut, et initiateur de la musique reggae)
J'aime beaucoup l'oeuvre de Frank Lundangi
Nouvelle exposition de Lundangi dans la galerie qui l'expose régulièrement à Paris, la Galerie Anne de Villepoix. Là c'est déjà commencé depuis le 30 septembre, et c'est prévu pour durer jusqu'au 30 octobre. Titre de l'expo "Eclosion". C'est aussi le titre d'une des oeuvres délicates de l'artiste (qui vit en France, sur les bords de Loire).
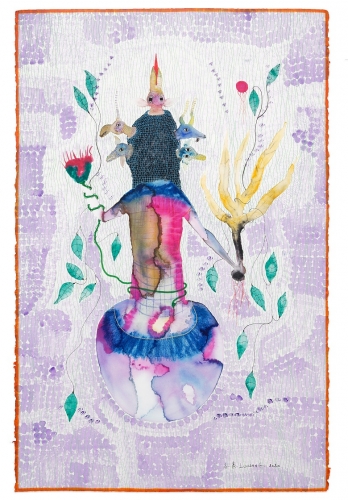
Franck Lundangi, Eclosions, Aquarelle et encre sur papier, 102 x 67 cm, 2020, ph. Galerie Anne de Villepoix.
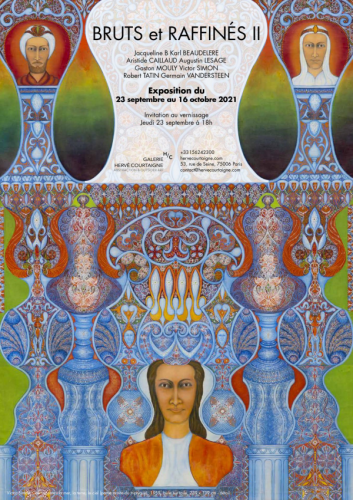
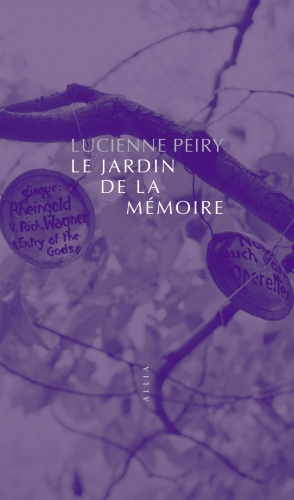 "Le Jardin de la mémoire", cela s'appelle. Rien à voir avec les défunts "Jardiniers de la Mémoire" du Musée de la Création Franche de Bègles... Cela traite d'Armand Schulthess, cet employé d'une institution bernoise qui rompit avec sa vie réglée pour se blottir dans une châtaigneraie au sud de la Suisse, où il se mit à remplir des centaines de plaques, suspendues aux arbres, avec des extraits de ses savoirs, dans une démarche encyclopédique en plein vent, comme s'il s'agissait de fondre sa mémoire avec la nature autour de lui (car était-il dupe de cette installation, vouée à un démantèlement inexorable?). Lucienne Peiry avait déjà par le passé organisé une exposition sur ce personnage. Ici, elle paraît s'être attelée à produire un petit livre au prix modeste (7,50€) pour accroître la diffusion de la connaissance d'Armand Schulthess auprès d'un public élargi.
"Le Jardin de la mémoire", cela s'appelle. Rien à voir avec les défunts "Jardiniers de la Mémoire" du Musée de la Création Franche de Bègles... Cela traite d'Armand Schulthess, cet employé d'une institution bernoise qui rompit avec sa vie réglée pour se blottir dans une châtaigneraie au sud de la Suisse, où il se mit à remplir des centaines de plaques, suspendues aux arbres, avec des extraits de ses savoirs, dans une démarche encyclopédique en plein vent, comme s'il s'agissait de fondre sa mémoire avec la nature autour de lui (car était-il dupe de cette installation, vouée à un démantèlement inexorable?). Lucienne Peiry avait déjà par le passé organisé une exposition sur ce personnage. Ici, elle paraît s'être attelée à produire un petit livre au prix modeste (7,50€) pour accroître la diffusion de la connaissance d'Armand Schulthess auprès d'un public élargi.
10:38 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art insolite, Art moderne ou contemporain acceptable, Art rustique moderne, Art singulier, Art visionnaire, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pierre albasser, le temps qu'il fait éditeur, emballements, serge paillard, art et marges, art singulier, juliette zanon, art brut africain, pape diop, galerie du moineau écarlate, franck lundangi, bruts et raffinés ii, galerie hervé courtaigne, art rustique moderne, gaston mouly, lucienne peiry, armand schulthess |  Imprimer
Imprimer
30/09/2021
Les Journandises, manifestation artistique sur le campus de Bourg-en-Bresse et ma venue le 12 octobre
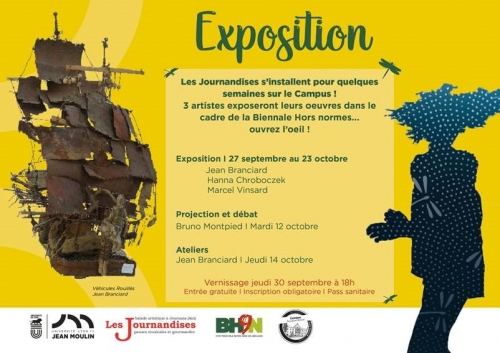
Je dois dire, qu'avec l'âge, je m'y perds de plus en plus dans les annonces que je reçois. Les "Journandises", par exemple, dans le cadre desquelles je suis invité le 12 octobre prochain à venir débattre avec qui veut (des étudiants a priori) d'art brut, d'art naïf, d'art populaire, et, accessoirement, à partir de la maison peinte d'Eric Le Blanche dont je montrerai l'intérieur, via le film que j'ai écrit et coréalisé en 2019 en autoproduction (y a marqué "Zoom back productions" dedans, mais c'est un mot bidon)... C'est une manifestation qui se tient apparemment de manière régulière (du moins quand il n'y a pas de pandémie par-ci, par-là), dans une bourgade appelée Journans (c'est la première fois, n'étant pas de la région, que j'en entends parler ; mais comme il y a internet, maintenant, tout le monde fait dans l'implicite et comme si tout le monde savait ; donc, je regarde sur internet moi aussi et je vois que Journans, c'est dans l'Ain (hein? c'est au sud-est de Bourg-en-Bresse (prononcer Bourk-en-Bresse), et donc au nord-est de Lyon aussi). Mais je ne sais trop pourquoi, il se trouve que dans le cadre de ces Journandises, (la manifestation qui se tient à Journans s'appelle comme ça, donc), qui, elles-mêmes cette année, se tiennent dans le cadre de la Biennale Hors-les-Normes de Lyon (plus communément appelé BHN : un acronyme, ça fait toujours bien dans le décor) - ce qui accentue la complexité de la chose, tout de même, non? -, la manifestation (une expo de trois personnes, Jean Branciard, Hanna Chroboczek et Marcel Vinsard (1930-2016 ; un créateur sur qui j'ai abondamment renseigné par un livre et par des notes sur ce blog) dont c'est le vernissage pas plus tard qu'aujourd'hui, une rencontre avec mézigue autour d'un film donc (le 12 octobre à 18h30), et le 14 octobre, un atelier avec Jean Branciard qui incitera les étudiants de Bourg à fabriquer des bateaux à partir de matériaux recyclés) se tient non pas à Journans, ni à Lyon, mais sur le campus de l'université de Bourg-en-Bresse (je ne savais pas qu'il y avait une université là-bas, ne pensant personnellement qu'aux poulets quand j'entends le mot Bresse, qu'on me le pardonne, SVP...). Avouez qu'il y a de quoi s'y paumer, non, quand on n'est pas familier des secrets des dieux (c'est-à-dire des animateurs de la BHN), non?
Donc... A bientôt?
18:26 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art singulier, Art visionnaire, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : journandises, bhn, campus université de bourg-en-bresse, eric le blanche, bruno montpied, cinéma et arts populaires spontanés, environnements intérieurs spontanés, jean branciard, marcel vinsard |  Imprimer
Imprimer
24/09/2021
Dernière acquisition

F. Trompette, sans titre, huile sur toile, 35 x 26,5 cm, sd ; photo et collection Bruno Montpied.
"Oh, my god...", semble se récrier ce cureton qui en dresse, quelque peu estomaqué, les bras vers le ciel, en surprenant son enfant de chœur en train de siffler sans vergogne le vin de messe. Je n'ai pas trouvé le tableau très habilement peint, et pas non plus très naïf, ce qui aurait pu racheter cette faiblesse, mais l'anecdote était drolatique, à verser, si je puis dire, dans une thématique vouée à la moquerie contre les prêtres. Et puis, le nom du peintre, en soi, est drôle aussi. Les trompettes de la renommée? Tout de même pas, cela dit...
21:05 Publié dans Amateurs, Anonymes et inconnus de l'art, Art immédiat, Art insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : f.trompette, anticléricalisme primaire, enfant de chœur, vin de messe, anecdotes cocasses, art insolite, art amateur |  Imprimer
Imprimer
10/09/2021
Exposition Vivian Maier bientôt au Musée du Luxembourg à Paris
Prévue dans très peu de temps (du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022), cette expo sera l'occasion pour beaucoup d'amateurs de photographie de découvrir en vrai les tirages, réalisés (en majorité?) par John Maloof, spécialiste de la photographie de rue, notamment de la partie Nord-Ouest de Chicago, où il a grandi, à partir d'une sélection dans les 140 000 négatifs secrets de la très discrète (ou inaperçue?) photographe, Vivian Maier (1926-2009) (une Vivian girl d'un nouveau genre?), qui les réalisait au gré de ses déambulations dans les rues de Chicago ou New York, en parallèle de son travail de nurse ou de baby-sitter, et qui les délaissa dans un garde-meubles, la vieillesse et la maladie étant survenues (John Maloof est tombé dessus, via un site de vente aux enchères semble-t-il, alors que Vivian Maier était encore vivante, mais très diminuée). Ces photos, notamment beaucoup de portraits d'inconnus, d'enfants entre autres, sont des chefs-d'œuvre de la photographie de rue associable à ladite "photographie humaniste".
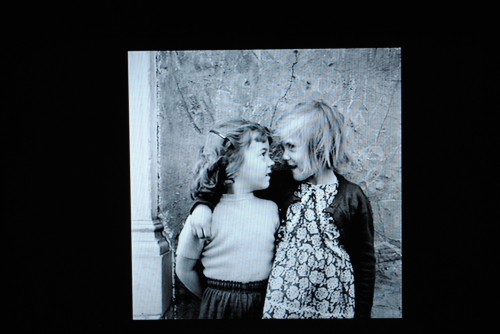
Photo de Vivian Maier, telle que reproduite dans le film de John Maloof et Charlie Siskel.
Vivian Maier est un exemple frappant de ces génies isolés qui œuvrent en cachette, avant tout pour eux-mêmes (faute d'avoir pu être repérés, reconnus?), tel le photographe et peintre tchèque Miroslav Tichy, dont la photographie était certes plus anti-conventionnelle, mais qui avait en commun avec Miss Maier de se limiter essentiellement au geste pur de la capture photographique, conçu comme traque de la réalité vivante concentrée en un seul instant. Car Vivian Maier ne semble pas avoir voulu faire beaucoup de tirages, se contentant de faire développer ses négatifs (pour s'en assurer, il faudrait pouvoir disposer de ses tirages personnels mis en regard avec les tirages faits par Maloof, qui sont très beaux ceux-ci, très professionnels, alors que ceux de Vivian Maier sont peut-être plus ternes(?); ce serait un point à éclaircir).
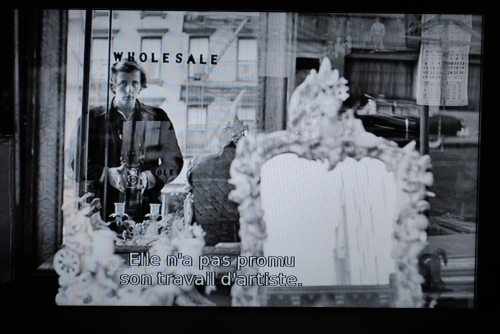
Photo (autoportrait) extraite du film de John Maloof et Charlie Siskel.
Plusieurs livres (en anglais) sont disponibles sur Vivian Maier, ainsi qu'un film édité en DVD (A la recherche de Vivian Maier, de John Maloof et Charlie Siskel, 2014). Un site web lui est dédié. A noter qu'un catalogue paraît à l'occasion de l'expo au Musée du Luxembourg, sans doute la première publication sur Maier en français. Profitons aussi de cette note pour souligner à quel point la photo choisie pour l'affiche rend peu justice à l'originalité de cette photographe. 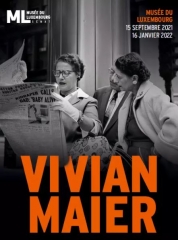
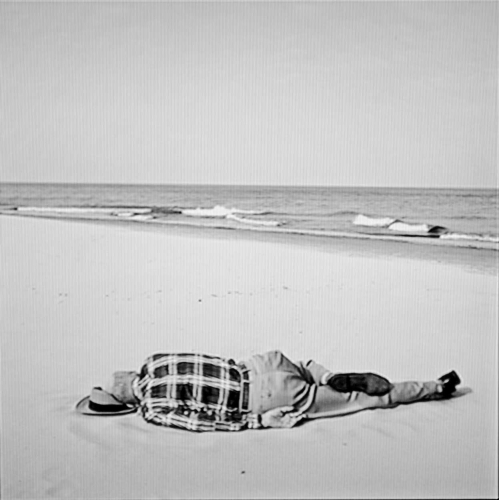
Photo de Vivian Maier, homme dormant sur une plage.
11:45 Publié dans Photographie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vivian maier, john maloof, photographie de rue, oeuvres secrètes, art intime, delpire, ann marks, musée du luxembourg |  Imprimer
Imprimer
25/08/2021
La maison de la rue Bénard, XIVe arrondissement, à Paris
En complément de ma note précédente sur des maisons simples décorées de motifs mythologiques ou grotesques, situées à Cholet, Douarnenez, et au Blanc, voici une petite mention d'une façade curieuse du XIVe arrondissement parisien, relative à la maison du 43 rue Bénard.

Maison ornée de mascarons et autres figures composites ou grotesques, rue Bénard, ph. Bruno Montpied, 2021.
Elle date visiblement d'une époque plus ancienne que les bâtiments qui la jouxtent, tentant même d'empiéter sur elle comme si elle gênait (l'immeuble situé à sa droite mord sur elle en effet – à tous les sens du terme, presque –, de façon incroyable (comment a-t-on pu le permettre?), à tel point qu'on en a mal pour elle...). Si les immeubles pouvaient parler, on entendrait perpétuellement cette objurgation: "Ôte-toi de là que j'm'y mette...".

C'est tout juste si l'avancée de la maison d'à côté n'est pas venue obstruer la porte du 43.... ; à signaler un dragon ailé au sommet de l'épi de faîtage (en zinc sans doute), en haut sur le toit, à droite, à la fin du cortège des fleurs de lys surplombant la gouttière ; ph. B.M.
Si on passe un peu trop vite, on ne remarque pas l'aspect peu fréquent des motifs qui animent assez joyeusement cette façade plutôt rare à Paris aujourd'hui. Il y a des têtes, certes, une chouette aussi, mais en outre des figures plus composites, un chat à tête d'homme avec un corps serpentin au-dessus de la porte d'entrée, un monstre ailé en haut à gauche au sommet de la gouttière de descente, et des figures à la limite du visionnaire surgissant de la masse des feuillages surplombant la porte (où l'on a malheureusement fiché une lampe assez disgracieuse)...



Sur cette composition au-dessus de la porte d'entrée de la maison, on aperçoit deux êtres fantastiques, dont l'un à tête humanoïde, surgissant de l'amas des rameaux de feuillages, ceux-ci composant même un masque fantastique (involontaire?) ; ph. B.M.
Sur cette maison, on découvre ainsi, aussi, une décoration sculptée assez fantaisiste, analogue à celles des maisons que j'ai mentionnées en Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, avec une même apparence de personnalisation atypique, fort rare dans une agglomération comme Paris, terriblement sage (vide) du point de vue de l'ornementation de ses façades, si l'on excepte les rares vestiges d'architecture de type Art Nouveau (comme le Castel Béranger d'Hector Guimard dans le XVIe arrondissement ou l'immeuble de Lavirotte, avenue Rapp), si souvent menacées elles-mêmes, cela dit...
00:47 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art immédiat, Art insolite, Art visionnaire, Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : rue bénard, ornementations des façades parisiennes, paris insolite, ornementation visionnaire, grotesques, mascarons, dragons, épis de faîtage, monstres |  Imprimer
Imprimer
21/08/2021
Pour changer des mascarons et autres cariatides, des dragons et des griffons
Il y a quelques années (dix-sept ans exactement), me baladant à Cholet, j'étais allé photographier la façade d'une maison que j'avais découverte, intrigué, dans un des deux volumes des éditions Flohic consacrés au patrimoine du Maine-et-Loire. Il s'agissait d'un décor de façade dû à un certain Fernand Dupré (1879-1969), sculpteur-marbrier de son état, qui avait pris plaisir dans les années 1920-1930 à se concocter des fenêtres et balconnets ornés de sujets inspirés d'un médiéval de fantaisie. On trouvait là des figures proches des gargouilles et des monstres, des masques, et des cariatides masculines, dont un homme soufflant dans une cabrette tout en soutenant un des balcons. L'ensemble, au point de vue des personnages choisis, était relativement classique, même si cela présentait un aspect un peu inquiétant. Et cela m'avait intéressé parce que ce décor, tout de même atypique, avait été créé par un artisan local pour sa propre maison, en dehors de commanditaires extérieurs apparemment. On s'approchait, sans y être pour autant, des créations des autodidactes de bords de routes n'ayant, eux, aucune formation artisanale ou artistique.

Maison sculptée par Fernand Dupré, 5 rue Darmaillacq, Cholet, ph. Bruno Montpied ,septembre 2004.

Maison Fernand Dupré, Cholet, ph. B.M., 2004.

Maison Fernand Dupré, détail des ornements de la façade; le personnage au bec crochu n'est pas très engageant... ; ph. B.M., 2004
Plus récemment, je suis tombé sur deux autres maisons (respectivement en 2017 et 2021), situées à bonne distance l'une de l'autre – de la Bretagne finistérienne à la région des étangs de la Brenne (région Centre-Val de Loire pour ceusses qui savent pas où c'est). Elles sont pourvues cette fois de dragons (et de griffons, voir commentaire ci-après) sculptés. Sculptés dans des styles différents, quoique visiblement, là aussi, par des artisans possédant un certain métier. Donc, là non plus on n'a pas affaire à des habitants ayant sculpté par eux-mêmes, en purs autodidactes. Mais le choix des sujets décoratifs était là aussi peu commun, reflet de goûts hors les normes.

Maison à Douarnenez, ph. B.M., été 2017.

Lion tenant un écu où l'on lit la date de 1910 (plutôt que 1210, en dépit d'un 9 très sinueux, proche d'un 2) ; ph .B.M. 2017.

Un dragon à gauche, ph. B.M., 2017.

Dragon de droite, comme prêt à plutôt aboyer qu'à cracher des flammes? ; ph. B.M., 2017.
La première maison ci-dessus, située à Douarnenez, plutôt discrète, un peu à l'écart et sans doute pas signalée sur les dépliants touristiques, comporte un écu que présente un lion efflanqué au milieu de sa façade. De part et d'autre du félin, on aperçoit deux petits dragons bien patelins, pas loin de ressembler à des chiens, puisqu'ils ont sans doute, comme ces derniers, la mission de garder symboliquement la petite maison. Leur style n'est pas loin d'être naïf... Ces sculptures sont-elles des pièces rapportées?
La deuxième maison, ci-dessous, on est tombé dessus avec l'ami Sganarelle, ces dernières semaines, dans la bourgade de Le Blanc, dans le Parc Régional de la Brenne, pas loin de Saint-Benoît-du-Sault. Juchés au-dessus des fenêtres d'une maison plus cossue, à la maçonnerie couverte de curieux motifs compartimentés qui me faisaient personnellement un peu penser à une vague toile d 'araignée.
Ses dragons (et griffon(s)) étaient plus baroques. Même si ces motifs peuvent paraître connus et manifestant une certaine culture de la part des commanditaires, ils restent peu communs sur des façades de villas, qui plus est en milieu urbain. Ils sont d'un style également plutôt personnalisé, ne paraissant pas trop provenir d'une production en série... Manifestent-ils un désir de la part de propriétaires plus aisés que la moyenne de s'égaler dans le choix de leur décoration de façade aux ornementations des demeures seigneuriales de l'Ancien Régime? Est-ce, en bref, de l'ornementation de bourgeois de province, distincte des goûts des prolétaires de bords de routes?

Maison aux dragons (et griffon) dans la bourgade du Blanc (Indre), 17-19 rue Villebois-Mareuil ; ph. B.M., 2021.

Griffon à gauche ; ph. B.M., 2021.

Dragon au centre; ph. B.M., 2021.

Dragon (ou griffon?) de droite ; ph. B.M., 2021.
18:43 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art immédiat, Art insolite | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : gargouilles, décors atypiques de façades, ornementation insolite, monstres, dragons, baroque, architecture insolite, douarnenez, le blanc, étangs de la brenne |  Imprimer
Imprimer
13/08/2021
Aube Breton-Elléouët expose ses collages avec les tableaux de coquillages de Youen Durand
L'association des Amis de Youen Durand, ce Breton qui dirigeait la Criée de Lesconil, auteur d'une trentaine de petits chefs-d'oeuvre en mosaïque de coquillages, continue son travail méritant de passeuse de mémoire au service de l'art d'un autodidacte de grand talent. Pour cet été, du 17 août au 5 septembre 2021, elle a eu l'idée de lancer une invitation à Aube Breton-Elléouët, qui a des attaches en Bretagne (son mari était le poète et peintre breton Yves Elléouët, disparu trop tôt), afin qu'elle prête des collages. Le goût du merveilleux est le point commun qui rassemble les deux créateurs, pourtant de cultures différentes. Aube, fille d'André Breton comme on sait, si elle est aussi la fondatrice de la collection de DVD, Phares, consacrée à 24 figures du surréalisme, "éditée à fonds perdus", montre régulièrement sa sensibilité à l'égard des autodidactes qui vont dans le sens du merveilleux (elle était présente ainsi à la première, à la SCAM, du film "Bricoleurs de paradis" que j'ai co-écrit avec son réalisateur Remy Ricordeau en 2011).
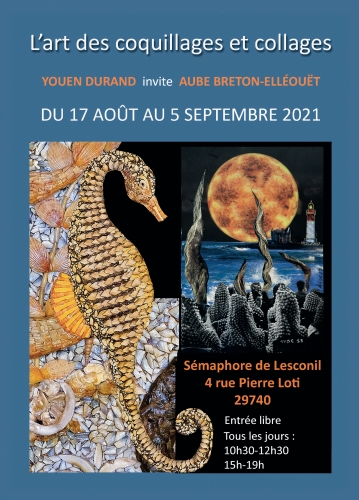
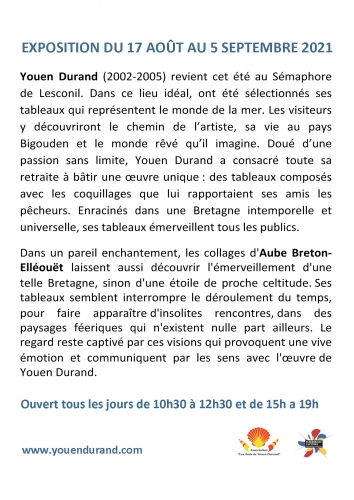
Parmi les collagistes actuels, Aube Elléouët représente une figure éprise de la quête d'une image la plus unitaire possible, allant dans le sens du poème visuel merveilleux. Le n° 150 de la petite revue Regard, de l'artiste Marie Morel, vient de lui avoir été justement consacré, en avril dernier, avec une minuscule interview illustrée de plusieurs belles reproductions de ces collages. Je ne suis peut-être pas très bien informé à ce sujet, mais il me semble que les interviews d'Aube Elléouët ne sont pas fréquents.
*
Ici, cependant, je dois faire une parenthèse au sujet de ce numéro de Regard. Il contient une petite brochure encartée, qui reproduit des petits textes d'un M. Francis Pellerin qui à un moment se met à parler d'Eric Le Blanche... Dont les lecteurs de ce blog – ou de la revue Création Franche, ou encore de la revue Artension, auxquels j'ai donné des articles pour faire connaître ce peintre et dessinateur introverti et secret, qui avait peint l'intérieur de sa maison en Vendée dans le plus grand secret – se souviendront que j'ai déjà abondamment parlé (en lui consacrant de plus, en mars 2019, un film en auto production, L'Homme qui s'enferma dans sa peinture qui fut programmé à la Halle Saint-Pierre au mois de juin suivant).
Le flyer que j'auto-éditai en juin 2019 pour présenter mon film sur Le Blanche à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre et en débattre avec le public ; la réalisation du film est signée dans le générique de mon nom et de celui de Burtin, mais ce dernier est surtout participant de ce film en tant que conseiller technique, car bien qu'autodidacte, il maîtrise fort bien cet aspect dans la création d'un film ; c'était entre autres raisons (il fut un ami aussi autrefois, avant, hélas, de devenir une grenouille de bénitier) pour cela que j'avais recouru à lui, pressé que j'étais par le risque d'effacement de l'intérieur de la maison de Le Blanche, dont m'avaient alerté les cousins d'Eric.
Ce M. Pellerin, hélas, est fort mal informé. S'il l'avait été, je veux croire qu'il n'aurait pas écrit ces mots dans ce petit livret de Regard: "...Le peintre et cinéaste Jacques Burtin s'investit totalement depuis quelques années afin de faire connaître cette œuvre hors normes, exceptionnelle. il a réalisé des films (que j'ai vus), a créé une association, organisé des expositions (une, d'importance, devrait avoir lieu cet automne à la Vendéthèque de la Châtaigneraie) et construit un site internet que je vous conseille vivement de visiter..." Quelle prétention, et quel tour de passe-passe...
Il faut rétablir quelque peu la vérité et mettre certains points sur les i. D'abord il est tout à fait exagéré de présenter "l'œuvre" d'Eric Le Blanche comme "hors-normes" (au départ Le Blanche s'inspirait de la peinture gréco-latine...) et "exceptionnelle" (ce n'est pas par la qualité de ses peintures et dessins que Le Blanche est intéressant – comme je le dis dans mon film de mars 2019, film qui a précédé ceux de Burtin qui s'est empressé de faire les siens pour supplanter la communication que j'avais initiée autour de Le Blanche (à la suite de la demande de sa famille) – c'est par son comportement de peintre introverti projetant son imaginaire et ses admirations artistiques tout seul à l'intérieur de sa maison entre deux séjours à l'hôpital.
M. Burtin ne s'investit pas depuis "quelques années" (cette façon de s'exprimer donne l'impression que Burtin s'occupe de Le Blanche depuis toujours et surtout seul, ce qui est faux (en réalité c'est moi qui lui ai fait découvrir l'existence de la maison de Le Blanche en août 2018, en l'engageant à tourner des images pour le film que je désirais faire ; j'étais venu un mois auparavant, en juillet 2018, faire tout un reportage photo à la demande de la famille, Soizic et Jean-Louis Sapey-Triomphe, que j'avais rencontrée à la Halle Saint-Pierre en juin 18). Quand M. Pellerin parle ainsi de Burtin, il valide, peut-être sans le savoir, une imposture qui me paraît en train de se mettre en place à l'instigation de ce même Burtin (ce dernier cherche en effet à monopoliser la communication autour de Le Blanche afin de propager sa vision idéaliste et réactionnaire du personnage).
Ce serait oublier, non seulement ma propre action, mais aussi celle de l'Association Arts Métiss', en Vendée, à La Chemillardière, qui fut la première, avec ses animateurs, Laurent Pacheteau et Jean-Pierre Rouillon (ce dernier ayant acheté beaucoup de dessins qui traînaient par terre dans la maison lors d'une vente aux enchères, où ni moi, ni les parents de Le Blanche, et encore moins le sieur Burtin, n'étaient présents), à monter la plus complète des expositions¹ sur Le Blanche, les 4 et 5 juillet 2019, à partir des éléments du décor de la maison Le Blanche qu'ils avaient contribué à faire sauver (j'ai gardé moi-même quelques dessins), entre autres par les affaires culturelles du département de la Vendée (via M. Julien Bourreau) qui acheta au nouveau propriétaire de la maison les volets et les portes intérieures de la maison Le Blanche (située dans le village vendéen de Vouvant). "L'association" de M. Burtin, le site internet qu'il a créé, représente surtout avant tout lui-même, et sa femme. Son action tend à imposer, par une sorte de confiscation de l'interprétation du phénomène de cette maison peinte intérieurement, une seule façon d'envisager le phénomène, à base d'idéalisme et de religiosité des plus ringards. Le bouffon "Institut Eric Le Blanche" qu'il a inventé, au titre ridiculement trop grand pour son sujet et trop pompeux pour être honnête, est de l'ordre de l'auto proclamation, servant avant tout à faire la promotion dudit Burtin, se prenant pour un génie (chose que personne n'a vraiment envie de vérifier) et projetant cette illusion sur le pauvre Le Blanche, qui, effectivement, était un peu mégalomane lui aussi... C'est là sans doute la seule justification de l'hystérique activité de l'ineffable M. Burtin...
____
¹ Ils en ont monté une autre, plus récemment, cet été même, aux Sables d'Olonne, les 2 et 3 juin à l'Abbaye d'Orbestier.
20:39 Publié dans Amateurs, Art Brut, Art inclassable, Art insolite, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : youen durand, association des amis de youen durand, aube breton-elléouët, marie morel, regard, francis pellerin, eric le blanche, bruno montpied, association arts métiss |  Imprimer
Imprimer
29/07/2021
Méga loto et chère chapelle...
Dans les écrits populaires, il ne faut pas oublier de relever aussi les prières que l'on trouve dans certaines églises, épinglées parmi d'autres dans des livres à cet usage. C'est parfois croquignolet. Jugez plutôt, ce papillon que j'ai recopié, trouvé dans une église au fin fond de notre chère province, adressé à un bâtiment entier, excusez du peu (objets inanimés, avez-vous donc une âme?), ça c'est du pur jus brut :
"Chère chapelle, Notre dame du tilleul. Je souhaite gagner Samedi 09 janvier au loto, Ramener un lot au moins, Car cela fait longtemps que je n'ai rien gagné alors samedi on peut avec mon amie à deux heures de chez nous pour participer à un méga loto je souhaite ramener un gros lot. Merci (signature)" (syntaxe respectée).
Commode, non, cette façon de croire, ça mange pas de pain, on passe un coup de fil à la Chapelle préférée, on ne sait jamais, si les voies du Seigneur sont propices, un peu de magie, et hop, ça peut faciliter les choses côté loterie, ça coûte rien d'essayer... Quand la foi s'allie au sens pratique...
*
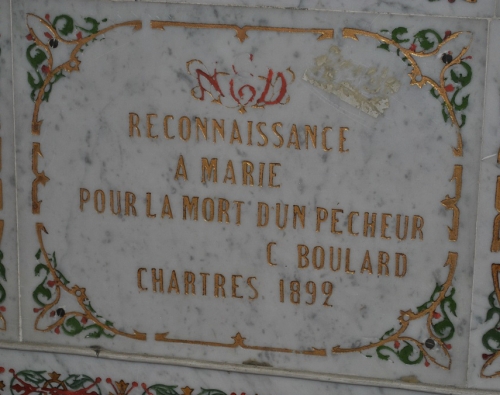
Et que dire de cette plaque de marbre gravée d'un texte votif où l'auteur se félicite de la mort d'un "pécheur" ("C.Boulard", est-ce le nom de l'infortuné?), c'est-à-dire de la mort d'un autre être humain...? Quand la haine la plus rance fait bon ménage avec des petits arrangements avec les saints... ; Basilique Notre-Dame-des-Enfants, Châteauneuf-sur-Cher, photo Bruno Montpied, 2020.
*

Il y a bien de quoi le devenir, non? ; photo Régis Gayraud, 2020.
22/07/2021
Des fleurs dans le buisson, expo collective de bruts et singuliers au Musée des Arts Buissonniers
Du 16 juillet au 18 septembre 2021, se tient la nouvelle proposition d'exposition estivale mise en forme par Pol Lemétais et l'association Les Nouveaux Troubadours, association qui anime le Musée des Arts Buissonniers, s'occupe également des stages du chantier de la Construction Insolite, en perpétuelle évolution sur la colline dominant le village de Saint-Sever-du-Moutier, et créant toutes sortes d'événements festifs (musicaux par exemple) dans cette charmante bourgade de l'Aveyron, tranquillement à l'écart.

Anselme Boix-Vives, œuvre servant sur le carton d'invitation à l'exposition du Musée des Arts Buissonniers
"Des fleurs dans le buisson", cela s'appelle. Cela devient une tradition, du reste ce complément "dans le buisson", puisque précédemment il y avait déjà eu "Du Bic dans le buisson", sur des travaux divers au Bic. Cette fois, l'orientation de l'expo est donc davantage thématique. C'est bien sûr aussi l'occasion de voir des créateurs et des artistes multiples, que l'on range selon les cas du côté de l'art dit brut ou de l'art singulier (artistes semi-professionnels, en marge, influencés par l'exemple esthétique ou moral de l'art brut). Voici ci-dessous la liste des personnes exposées (dont votre serviteur, qui a prêté quelques œuvres où l'on rencontre des fleurs).
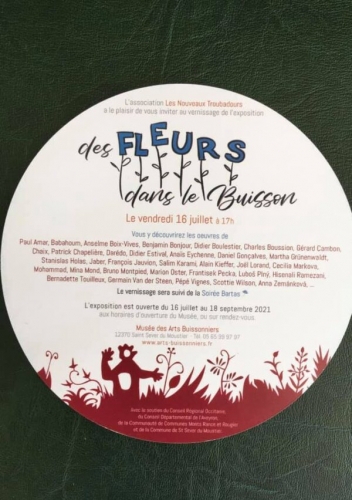
Donc, comme on le voit, il y a de quoi trouver son bonheur (c'est une expo avec ventes), avec des œuvres variées, Chapelière, Babahoum, Cecilia Markova, Frantisek Pecka, Charles Boussion, Zemankova (bien évidemment, la fée de la botanique "parallèle"...), Pépé Vignes, entre autres...

Patrick Chapelière (exposé), un artiste qui se noie dans les fleurs...

Bruno Montpied, Hypnotique Alice, 30 X 40 cm, 2007 (exposé).

Cecilie Markova (1911-1998), sans titre, crayons de couleur sur papier noir, 63 x 45 cm, 1976, ph. et coll. Bruno Montpied (donc pas exposé au Musée des Arts Buissonniers) ; les médiumniques tchèques, auxquels on rattache Markova,, sont souvent hantés par la botanique...
Musée des Arts Buissonniers: L’exposition est présentée jusqu'au 18 septembre 2021 aux horaires d’ouverture du musée, ou sur rendez-vous. Association Les Nouveaux Troubadours - 12370 Saint Sever du Moustier. Tél : 05 65 99 97 97 - http://www.arts-buissonniers.com
11:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : des fleurs dans le buisson, arts singuliers, art brut, pol lemétais, saint-sever-du-moutier, musée des arts buissonniers, patrick chapelière, frantisek pecka, pépé vignes, charles boussion, bruno montpied, des fleurs dans l'art |  Imprimer
Imprimer
05/07/2021
Du plagiat funéraire?
En me baladant récemment au cimetière du Père Lachaise, je suis tombé sur une épitaphe que j'avais déjà vue ailleurs, sur une tombe bien plus célèbre.

Tombe Rocherolle, avec marqués en dessous du nom: "Je cherche l'or du temps"....
Les connaisseurs de la vie d'André Breton savent pertinemment que ces mots, "Je cherche l'or du temps", empruntés à un poème du fondateur du surréalisme, ont été inscrits en 1966 sur sa tombe au cimetière des Batignolles.


La tombe d'Elisa et André Breton au cimetière des Batignolles.
Alors? Qu'est-ce qui explique ce doublon de la tombe Rocherolle, qui paraît de fraîche date (j'avoue avoir oublié de regarder si l'on trouvait des dates de l'autre côté du tombeau...)? Aurait-on affaire à un plagiat funéraire? Excusable si l'on considère la parfaite adaptation de ce vers au genre de l'épitaphe, mais tout de même, n'aurait-on pas dû accomplir quelque renvoi à l'épitaphe originale...? (A moins que ce ne soit le contraire, la tombe Rocherolle bâtie avant celle d'André Breton, avec l'idée de l'épitaphe empruntée à Breton tout de même... (Je doute cependant fort de cette dernière hypothèse).)
11:57 Publié dans Danse macabre, art et coutumes funéraires, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : tombes, art funéraire, cimetières, andré breton, épitaphes |  Imprimer
Imprimer
25/06/2021
Des photos d'environnements populaires spontanés revenus de l'année 1977, par Marc Sanchez
Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir très récemment, dans une "galerie" du site web des Amis et Amies de Martine Doytier, des numérisations de diapositives 24 x 36 mm prises en 1977 par M. Marc Sanchez au cours d’une balade à travers la France en compagnie de la peintre et sculptrice Martine Doytier, représentant un certain nombre d'environnements populaires spontanés encore debout à l'époque. Ces photographies étaient absolument inconnues, jusque-là, des amateurs d’inspirés du bord des routes (ou « habitants-paysagistes naïfs », ou "bâtisseurs de l’imaginaire"…)¹. Ces clichés de plus sont d’une très bonne qualité et d’une grande fraîcheur, comme prises hier. C’est à la suite de cette exploration des créateurs insolites d’environnements naïfs ou bruts que Martine Doytier conçut ‒ et réalisa ‒ son projet de tableau en hommage au Facteur Cheval.

Martine Doytier, Hommage au Facteur Cheval, 1977, huile, 146 x 97 cm, coll. Jean Ferrero, Nice.
C'est au total 14 sites qui figurent dans cette "galerie" virtuelle bâtie par Marc Sanchez. Dans l'ordre, Mme Leroch (une accumulatrice d'objets tout faits, comme quoi cela ne date pas d'aujourd'hui), François Portrat (photographié sur place à Brannay, dans l'Yonne, et donc avant que le site soit démantelé et partagé entre la Fabuloserie et la Collection de l'Art Brut), "Giuseppe" Enrico (pourtant ailleurs appelé "Séraphin" Enrico, notamment par Olivier Thiébaut et Francis David) à Saint-Calais dans la Sarthe (site aussi démantelé par la suite), Jules Damloup (sur son site originel à Boësses dans le Loiret, avant le transfert et la sauvegarde de ses statues dans le parc de la Fabuloserie), Marcel Dhièvre (état d'origine, où l'on voit qu'il y a eu quelques écarts dans le traitement et l'intensité des couleurs à la suite de la restauration), Fernand Chatelain (sans accent circonflexe sur le "a", M. Sanchez... ; site photographié du vivant de celui-ci, ce qui permet d'avoir un point de comparaison avec l'état actuel après restauration ou, plutôt, comme je préfère dire, après prolongement), Charles Pecqueur (avec un beau portrait de l'auteur, à Ruitz, Pas-de-Calais), Eugène Juif (maison couverte de fresques florales, photographiée là aussi avant son effacement, je n'en connaissais jusqu'ici que des photos de Francis David, dont une me fut prêtée par ce photographe pour mon Gazouillis des éléphants), l'abbé Fouré (orthographe qu'utilisait l'abbé pour signer ses cartes postales, et non pas "Fouéré"), Pierre Avezard, dit "Petit-Pierre" (photographié là aussi sur son site d'origine à La Coinche dans le Loiret ; cela ajoute, en termes de documentation, au film d'Emmanuel Clot, et aux photographies de François-Xavier Bouchart publiées en 1982 dans le livre "Jardins fantastiques", aux éditions du Moniteur qui toutes montraient le site à son emplacement de départ (on sait que la majorité de ses pièces furent transférées dans le parc de la Fabuloserie à Dicy dans l'Yonne); à noter une première apparition de Martine Doytier parmi les visiteurs), Marcel Landreau, Raymond Isidore, dit "Picassiette" (avec une seconde photo de Martine Doytier posée sur le fauteuil en mosaïque de Picassiette ; on pourrait faire une anthologie des femmes posant sur ce célèbre fauteuil...), Robert Pichot (un site et un créateur dont personnellement je ne connaissais que le patronyme, orthographié "Picho" dans le livre de Jacques Verroust et Jacques Lacarrière, Les Inspirés du bord des routes, en 1978) et enfin le célèbre Facteur Cheval et son Palais Idéal (où l'on retrouve Martine Doytier une troisième fois, avec en plus son danois Urane - qui a le don de m'inquiéter chaque fois que je le vois dressé auprès de sa maîtresse, l'air pas commode...). Martine Doytier y apparaît en pleine forme, et l'on comprend mal ce qui a pu la mener sept ans plus tard à sa fin tragique.

Jardin de Séraphin Enrico, à St-Calais (Sarthe), © photo Marc Sanchez, 1977 ; le grand intérêt de cette photo, c'est son aspect documentaire didactique : on comprend mieux comment se présentait de la rue le site d'Enrico ; les photos parues ailleurs ne contextualisent en effet que très peu l'emplacement des diverses statues, dont certaines ont désormais atterri au Jardin de la Luna Rossa à Caen.
Marc Sanchez dans son texte de présentation ne veut pas entrer dans le détail des sources où lui et Martine Doytier ont trouvé les références des sites qu'ils sont allé visiter d'un bout à l'autre de la France (les trajets qu'il cite, sur un axe Nice-Lens, puis une perpendiculaire en direction de l'Ouest, font tout de même une sacrée distance qui nécessite quelques semaines de pérégrination, sans trop se presser...). Il rappelle qu'hormis le livre de Gilles Ehrmann, Les Inspirés et leurs demeures, paru en 1962, il n'y avait selon lui guère de livres à avoir mentionné ces environnements créatifs. Le livre de Bernard Lassus, Jardins imaginaires, sortit à la fin de cette même année 1977, soit après leur balade donc.

Le site de Fernand Chatelain, © photo Marc Sanchez, 1977 ; Chatelain est alors en vie, cela permet de voir comment se présentait son site, extrêmement tourné vers la route qui le longeait, destiné à interpeller les automobilistes, d'autant qu'il n'y avait alors aucun arbre – à la différence d'aujourd'hui – qui puisse entraver l'appréhension par les regards... ; autre fait notable, les statues étaient installées apparemment devant la clôture (au reste, assez peu dissuasive), sans crainte de vols possibles.
Sanchez expédie un peu cette question de sources, je trouve: "ces interventions « sauvages » font alors seulement l’objet de petits articles dans les journaux locaux ou dans des revues attirées par les curiosités et les bizarreries..." Eh bien, personnellement, j'aimerais qu'on nous donne la référence de ces "petits articles", de ces "journaux locaux", de ces "revues attirées par les curiosités et les bizarreries" (comme la revue Bizarre, par exemple?... avec ses deux articles, l'un de 1955 sur Camille Renault par le pataphysicien "Jean-Hugues Sainmont", l'autre de 1956 sur Picassiette par Robert Giraud, illustré par des photos de Robert Doisneau).

Martine Doytier rayonnante dans le fauteuil à l'air libre de Picassiette (Chartres, rue du Repos, quartier St-Chéron), © photo Marc Sanchez, 1977.
Dans ces années 1970, beaucoup d'intérêt pour les autodidactes de bord des routes se manifeste en effet chez les amateurs de contre-cultures, dans le vent des nouvelles orientations véhiculées par Mai 1968. Après le livre d'Ehrmann, un livre du poète Alain Borne est sorti en 1969 sur le Facteur Cheval chez l'éditeur Robert Morel. Un autre sur le même sujet, de Michel Friedman, chez Jean-Claude Simoën, suit en 1977 justement. Des ethnologues, comme Jean-Pierre Martinon (un "disciple" de Bernard Lassus, me semble-t-il), dans un numéro de la revue Traverses datant de 1976, éditée par le Centre Pompidou (qui ouvrit l'année suivante en 1977), tracent des parallèles entre les jardins savants de la Renaissance italienne et les environnements populaires, ce qui est en termes d'histoire de l'art est en avance sur le temps. Nombre de journaux, des quotidiens régionaux, consacrent à l'époque, de temps à autre, des articles à ces environnementalistes inspirés. Le phénomène d'ailleurs ne date pas des années 1970, comme c'est prouvé par la bibliographie assez ample que j'ai insérée à la fin de mon inventaire du Gazouillis des éléphants. Dès la fin du XIXe siècle, les magazines s'intéressaient déjà aux artistes improvisés qui font en outre, parfois, parler d'eux via l'édition de cartes postales. Les concours Lépine exposent certaines réalisations curieuses, bouchons ou marrons sculptés, inventions brindezingues, tours de force divers (tableaux ou plantes en mosaïque de timbres)... L'étude, le recensement de tous ces articles ou mentions d'artistes autodidactes, restent à faire, quitte à l'amplifier, et non pas à l'étouffer, ou le tenir, à tout le moins, secret. C'est pourquoi je regrette que Marc Sanchez n'ait pas cru bon de nous donner ces références de 1977... Mais il est homme à écouter les conseils...! Donc, ne désespérons pas trop, cela viendra peut-être...

Robert Pichot, à la Suze-sur-Sarthe, © photo Marc Sanchez, 1977 ; à noter que cette localisation corrige celle qui est fautive (Marc Sanchez me l'a confirmé en privé) dans le livre de Jacques Verroust... Ce dernier donne en effet la localité de Berfay, qui est assez distante de La Suze-sur-Sarthe ; notons au passage le grand nombre de cas de créateurs populaires en plein air ou non dans ces régions de l'ouest français...
_____
¹ Ces photos furent cependant présentées devant quelques privilégiés dans une conférence donnée par leur auteur à Nice, quelques mois après le retour des deux compères, mais elles ne paraissent pas avoir été publiées dans une quelconque édition papier depuis 1977.
13:38 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art visionnaire, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : martine doytier, marc sanchez, environnements populaires spontanés, photographie des autodidactes inspirés, facteur cheval, robert pichot, abbé fouré, gilles ehrmann, eugène juif, marcel landreau, picassiette, séraphin enrico, charles pecqueur, fabuloserie, petit-pierre, jacques verroust |  Imprimer
Imprimer
11/06/2021
Donation d'art brut au Musée National d'Art Moderne
Cette note contient des mises à jour opérées le 14 juin.
La nouvelle est tombée ces jours-ci, Bruno Decharme et son Association ABCD font donation au MNAM de 921 oeuvres, de 242 auteurs différents (chiffre avancé sur le site de la collection ABCD), prélevées dans leur collection d'art brut, avec comme condition qu'une salle soit perpétuellement (?) consacrée à une présentation tournante de cette donation au sein même du Musée, situé comme on sait dans la raffinerie du Centre Beaubourg (il était commun au début de son existence d'appeler ainsi ce qui s'appelle aujourd'hui le Centre Pompidou, Centre qui se démultiplie désormais de plus en plus: Centre Pompidou-Metz, CP-Malaga, CP/Kanal à Bruxelles, CP/West Bund Museum Project à Shanghaï, futur CP francilien/Fabrique de l'art, avec des réserves qui seront déplacées à Massy...), Centre où, personnellement, je le trouve trop à l'étroit (le MNAM posséde 120 000 œuvres et objets dans ses collections : on n'en voit qu'une très infime partie à Paris).
Cette salle consacrée à l'art brut, selon une information parue dans le Quotidien de l'Art, sera-t-elle près du Mur reconstitué de l'Atelier d'André Breton ? Ce "Mur" qui est présenté au MNAM comme une "installation" alors qu'il s'agissait du résultat d'une concrétion d'œuvres et d'objets accumulés par Breton au gré de ses découvertes, rejets, etc., concrétion qui n'avait été finalement arrêtée qu'avec la mort du poète (la réinterpréter comme une "installation" tient donc d'un tour de passe-passe discutable...). Cela paraît corroboré par la précision donnée sur le site web d'ABCD, qui indique que la salle d'art brut sera au niveau 5 du Centre, et qu'elle ouvrira du reste le 23 juin, niveau 5 donc où se situe aussi le fameux "Mur" de Breton. Il est ajouté qu'"Une exposition sur l’art brut à partir de la donation sera programmée après les grands travaux de 2023, accompagné d’un catalogue raisonné."
Une autre condition demandée par Bruno Decharme est que la "donation va s’accompagner d’un pôle de recherche au sein de la bibliothèque Kandinsky afin de poursuivre les travaux déjà engagés sur l’art brut." (citation d'après le communiqué paru sur le site web d'ABCD).
Ont été extraits de la collection complète (qui contient au total 5000 œuvres, dont depuis quelques temps 1500 photos "brutes") des auteurs choisis comme "la quintessence de l'art brut" (selon des termes, prêtés à Bruno Decharme par Rafaël Pic dans le Quotidien de l'Art). La collection d'ABCD ne garderait ainsi que des œuvres "moindres" (toujours selon Le QdlA). Cette quintessence serait représentée par Aloïse, Wölfli, Darger, Jeanne Tripier, Crépin, Lesage, un Barbu Müller, légendé à présent (depuis ma découverte de l'identité de son auteur) "Antoine Rabany dit Le Zouave, Sculpture Barbu Müller", etc. (on en apprend plus encore sur le site web d'ABCD).
En se retournant vers une récente newsletter de l'ineffable Christian Berst, on découvre d'autres noms d'"artistes" (mot particulièrement confusionniste, je ne le répéterai jamais assez) présents dans cette donation: "Joseph Barbiero, Franco Bellucci, Julius Bockelt, Anibal Brizuela, Jorge Alberto Cadi, Raimundo Camilo, Misleidys Castillo Pedroso, Raymond Coins, James Edward Deeds, Fernand Desmoulins, John Devlin, Janko Domsic, Eugène Gabritchevsky, Giovanni Galli, Madge Gill, Ted Gordon, Emile Josome Hodinos, Josef Hofer, John Urho Kemp, Davood Koochaki, Zdeněk Košek, Alexandre Lobanov, Joseph Lambert, Raphaël Lonné, Dwight Mackintosh, Kunizo Matsumoto, Dan Miller, Koji Nishioka, Jean Perdrizet, Luboš Plný, Royal Robertson, André Robillard, Vasilij Romanenkov, Yuichi Saito, J.J. Seinen, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Mary T. Smith, Harald Stoffers, Ionel Talpazan, Dominique Théate, Miroslav Tichý, Mose Tolliver, Oswald Tschirtner, August Walla, Melvin Way, George Widener, Scottie Wilson, Hideaki Yoshikawa, Anna Zemánková, Henriette Zéphir, Carlo Zinelli..." (je surligne en gras ceux qui me paraissent relever de la fameuse quintessence, selon moi ; mais quelques-uns sont insuffisamment connus de moi: Julius Bockelt, Anibal Brizuela, Jorge Alberto Cadi, Misleidys Castillo Pedroso, Raymond Coins, les Japonais (souvent issus d'ateliers)).
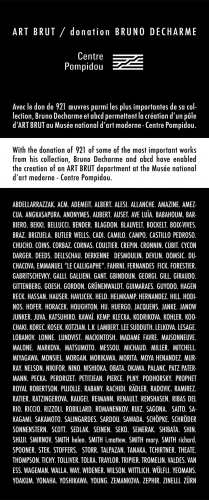
Ci-dessus la liste complète des auteurs faisant partie de la donation ABCD ; un petit jeu dès à présent, qui y manque? Je n'aperçois personnellement pas, ni Pépé Vignes, ni Jean Grard...
La quintessence de l'art brut, si ici de nombreux noms sont en effet marquants, il restera à ne pas oublier d'aller la rechercher là où elle est la plus présente, à savoir encore et toujours à la Collection de l'Art Brut, au Château de Beaulieu, à Lausanne, rassemblée au départ par Jean Dubuffet, puis notablement agrandie depuis 1976 (aujourd'hui près de 70 000 œuvres dont 700 sont présentées en permanence). Ceci dit pour relativiser le grand renfort de trompettes des récents laudateurs de Bernard Blistène (directeur du MNAM qui a réalisé l'accord avec Bruno Decharme, et qui part à la fin du mois de juin): le Quotidien de l'Art et aussi le galeriste Christian Berst qui dans une dernière newsletter grimpe littéralement aux rideaux de l'extase, en affirmant avec le plus grand aplomb : "L’exceptionnelle donation de près de 1000 œuvres¹ d’art brut que Bruno Decharme fait à Pompidou permet désormais d’écrire un chapitre essentiel de l’histoire de l’art. Tandis que l’art brut sort de l’angle mort où il fut trop longtemps relégué, le Musée national d’art moderne peut s’enorgueillir de son audace en devenant une référence et un exemple pour les institutions du monde entier."
"L'angle mort où "l'art brut aurait été trop longtemps relégué...", ne serait-ce pas avant tout l'angle mort de sa valeur marchande, dans l'esprit de ce monsieur qui ne se sent plus?
Et puis "l'audace" du MNAM, ça me fait bien rigoler...
La réputation de l'art brut, son histoire, sa connaissance sont tout de même bien enregistrées, et depuis fort longtemps. Il n'y a que ceux qui ne voulaient pas en entendre parler pour l'ignorer (et ceux-ci continueront dans la voie de ce mépris, ce qui vaut mieux qu'un respect assorti de mauvaise volonté)². Et précisément, si l'art brut est désormais bien connu, et conservé, c'est en particulier grâce à la séparation muséale, la distinction affirmée initialement entre l'art brut et le reste du champ artistique, qui furent mises en place par Dubuffet, Michel Thévoz, Lucienne Peiry en Suisse, continuée aujourd'hui par Sarah Lombardi. Même au LaM, l'Aracine a obtenu que les collections d'art brut soient conservées dans un département distinct. Cela a permis d'identifier clairement ses spécificités, en particulier les substrats culturels à l'œuvre par dessous ces créations si originales,
De l'art brut, de plus, n'en déplaise à ces messieurs, le MNAM en conservait déjà, dispersé certes au milieu de ses collections (quelles preuves, du reste, que cette dispersion ne recommence pas au bout d'une dizaine d'années de présentation de la donation?). A l'occasion de la donation Daniel Cordier, par exemple, un bel ensemble de peintures de Gabritschevsky sont entrées dans les collections du MNAM. On trouve également des peintures de Séraphine au MNAM ou de l'Algérienne Baya, défendue en son temps par André Breton. Des expositions remarquées ont été consacrées à l'art brut très tôt, que l'on songe à "Paris-Paris" (1981) où une merveilleuse salle lui était consacrée (avec un remarquable texte d'Henry-Claude Cousseau dans le catalogue, qu'on ferait bien de rééditer séparément, pour le mémoriser davantage), ou à Adolf Wölfli, et à Miroslav Tichy, sans parler des expos consacrées à Paul Eluard (où il fut question d'Auguste Forestier) et surtout à André Breton et ses enthousiasmes pour les autodidactes en tous genres (voir la roue ovale d'Alphonse Benquet dans le fameux "Mur", que j'ai contribué à faire identifier par les responsables du musée, voir cette note ancienne de mon blog).
Mais peut-être que cette dispersion, ce mélange de l'art brut avec l'art moderne ou contemporain, est justement ce qui plaît à un Christian Berst, dont les actions et les proclamations, depuis quelque temps, ne cessent de militer pour un tel mixage (voir sa galerie supplémentaire ouverte récemment, au titre snob, "The Bridge", qui cherche les confrontations entre brut et contemporain ; voir aussi les auteurs qu'il met en avant pour leur cérébralité digne de l'art contemporain le plus creux).
Je crois que personne ne l'a souligné. L'Etat français, en permettant l'entrée de ces donations d'art brut (l'Aracine au LaM tout d'abord en 1999, puis aujourd'hui une part de la collection Decharme à Beaubourg) dans de prestigieuses collections muséales d'art moderne et contemporain, réussit ce qu'avait précisément refusé Dubuffet vers 1970, après l'exposition d'art brut de 1967 au Musée des Arts Décoratifs (première grande exposition d'art brut publique et ce, dans un lieu institutionnel ; 1967... Messieurs les cuistres!), à savoir la confusion entre art brut et art culturel. Car, lorsqu'il réfléchissait au legs de sa collection dans ces années-là – qui allait aboutir ensuite à une donation à la Ville de Lausanne en 1972 –, il avait été proposé à Jean Dubuffet une intégration de sa collection au musée d'art moderne, comme l'a signalé Lucienne Peiry dans son livre L'Art Brut (première édition, 1997, chez Flammarion, voir page 172 ; réédition récente) qui retrace l'histoire de la collection. Le peintre-théoricien-collectionneur avait fermement décliné l'offre!
Trente ans plus tard, et aussi aujourd'hui cinquante ans plus tard, l'Etat français récidive. Ceci dit, c'est moins grave, puisqu'entre temps l'art brut s'est constitué en catégorie socio-esthétique au niveau international. Il sera difficile de le rendre soluble dans l'art content-potpot. D'autant qu'il ne cesse de se ramifier en branches et racines diverses et multiples, et que la créativité continue de se développer, toujours aussi anarchiquement en dépit des tentatives réificatrices de tous ordres...
Enfin, qu'on me permette de réitérer un propos que j'avais formulé il ya déjà longtemps dans un vieil Artension (article sur le musée de Laduz, « Un triangle d’or », Artension n°6, octobre 1988), pour moi l'art brut, par son substrat largement imprégné par la culture populaire des sans-grade a plus de cousinage avec l'art populaire curieux et l'art naïf visionnaire qu'avec l'art moderne et contemporain. C'est l'indice d'une bêtise bien française que d'avoir voulu depuis cinquante ans l'insérer à toute force dans les musées d'art moderne. Les Américains de ce point de vue se sont montrés bien plus intelligents en intégrant, au contraire, l'art brut dans un musée d'art populaire, à New York. Cela fait infiniment plus sens en effet.
Et nous, ici, au lieu d'un musée vivant de l'art populaire, on n'a que le MUCEM... qui expose ces temps-ci, Ô misère!, Jeff Koons...
_____
¹ Ici, Christian Berst, sans doute légèrement en transe, suivant le Quotidien de l'Art qui propose le même chiffre de "près de 1000 oeuvres" arrondit exagérément (voir plus haut le chiffre exact de 942 œuvres).
² A ce point, il n'est pas inutile de renvoyer mes lecteurs à une protestation publiée récemment dans Beaux-Arts magazine par le galeriste new-yorkais Andrew Edlin, pour réagir aux critiques de Christian Berst (parues dans le même journal) visant les Outsider Art Fair (Salon d'Art Brut et marginal) qu'Edlin monte régulièrement à New-York et à Paris (qui contribuent à l'évidence, là aussi, à la connaissance que le public peut acquérir du champ des œuvres brutes, naïves, ou singulières). Proférée sur un ton fort courtois et feutré, la réaction d'Edlin instruit au fond un procès en cuistrerie...
31/05/2021
Festival Hors-Champ des arts singuliers au cinéma (documentaire seulement, hélas...): le retour!
L'année dernière, ce sympathique festival organisé par l'Association Hors-Champ sur un jour et demi avait été annulé pour cause de virus.
A souligner dans ce programme qui sera diffusé les 4 et 5 juin dans la salle L'Artistique, 27 boulevard Dubouchage à Nice, les films consacrés à Lee Godie, à Italo Farinelli (nouvel environnement populaire spontané que je ne connaissais pas), ou les films de Lespinasse sur La Pommeraie et Pépé Vignes.. Pour le reste, je botte en touche, soit parce que je ne connais pas, soit parce que je trouve les films assez quelconques.
Il ne s'en est pas complètement remis, puisque cette année, il revient quand même, mais en petite forme, avec un programme allégé (au point de vue variété et originalité), et dans un nouveau lieu d'hébergement, la salle de l'Artistique – l'auditorium du MAMAC à Nice n'étant pas disponible, cause Covid, et l'Hôtel Impérial, le délicieux Hôtel Impérial ayant, trois fois hélas!, fermé ses portes, apparemment définitivement... condamné par le Covid et ses répercussions économiques.
On se souviendra avec une nostalgie désormais poignante des rencontres que les invités à ce festival (dont j'ai été) eurent à maintes occasions le bonheur de vivre, dans la salle de séjour très cinématographique de ce vieil Hôtel Impérial, avec ses vases, ses bouquets de fleurs, ses tableaux, ses murs couverts de tapisseries, ses tentures, ses meubles baroques, ses poutres peintes, ses fauteuils en cuir – où parfois étaient projetés certains films, comme ceux de Guy Brunet, un peu longs, mais diffusés comme en avant-premières, dans une sorte de projection familiale – ou dans la salle de réception du petit déjeuner, avec son lustre de cristal, sa fresque de putti au plafond, ses baies donnant sur un jardin abrité à l'ombre de quelques palmiers, où dormait, marginalisée, une table ronde en rocaille attendant ses chevaliers, devenus définitivement fantômes....

La façade de l'Hôtel Impérial (et la clé de la chambre 25, recto et verso ci-dessus, avec son message original en cas d'oubli), photos Bruno Montpied, juin 2018.

Les Vénus et les amours au plafond de la salle à manger, ph. B.M., 2018.
Dans ma mémoire, j'aime à faire défiler les personnages d'un certain matin au petit déjeuner, Caroline Bourbonnais, avec qui je n'avais jamais eu l'occasion de me retrouver en tête à tête, Francis David, ce photographe mystérieux et réservé, comme venu d'un autre espace-temps, eût-on dit, Claude Massé que l'on m'avait dépeint bourru, difficile, mais qui me parut au contraire aimable et charmant (était-ce l'atmosphère de ce lieu magique qui métamorphosait tous ceux qui y passaient?), Vincent Monod le rire jamais loin des lèvres, Philippe Lespinasse, à la fois semblable à un passager tombé l'instant d'avant de la Lune et l'œil bientôt narquois, et Pierre-Jean, l'ineffable Pierre-Jean Wurst, l'hôte généreux et incapable de ne pas blaguer, venant faire la revue de ses invités, Guy Brunet... Marc Décimo... Alain Bouillet... Charles Soubeyran, un peu pontife en dépit de ses sandales sans chichis... Anic Zanzi, de la Collection de l'Art Brut de Lausanne, comme sur la défensive...
Affiche de ce 24e festival... Avec son titre choc habituel, tel qu'aime à en choisir, à chaque festival, l'équipe de l'association Hors-Champ...
19:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Hommages | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hôtel impérial à nice, association hors-champ, cinéma documentaire et arts singuliers, lee godie, italo farinelli, philippe lespinasse, caroline bourbonnais, francis david, claude massé, guy brunet, pierre-jean wurst, on n'est pas des gueux |  Imprimer
Imprimer
20/05/2021
Info-Miettes (37)
Musées, galeries rouverts
Citons quelques musées qui rouvrent depuis le 19 mai: à Laval: celui de l'Art Naïf et des Arts Singuliers (qui vient de finir de construire un site web) ; à Paris : la Galerie Claire Corcia (qui prolonge son exposition consacrée à Hélène Duclos qui s'était retrouvée victime du confinement), la Galerie Pol Lemétais (avec des outsiders américains du 19 mai au 6 juin) et la Galerie Polysémie qui reviennent faire un tour pour un mois dans les locaux de l'ancienne galerie de Béatrice Soulié rue Guénégaud (6e ardt), la Galerie Les Yeux Fertiles (avec une exposition intitulée "Boîtes à mystères"), également dans le 6e, le Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne, dans le 14e (qui prolonge jusqu'au 13 juin prochain son intéressante expo, "Follement drôle", pas vue du public, consacrée à l'humour des artistes pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, les oeuvres présentées provenant du MAHHSA et, fait bien plus inédit, de la Collection Prinzhorn à Heidelberg, voir l'article que j'ai consacré à l'expo dans le n°166 d'Artension en mars-avril dernier) ; A Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, le LaM (dont mon petit doigt m'indique qu'ils préparent là-bas une exposition prévue pour l'année prochaine sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, car je l'ai, dans un de mes anciens textes, appelée de mes vœux : Art brut et surréalisme ; on sait que contrairement à la collection de l'Art Brut à Lausanne, les conservateurs du LaM en charge de l'art brut ont une sensibilité particulière envers André Breton et les surréalistes, l'idée de l'expo est donc logique) ; à Marseille : la Galerie Béatrice Soulié, désormais seulement installée dans la cité phocéenne, monte une "Rétrospective Louis Pons (1927-12 janvier 2021)" du 11 juin au 7 août 2021, voir ici le dossier de presse ; en Belgique: le Musée de la Création Franche de Bègles est, on le sait, fermé pour travaux (environ deux années), cela ne l'empêche pas de faire des expo hors-les-murs comme celle qui s'ouvrira du 21 mai au 12 décembre 2021 à la Fondation Paul Duhem, à Quevaucamps.

Vue de l'expo Outsider Roads organisée par Pol Lemétais dans l'ancienne galerie Soulié, ph. Galerie Lemétais. ; au mur divers outsiders américains comme Kenneth Brown ou Henry Speller, voire John Henry Tooner...
*
PIF, quésaco?
Cet acronyme signifie Patrimoines Irréguliers de France. Il s'agit d'une association animée par trois Italiens, Roberta Trapani, Chiara Scordato, Danilo Proietti et un Français, Olivier Vilain. ils viennent de finaliser leur site web où l'on apprend plus sur leur action et leurs projets, qui flirtent avec les cultures alternatives. Ils s'intéressent comme moi aux environnements atypiques, mêlant dans un même sac environnements et artistes marginaux plus ou moins inventifs (Jean-Luc Johannet, Danielle Jacqui, Jean Linard...) et créations environnementales spontanées plus strictement populaires.

Jean-Luc Johannet, une maquette de ville imaginaire exposée dans le hall de la Halle Saint-Pierre dans le cadre d'une exposition montée par le PIF en 2018, ph. Bruno Montpied.
Je les soupçonne parfois d'être attirés avant tout par les artistes marginaux, et un peu moins par les créateurs autodidactes amateurs (malgré les textes de Roberta Trapani qui est plus sensible à ces derniers que ses complices). Un autre point qui me chiffonne est le relatif sous traitement, sur leur site web, des références aux autres acteurs défendant le domaine (mon blog qualifié "d'historique" - merci pour le coup de vieux que je me prends au passage!) - n'étant pas oublié cependant, merci pour lui). L'action de ce collectif de quatre personnes, on s'en convaincra aisément en parcourant leurs professions de foi, se veut clairement politique, mettant en avant les mots utopie, libertaire, indiscipline, surréaliste-révolutionnaire, ZAD, clandestinité, illégalité, excusez du peu... Ils ont édité une revue, intéressante, mais au format et à la mise en pages un peu difficiles à aborder, Hors-les-normes, qu'elle s'appelle, empruntant son titre à l'art défendu à la Fabuloserie... Je signale aussi pour finir qu'ils font actuellement un petit reportage filmique sur la restauration de la tour Eiffel de Petit-Pierre dans le parc de la Fabuloserie (voir l'appel de ces derniers que j'avais répercuté, et qui a été couronné de succès, dégageant les fonds nécessaires à la restauration). A suivre, donc...
*
Joseph "Pépé" Vignes, une expo à la Fabuloserie et un film
A la Fabuloserie, à Dicy (Yonne), est montée pour cette saison (tout l'été) une expo bâtie à partir des œuvres de Pépé Vignes dans le fonds permanent de la Fabuloserie. Deux photos que m'a prêtées la Fabulose Sophie Bourbonnais donnent envie d'aller musarder dans cette belle région :

Photo Archives Fabuloserie.
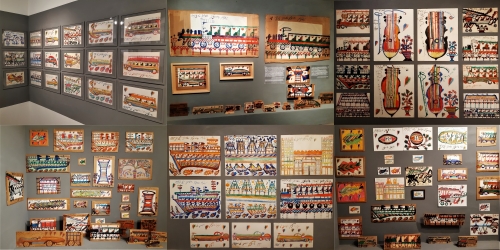
Vue des différentes œuvres de Pépé Vignes à la Fabuloserie-Dicy, archives Fab.
J'aime particulièrement les graphismes aux crayons de couleur (plus stables dans le temps que les feutres d'école que Vignes utilisait) de cet ancien tonnelier, qui en dépit d'une vue déficiente (il dessinait l'œil collé au support) mettait toute son énergie à concentrer dans ses bus, trains, voitures, bateaux, tonneaux, instruments de musique, bouquets de fleurs, poissons, avions, l'amour qu'il portait à leurs aspects. Plus immédiate poésie visuelle que cela, tu meurs... Tous ceux qui se moquèrent de lui, le brocardant à l'envi quand il jouait de son accordéon dans les bals populaires à Elne et sa région (pays catalan), doivent rire jaune aujourd'hui quand ils découvrent par hasard qu'il est désormais considéré comme un grand créateur (en particulier lorsque l'on découvre la rue qui a été octroyée à sa mémoire à Elne).
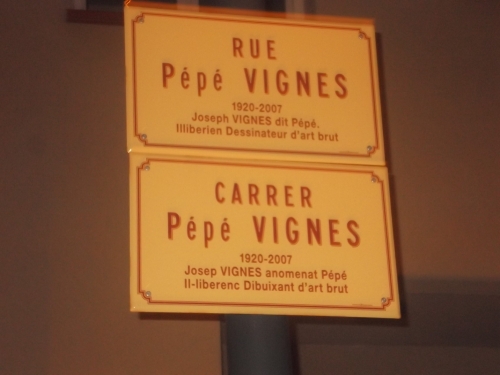
Photo Illibérien, prise à Elne.
La Fabuloserie et Philippe Lespinasse se sont alliés pour que ce dernier réalise un film à partir d'extraits de la "capture" filmique qu'Alain Bourbonnais avait tournée dans les années 1970. Le réalisateur a gardé quelques passages du film où l'on aperçoit Vignes dans son petit logement, et il a fait alterner ces extraits avec des fragments d'entretien avec divers témoins qui ont connu Pépé Vignes, comme Jean Estaque, cet artiste qui m'est cher, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans plusieurs notes précédentes. On trouve le DVD du film dans la librairie de la Fabuloserie-Paris, rue Jacob (6e ardt).
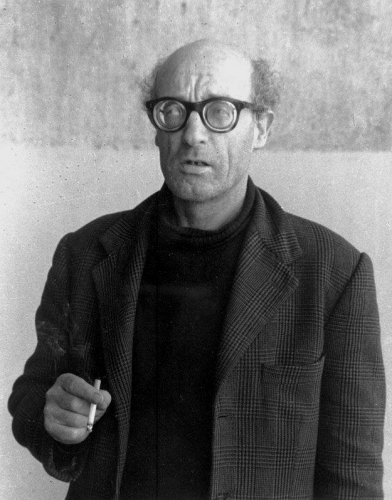
Joseph "Pépé" Vignes, avec ses lunettes à double foyer, ph. JDLL, transmise par "Illibérien".
Jaquette du DVD de Philippe Lespinasse "Pépé Vignes: c'est du bau travail!", co-production Fabuloserie et Locomotiv films.
*
Escale Nomad aussi dégaine ses trouvailles de printemps profitant du déconfinement...
Cette fois, la galerie nomade de Philippe Saada fait son nid, du 26 mai au 6 juin rue Notre-Dame de Nazareth (3e ardt) dans une galerie appelée "L'Œil bleu", voir ci-dessous...
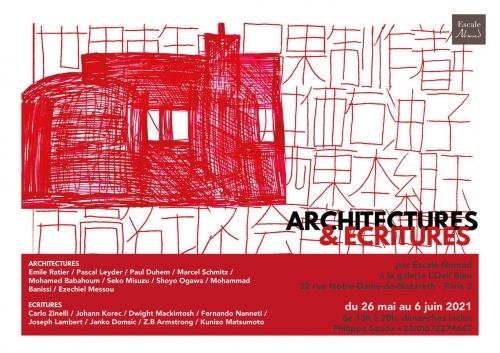
On notera de prestigieux et classiques nouveaux venus dans le stock de Saada, quand on y découvre Emile Ratier par exemple, ou encore Carlo Zinelli et Fernando Nanetti, qui avait graffité les murs de la cour dans son hôpital psychiatrique à Volterra en Italie. Comment il s'y est pris, le Saada? il a fauché un morceau de mur de l'hosto, ou quoi?
20:43 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Environnements singuliers, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : galerie lemétais, mahhsa, manas de laval, artension, collection prinzhorn, art brut et surréalisme, louis pons, galerie soulié, création franche, fondation paul duhem, pif, roberta trapani, architectures et environnements alternatifs, fabuloserie, art hors-les-normes, pépé vignes, philippe lespinasse |  Imprimer
Imprimer
18/05/2021
Une caricature de Régis Gayraud
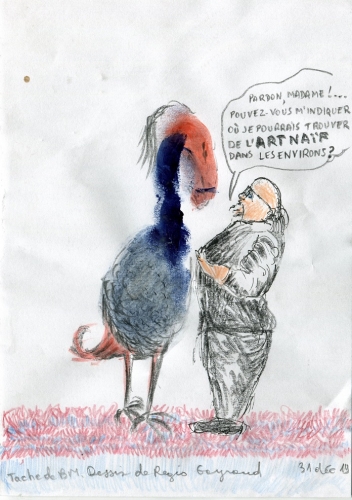
Régis Gayraud, "Pardon Madame...", dessin au crayon sur tache réalisée préalablement par Bruno Montpied aux crayons aquarelle sur papier, 31 décembre 2019, coll. B.M.
01:18 Publié dans Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : régis gayraud, bruno montpied, art naïf, caricature |  Imprimer
Imprimer
12/05/2021
Les statues angoissantes de Paris (1)
Comme Dubuffet qui ne pouvait plus voir d'art dans les lieux impartis aux expositions durant l'Occupation du début des années 1940, du fait de la présence des Nazis justement, et qui se rabattait donc sur les graffiti, notamment ceux photographiés par Brassaï (voir les livres sur la question, et la revue Minotaure), je cherchais toujours à voir durant les derniers confinements intra muros à Paris les endroits où l'on peut librement accéder à de l'expression artistique en l'absence des musées fermés depuis des lustres (en dépit du fait que l'on pourrait imaginer des jauges, des écarts entre les visiteurs, des horaires plus grands, des ouvertures en nocturne, etc.). Au lieu des Nazis, c'est la Covid 19 qui nous occupe en effet.
A force de me promener dans Paris que je ne quitte plus et sillonne donc de long en large, je me suis rendu compte que plusieurs artefacts présents dans les rues, des statues dans les lieux publics, étaient étrangement angoissants, bizarrement choisis, je trouve... Pour confronter mon impression à celle de mes lecteurs, je propose donc ici quelques exemples.

Pompidou, dans un parc près de l'Elysée, grande statue assez effrayante, raide comme un piquet avec comme un balai dans le cul ; il paraît que Claude Pompidou, quand elle a découvert la statue, a pris peur et s'est enfuie à toutes jambes ...

Autre grande gigue, installée sur les bords de la Seine, vers le Pont de l'Alma, un "hommage à Komitas et aux 1 500 000 victimes du génocide arménien de 1915 perpétré dans l'empire ottoman", statue passablement lugubre à ne pas croiser en pleine nuit sous peine de chopper une dépression fulgurante...

Etienne Martin, Personnage III, jardin des Tuileries ; statues d'aspect cartilagineux, comme des membres humains rongés par l'eau et lentement fossilisés.

Sorte de père Ubu dans le même Jardin des Tuileries, près d'une aire de jeux, présence vaguement menaçante... Grand tas flasque et pourtant solidifié.

Au-dessus de l'entrée d'une crèche collective, rue de La Tour d'Auvergne (IXe ardt), quelques figures de morts-vivants pour accueillir au mieux les petits...

Ailleurs (rue Andréa Del Sarte, dans le XVIIIe ardt), on préfère les crocodiles comme hôtesses d'accueil...

Et quand les petits enfants seront plus grands, ils auront la joie de retrouver leurs grands-parents à l'image exemplaire de ces deux croulants sur le Déclin du Square Jules Champlain, le long du Père Lachaise, la destination finale qui explique peut-être l'attitude sinistre des deux vieux, tournés vers lui...
(Photos Bruno Montpied)
00:07 Publié dans Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : statues angoissantes de paris, dubuffet, nazis, occupation de paris, covid 19, square jules champlain, pompidou, étienne martin, génocide arménien, sculptures sur les écoles |  Imprimer
Imprimer
07/05/2021
"Le Ciment des rêves, l'univers sculpté de Gabriel Albert", ou comment un inspiré du bord des routes peut être exposable au musée
L'exposition montée au Musée-Jardins Cécile Sabourdy, à Vic-sur-Breuilh, au sud de Limoges, mise en place à ce qu'il semble durant ces mois-ci, sans que le public puisse la voir, consacrée à une quarantaine de sculptures de l'autodidacte naïf Gabriel Albert (1904-2000), ouvrira ses portes, on l'espère tout bientôt (le 19 mai?).
L'envers du décor, petit sujet sur les étapes du transfert des oeuvres de Gabriel Albert de Nantillé à Vic-sur-Breuilh, une entreprise, à mes yeux, exemplaire...
J'ai déjà eu l'occasion sur ce blog de mentionner les différentes étapes de restauration des statues de son jardin, aujourd'hui propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine (après avoir fait l'objet d'un legs de son auteur à sa commune de Nantillé, en Charente, en 1999, juste avant sa disparition). C'est bien sûr un site que j'ai mentionné honorablement dans mon inventaire des environnements populaires spontanés, Le Gazouillis des éléphants (livre épuisé aujourd'hui, après son édition en 2017 ; l'éditeur se propose de le rééditer dans environ deux ans). J'avais dès 1989 commencé d'en parler dans un article paru dans l'excellente revue littéraire, Plein Chant, où j'ai contribué à introduire l'art populaire brut ou naïf. L'article s'intitulait "Le Ciment des rêves". Edmond Thomas, l'émérite éditeur de Plein Chant, avait repris mon titre comme intitulé de tout le numéro (44) de sa revue. Et voici donc que ce titre connaît, grâce à Stéphanie Birembaut, la directrice du musée Cécile Sabourdy, une seconde jeunesse pour accompagner la présentation hors-les-murs, hors site, des sculptures de Gabriel Albert à l'intérieur du musée de Vicq-sur-Breuilh.

Vue aérienne du Jardin de Gabriel, telle que mise en ligne sur le site web de l'Inventaire Poitou-Charentes.
J'adhère personnellement en plein à ce genre de projet, que certains esprits chagrins pourraient discuter. Doit-on muséifier un jardin de sculptures prévues initialement pour être présentées dans un espace en plein air, pourront-ils rétorquer? Il faut savoir que Gabriel Albert avait eu des velléités de devenir un artiste avant de se convertir, pour gagner sa vie, au métier de menuisier. Ses statues (il en a créé environ 420, actuellement en cours de restauration grâce à l'investissement de la Région) sont des œuvres artistiques, au même titre que les œuvres des artistes savants, issus des écoles d'art ou non. Pourquoi n'auraient-elles pas droit à être présentées aussi dans des espaces muséaux? En en barrant l'accès aux autodidactes environnementalistes, cela ne révèle-t-il pas un désir de les censurer, de les rabaisser? Pourquoi ces œuvres n'auraient-elles pas droit à des explorations menées par des chercheurs, également, qu'ils soient indépendants (comme moi) ou universitaires? Il convient seulement, en les exposant (les dispositifs muséaux sont passionnants à étudier), de tenir compte de leur contexte de présentation à l'origine, en rappelant entre autres comment leurs auteurs les avaient installées au sein de leur vie quotidienne, les insérant au cœur de la vie immédiate.

Tableau portrait de Gabriel Albert et tête d'une de ses statues dans l'exposition "Le Ciment des rêves", au musée Cécile Sabourdy.
Le jardin de Gabriel sera ouvert les mardis et jeudis du 06 juillet au 16 septembre 2021 : de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / contact : 05 49 36 30 05. Selon le site de l'Inventaire Poitou-Charentes, 15 statues en pied, 19 bustes et 9 statues de chats composent l'exposition, qui présente également le portrait de Gabriel Albert, tableau du peintre Marius Levisse (voir ci-dessus), et plusieurs dizaines d’objets provenant de l’atelier du sculpteur-modeleur.
00:48 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : gabriel albert, musée-jardins cécile sabourdy, le ciment des rêves, bruno montpied, stéphanie birembaut, nantillé, environnements populaires spontanés, sculpture naïve |  Imprimer
Imprimer
01/05/2021
Plutôt qu'une nécrologie: je me souviens de mes rencontres avec Marie Jakobowicz
Alors, c'est ainsi, je n'aurai plus jamais l'occasion d'entendre le téléphone sonner et à l'autre bout du fil résonner la célèbre entame " Allôôô...? Céééé Mâââ-rie...", m'annonçant l'inévitable monologue que Marie Jakobowicz, d'un ton un peu désabusé, comme refusant d'avance toute phrase qu'on pourrait lui rétorquer, s'apprêtait à débiter. Ça durait un petit moment, tellement, que j'en lâchais parfois l'écouteur, posais le téléphone et allais vaquer à d'autres occupations. Je revenais cependant bien vite, de peur qu'elle croit qu'on lui avait raccroché au nez... Et invariablement, je constatais qu'elle était toujours en train de parler à l'autre bout. Puis elle rompait brusquement la conversation, disait: "Bon, eh bien, au revoir...", tout à trac, sans que rien ait pu le laisser prévoir. Je me faisais avoir à chaque coup.

Marie Jakobowicz au Musée de la Création Franche à Bègles, pour l'exposition que le musée lui consacrait en 2016 ; ph. archives du Musée de la CF.
Marie Jakobowicz (1934-2020) est morte il y a un an, dans le XVe arrondissement de Paris. Je l'ai appris avec retard, grâce au Musée de la Création franche, à qui elle avait fait donation d'une centaine de ses œuvres ces dernières années (d'autres collections ont conservé de ses oeuvres, la collection Cérès Franco et la Fabuloserie). Nous n'étions que des connaissances, nos relations les plus suivies ayant existé surtout au début des années 1980. Pas vraiment ce que l'on appelle des amis, plutôt des complices, des collègues... Plus âgée que moi, d'une vingtaine d'année, j'étais tombé sur elle à la suite d'une petite annonce dans Libération. Un monsieur qui s'appelait André Chamson (si ma mémoire ne me trompe pas sur l'orthographe de ce patronyme), comme l'écrivain, invitait à exposer dans sa "galerie" du côté de Louveciennes. Je m'y étais rendu pour découvrir avec dépit qu'il ne s'agissait que d'un garage... Mais il m'avait donné le contact d'une personne qui s'intéressait à l'art brut et avec qui j'avais peut-être des points communs. J'ai alors dû lui téléphoner, et, un jour Marie a débarqué dans l'appartement que je partageais avec Christine, ma bonne amie de l'époque, dans le Xe ardt. Elle eut, je pense, toujours de l'intérêt pour les gens plus jeunes qu'elle. Elle donnait des cours particuliers de dessin à des enfants dans son appartement du XIIe arrondissement, très curieuse de ce qui allait provenir d'eux...
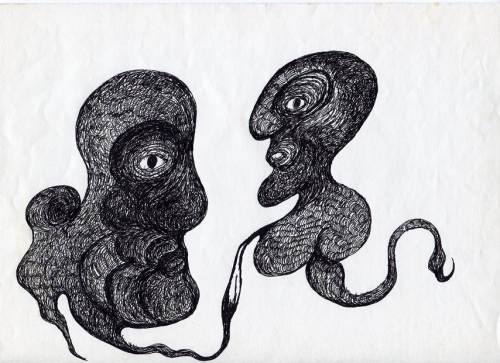
Marie Jakobowicz, sans titre, dessin à l'encre, 21 x 29,7 cm, vers 1984; ph. et coll. Bruno Montpied.
De qui ou de quoi parlâmes-nous? D'art brut sans doute, que je venais de découvrir à travers quelques fascicules du même nom, sans bien en comprendre les limites. Elle non plus je pense ne savait pas exactement à quoi s'en tenir (et je pense qu'elle ne s'en est jamais vraiment souciée davantage par la suite)... Nous étions désireux d'explorer la possibilité de montrer ce que nous dessinions et peignions, et l'art brut – on l'imaginait – paraissait pouvoir accueillir des gens comme nous, non issus des écoles d'art. Ce n'était pas de l'arrivisme de notre part, seulement un besoin naturel de confronter ce que nous créions à un public de gens extérieurs, puisque l'on concevait l'art comme un autre langage, plus essentiel, allant au cœur des choses. Elle me parla d'un ami, Jean Couchat, qui avait envoyé des dessins et avait été pris par la Collection de l'Art Brut à Lausanne (ouverte au public en 1976). C'était donc simple, il suffisait de faire comme lui, et d'envoyer des dessins. C'est ce que je fis. J'expédiais quelques photocopies de mes dessins à Lausanne, que je me vis prestement retourner avec une lettre de refus de Michel Thévoz, quoique bienveillante. Il m'écrivit – avec un mot dont il usait abondamment à l'époque – qu'il ne voyait pas assez de "jubilation" dans mes dessins. En 1983, au Forum des Halles, devant les animateurs de l'Aracine, qui avaient monté leur deuxième exposition dans une salle louée au niveau -3 de ce centre commercial, mes dessins n'eurent pas plus de succès. On me répondit que j'étais trop "décoratif", que cela faisait "BD"... Bref, ça n'était pas pour eux (mais ce fut dit avec une certaine sévérité, bien différente du ton plein d'urbanité de Thévoz). Et c'est vrai que je n'avais au fond rien à voir avec l'art brut, que Madeleine Lommel recherchait. Je le compris mieux plus tard.
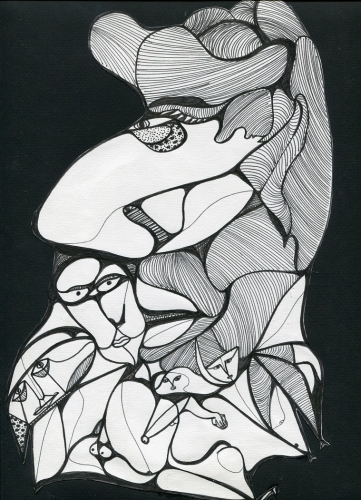
Bruno Montpied, le genre de dessin montré en 1983 aux collectionneurs d'art brut, comme ceux de l'Aracine ou de la Collection de l'Art brut ; ph. B.M.
Je ne peux pas leur en vouloir. De plus, les dessins que j'avais choisis de montrer, étaient très cernés, un peu figés. J'étais bien naïf de vouloir à tout prix les montrer. Et peut-être que je m'étais trompé de destinataires, qui plus est... Marie Jakobowicz, à cette époque, ne recueillait pas plus de suffrages. Cela changea avec le temps.
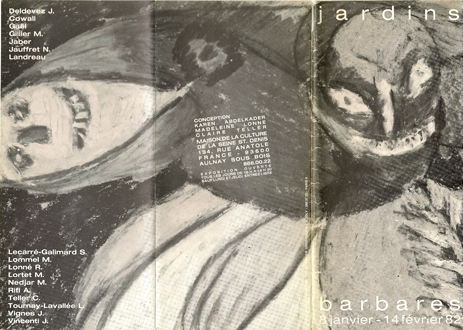
La jaquette dépliée de la pochette de notices (en simples photocopies) ayant servi de catalogue pour la première exposition de l'association L'Aracine, à Aulnay-sous-Bois, "Jardins Barbares", 8 janvier-14 février 1982 ; archives B.M.
L'Aracine, c'était Marie Jakobowicz aussi qui m'en avait parlé la première (en avait-elle entendu parler à la fac' de Vincennes, que Madeleine Lommel, la principale animatrice de l'association, fréquentait aussi?), en me prévenant en particulier de la première expo que l'association monta en région parisienne à la Maison de la Culture de la Seine Saint-Denis, à Aulnay sous-Bois en 1982. Cela s'appela "Les Jardins Barbares", expo mythique de l'association l'Aracine. Celle-ci réussit le tour de force de faire entrer dans un musée national, celui du LaM à Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille, la collection d'art brut qu'elle avait rassemblée en à peine 15 ans. Soit dit entre parenthèses, les trois animateurs de l'Aracine (Lommel, Nedjar et Teller) obtinrent ainsi d'inclure une collection d'art brut dans un musée d'art moderne et contemporain, ce que Dubuffet pour sa part avait décliné hautement, suite à la proposition du ministre de la Culture de l'époque, Michel Guy, au début des années 1970. Selon Dubuffet, l'art brut n'avait pas à être mélangé à l'art moderne. A Lausanne, la collection a trouvé un espace à elle seule dévolue, et c'est aussi bien.
Au LaM, cela dit, la collection d'art brut jouit tout de même d'un espace indépendant, ce qui est étrange lorsque l'on se rend là-bas. L'art brut irradie des ondes qui le séparent des autres collections plus contemporaines et modernes, montrant bien qu'il est quelque chose d'autre, n'en déplaise à certains marchands et critiques d'art actuels.
Autre aussi se sentait Marie Jakobowicz alors. Elle avait des préoccupations, des hantises bien légitimes (quand je l'ai rencontrée, elle ne savait pas encore de façon assurée ce qui était arrivé à son père, dont elle n'ignorait pas qu'il avait été déporté par les Nazis, tandis qu'elle et sa mère, plus un cousin, avaient été cachés par la concierge de leur immeuble à la cave, la veille de la rafle du Vel d'Hiv' ; elle apprit véritablement le sort de son père – tué par les Nazis à Auschwitz – seulement au début des années 1990). J'étais assez différent, polarisé sur d'autres motifs, et issu d'une famille de Français ordinaires. Critiques vis-à-vis de la société, nous l'étions tous deux, mais sans être de la même génération. En 1966, année de la mort d'André Breton, elle était dans le public du colloque sur le surréalisme à Cerisy-la-Salle (on retrouve ses interventions dans les actes du colloque dans certaines discussions suivant les conférences, actes qui ont été republiés chez Hermann en 2012). Moi, en 1966, j'avais 12 ans et j'ignorais tout de ces sujets, n'en ayant jamais entendu parler dans ma famille qui était globalement ignorante des événements culturels. 1968 arrivant derrière, Marie, qui avait 34 ans, fut touchée en profondeur par les événements, les nouvelles problématiques, les libérations des mœurs surgissant alors. Sur moi, qui n'avais que 14 ans au même moment, les événements provoquèrent aussi une onde de choc, quoique atténuée dans la gangue de coton où m'enfermait ma famille.
Notre rencontre, vers 1980 ou 1981, a tenu donc du hasard objectif. Par elle, j'entendis parler de Michel Nedjar, d'Art Cloche, d'Ody Saban... Qui relevaient plutôt des "Singuliers de l'Art" (Nedjar seul y figurait du reste), terme qu'Alain Bourbonnais et Suzanne Pagé avait mis à la mode au moment de l'exposition du même nom en 1978 au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris. 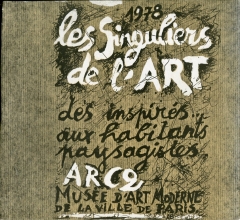
Après "les Jardins Barbares", je ne lâchai plus l'Aracine jusqu'au début des années 1990, me plongeant dans les problématiques de l'art brut de mon côté sans fin, tandis que Marie restait plus distante vis-à-vis de ces sujets. Elle se sentait plus concernée par la politique, les minorités opprimées – ou plutôt les minorées, si l'on pense aux femmes elles-mêmes –, par les migrants, et cela s'accentua à partir de 2000. Cela se déduisait de nos quelques échanges, mais je l'ai compris davantage en relisant la petite monographie que lui édita André Rober en 2015.
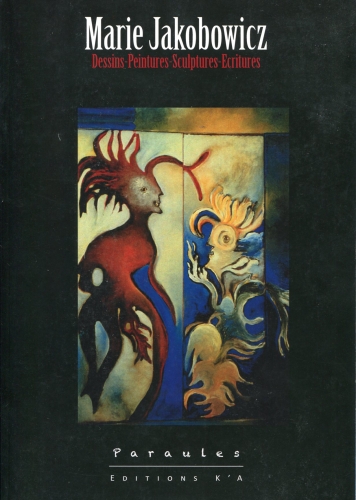
Marie Jakobowicz, dessins, peintures, sculptures, écritures, éditions K'A, février 2015.
Marie Jakobowicz, sans titre (?), dessin au pastel sur papier Canson noir, 50 x 65 cm, collection Cérès Franco.
Quad je l'ai rencontrée elle était en plein dans la création de dessins au pastel ou à l'encre de Chine. Il semble que cette période ait duré de 1980 à 1985 (d'après une notice biographique parue sur le site web de la Collection Cérès Franco). Par la suite, elle se mit à relativiser cette production (et l'abandonner, à mon avis une erreur ; elle disait même que cela lui venait trop facilement), préférant insister sur le fait qu'elle s'était mise à la sculpture, voulant avec ostentation montrer qu'une femme, même fragile comme elle (elle souffrait alors de vertiges de Ménière qui la faisait s'écrouler dans les lieux où elle restait trop longtemps debout), était capable de se colleter à des matériaux lourds, a priori peu maniables par une "faible" femme... Elle voulut aussi par la suite, au fil des années, me démontrer que l'art pour elle se devait de s'engager au service de causes politiques, en l'occurrence celle des Palestiniens, ou des migrants, ou de l'anti racisme. Je comprenais fort bien, étant donné son histoire personnelle, la tragédie familiale dont elle et sa parentèle avaient été victimes, qu'elle subissait une pression mentale terrible de ces côtés-là. Mais je n'étais pas d'accord avec cette mise sous tutelle de l'expression créative, et lui répétais, à chaque fois que je la voyais, que sa période des pastels était ce que je trouvai de plus fort dans sa production. En témoignage d'amitié, après l'exposition collective que Danielle Jacqui m'avait laissé le loisir d'organiser dans une salle, avec 16 artistes ou créateurs que j'avais sélectionnés, dans le cadre du 9e Festival d'art singulier d'Aubagne, elle finit par m'offrir un des dessins sur papier Canson qu'elle y exposa, en format raisin, le genre de format qu'elle affectionnait.

Vue de la salle "carte blanche à Bruno Montpied" dans le 9e festival de l'art singulier d'Aubagne (2006) ; au premier plan, des sculptures de Bernard Javoy, et de Roland Vincent, au fond, de gauche à droite: Marilena Pelosi, Michel Boudin, Marie Jakobowicz, Olivier Jeunon et Pierre Albasser ; ph. B.M.

Marie Jakobowicz, sans titre, pastel sur papier Canson noir, 50 x 65 cm, ph. et coll. B.M.
Je n'ai en effet quasiment jamais choisi (à quelques exceptions près au début de ma production) de plier l'inspiration qui préside à l'expression graphico-picturale à la défense ou l'illustration d'une cause politique ou idéologique. L'art à mon sens n'est jamais plus fort que lorsqu'il se déploie sans autre but que le message inconscient qu'il cherche à délivrer.

Bruno Montpied, Portrait de Marie Jakobowicz, 30 x 30 cm, 2021.
13/04/2021
Nous en étions au 37e confinement.... (Une vision de Pierre Chevrier)
"Nous en étions au 37è confinement…Onze ans !...Depuis onze ans périodiquement l’Etat imposait des temps plus ou moins longs où on ne devait pas quitter le domicile, et les conditions devenaient de plus en plus contraignantes à chaque fois ; car, après chaque dé-confinement, l’épidémie reprenait de plus belle et se renforçait, avec son lot de victimes ; le traitement était devenu une course à l’échalote, car le virus mutait très rapidement, rendant obsolète tous les vaccins qui avaient été mis en œuvre. L’application du dernier confinement datait de plus de deux ans, et cette fois, tout le monde était convaincu que la vie sociale ne reprendrait plus ; les gens s’étaient résignés à fonctionner en autonomie dans les villages.
Chez nous, au début, on avait relié les maisons entre elles par des tunnels de fortune, un peu par amusement, juste histoire de braver les directives en allant chez les voisins porter quelques boissons ou échanger quelques plats ; ou jouer au tarot. Avec le temps, le système s’était perfectionné et on avait consolidé les passages, qui devinrent partie intégrante de nos habitations. De confinement en confinement, comme il nous semblait acquis que la situation mondiale ne pourrait
pas s’améliorer, on avait donc fini par construire des passages en dur ; et même, en creusant le sol (ce qui est particulièrement difficile par ici) des boyaux de communication qui nous mettaient hors de vue des brigades de surveillance, qui d’ailleurs arrêtèrent vite de circuler..."
Pour lire la suite, on peut cliquer là dessus... : Pierre Chevrier VENTILATION 3.pdf

Bruno Montpied, Ecroulement du masque, 31 x 23 cm, 2020.
17:06 Publié dans Art singulier, Littérature, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : confinement, covid 19, tunnels, pierre chevrier, masque, bruno montpied, écroulement |  Imprimer
Imprimer
03/04/2021
Disparition de Charles "Cako" Boussion (1925-2021)
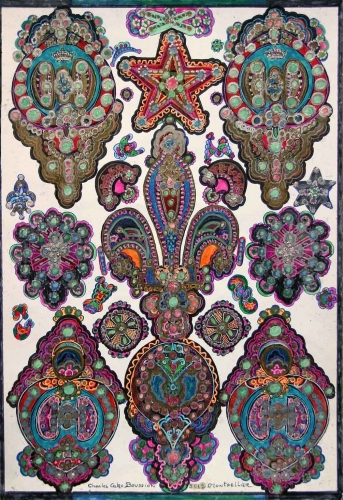
Charles Boussion, Décorations et enluminures, le lys symbole de pureté et fleur royale, 2003-2012.
En feuilletant le site web du Musée de la Création franche, j'ai appris l'événement que je redoutais depuis quelque temps, le décès de l'auteur d'art brut montpelliérain Charles Boussion que j'étais allé visiter chez lui en 2013, ce qui me permit de rédiger un article à son sujet dans la revue Création Franche (n°40, juin 2014), que j'avais intitulé "L'art intarissable de Charles "Cako" Boussion". Car, intarissable était bien l'adjectif qui s'imposait concernant ce raconteur impénitent, aussi profus en paroles qu'en peintures.

Portrait de Charles Boussion, avec la publicité pour le parfum "Cuir de Russie" qu'il vendait comme représentant de commerce, ph. Bruno Montpied, Montpellier, 2013.
Restera une oeuvre variée, riche de couleurs et d'enluminures aux ornementations diverses qu'il fera bon inventorier un jour, pour une rétrospective, qui sait? Il ne faudra rien oublier, car on n'a que trop tendance, concernant Boussion, à ne retenir que ses icônes décalées à l'ornementation touffue. Or, il avait plus d'une corde à son arc. En particulier, il aimait croquer des personnages de fantaisie.
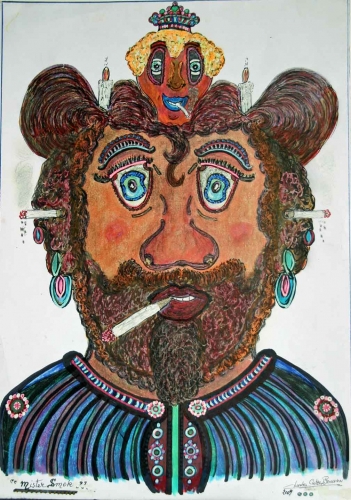
Charles Boussion, Mister Smok, 42x29,7cm, 2009, ph. et coll. B.M.
Plusieurs collections d'art brut publiques et privées possèdent des œuvres de lui (le musée de la Création Franche par exemple en possède 103). Sur ce blog j'ai plusieurs fois parlé de ce créateur atypique qui se plaignait beaucoup de sa solitude, lui qui quand il était plus jeune, avait connu beaucoup de monde (c'était un homme de relations publiques, ayant exercé de nombreuses années le métier de représentant en parfumerie, cf. le portrait que je fis de lui), mais qui dans son grand âge se retrouvait seul à veiller sur l'amour de sa vie, sa femme bien diminuée.
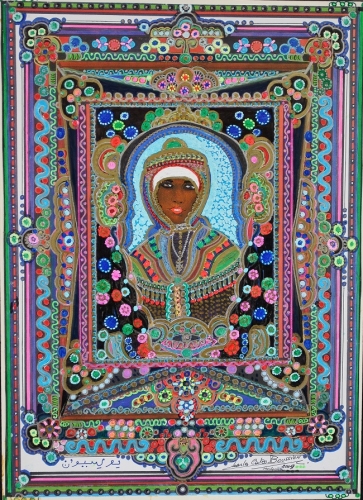
Charles Boussion, 2009 (oeuvre exposée au 57 bis bd de Rochechouart, sur le Mur d'Antoine Gentil en 2018).
Je renvoie le lecteur à cette série de notes. Et ne m'étends pas davantage, les notices nécrologiques me pesant de plus en plus... (Annonçons également la disparition d'une autre figure nonagénaire, le poète, cinéaste et artiste surréaliste Michel Zimbacca qui nous a fait la mauvaise farce de mourir ce 1er avril...).
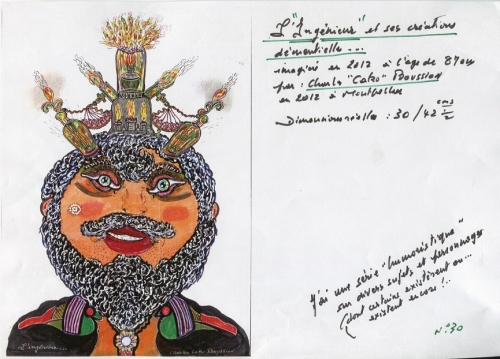
Charles Boussion, "L'Ingénieur" et ses créations démentielles, 2012, image envoyée à B.M. pour sa documentation.
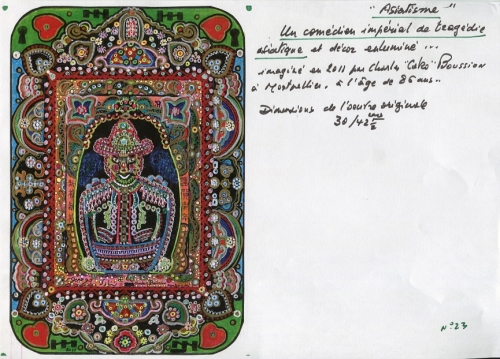
Charles Boussion, "Asiatisme", Un comédien impérial de tragédie asiatique et décor enluminé..., 2011. Archives B.M.
12:17 Publié dans Art Brut, Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : charles cako boussion, musée de la création franche, représentant de commerce, art brut, enluminures brutes, ornementation automatique, mur d'antoine gentil |  Imprimer
Imprimer
30/03/2021
La tour Eiffel de Petit Pierre est en danger, la Fabuloserie a besoin d'aide
Tous les amateurs d'art brut et d'environnements en plein air connaissent "le Manège" de Pierre Avezard qui a été sauvegardé par Alain et Caroline Bourbonnais dans leur parc-musée de la Fabuloserie à Dicy, dans l'Yonne. Or, aujourd'hui, suite aux injures du temps, leurs filles Sophie et Agnès, qui ont repris les rênes du musée, tentent avec les moyens du bord de préserver ce patrimoine populaire fragile et précieux. Elles constatent que certaines parties du Manège s'abîment dangereusement, et notamment la tour Eiffel en bois, que Petit Pierre avait bâtie au fur et à mesure en y grimpant sans la moindre grue ou aide quelconque. Voici l'appel qu'elles lancent ces jours-ci à tous les défenseurs de ce joyau de l'art brut. Chacun peut faire un effort pour apporter sa pierre à la restauration de ce chef-d'œuvre en péril, d'autant que les pouvoirs publics et leur armée de bureaucrates ne lèvent bien entendu pas le petit doigt :
"Bonjour,
Vous, dont nous connaissons tout l'intérêt que vous portez à l'art brut et apparentés et qui nous suivez depuis de longues années, vous n’êtes pas sans savoir que La Fabuloserie a la chance de présenter dans son « jardin habité » un des environnements majeurs de l’art brut : le Manège de Petit Pierre !
Ce joyau emblématique nous a été confié par Léon Avezard, le frère de Petit Pierre, sur l’instigation de Laurent Danchin, il y a 34 ans ; depuis, conscients de l’immense responsabilité qui nous échoit, nous le chouchoutons. Or, malgré nos soins, il n’échappe pas aux outrages du temps et des intempéries.
Las, la tour Eiffel (23 m de haut), bien qu’haubanée, se prend pour une danseuse, certes élégante, mais qui risque de faire son dernier tour de piste si nous n’agissons pas.

Alors que les confinements successifs ont privé et vont encore priver le musée d’une grande partie de ses visiteurs, notre première démarche a été de nous tourner vers la Région et la DRAC mais, malgré l’urgence de la situation, les réponses négatives se sont succédées. Aussi, nous n’avons d’autre recours que de lancer une campagne de financement participatif pour réaliser, ce printemps même, la sauvegarde de la tour Eiffel et de la Cabine depuis laquelle Petit Pierre actionnait son Manège.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs c’est pourquoi je vous préviens, en avant-première, pour attirer votre attention et solliciter de votre part un relais de cette campagne parmi vos connaissances.
Le lien : http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvetage-de-...
Un grand merci d’avance,
Qu'attend notre Ministre de la Culture bling-bling, ou, à défaut, ses secrétaires – puisque la voilà hospitalisée – pour se préoccuper de cette huitième Merveille du monde, chef d'oeuvre d'art populaire dans un autre genre bien différent du Palais Idéal du Facteur Cheval? Il est aussi merveilleux dans le genre fragile et poétique que le chef d'oeuvre de rocaille solide et monumental de la Drôme. Ce serait une bien meilleure action que de décorer ce bouffon de Michel Sardou. Le patrimoine populaire a droit à autant d'égards que les églises ou les palais. Et ce serait une preuve que l'on s'intéresse en haut lieu, du côté des soi-disant "premiers de corvée", enfin, au peuple.
23:49 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petit pierre, tour eiffel, environnements populaires spontanés, région bourgogne-franche-comté, drac région bourgogne, huitième merveille du monde, pierre avezard dit petit-pierre, manège de petit-pierre, fabuloserie, palais idéal du facteur cheval, emmanuel clot |  Imprimer
Imprimer
26/03/2021
Rêve de Darnish, le 20 mars 2021
Dessin de Darnish illustrant son rêve, mars 2021.
20:29 Publié dans Environnements populaires spontanés, Rêves | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : darnish, bretagne, surf, spots, crique, plongée sous-marine, éléphant, manège enchanté, environnements spontanés, bruno montpied, rêve, pinocchio en plastique |  Imprimer
Imprimer
24/03/2021
Les statues belges
Rêve du 16 mai 2019, entre 5 et 8 h du matin
Je voyageais, avec des amis il me semble, en pays étranger, mais frontalier avec la France (Belgique ? En tout cas, on y parlait français), plutôt dans le Nord. Nous étions dans une grande ville qu’aucun de nous ne connaissait. En cherchant à nous repérer, j’aperçus tout à coup une maison ancienne au toit pointu à deux pans, d’époque médiévale sans doute, ou s'en inspirant, dont le pignon était transparent (verrière ?) et contenait des statues (de pierre ou plus vraisemblablement en ciment) disposées sur plusieurs niveaux.
Cette maison était bizarrement plantée contre un immeuble moins vieux (XIXe siècle ?), comme de biais, et comme si la ville moderne l’avait rattrapée et enkystée n’importe comment dans le nouveau tissu urbain. Il y avait une sorte d’allée piétonnière ou une placette plantée d’arbres, à gauche.
En voyant ces statues, mon sang ne fit qu’un tour : il s’agissait à n’en pas douter des statues perdues de… (dans le rêve, j’étais sûr de l’identité du créateur, au réveil, bien entendu, elle avait disparu), "cet" auteur d’un environnement célèbre (du moins, à mes yeux…) d’autodidacte populaire dont on avait perdu la trace depuis fort longtemps (genre les statues de Camille Renault qui étaient à Attigny en France, mais qui, elles, ont été détruites après la mort du sculpteur, hormis quelques rares fragments conservés dans diverses collections). Je demandais à mes amis de me laisser descendre à la seconde de la voiture pour que je me dépêche de prendre des photos de cette maison, de ces statues, de relever le nom de la rue, d’interroger des témoins, éventuellement. Je sortais mon portable, mais je ne me rappelle pas si j’arrivais à prendre les photos, c’est comme si l’intention avait suffi. Je regardais ces statues que mon rêve me représentait floues, y avait-il un cheval cabré parmi elles ? Elles étaient grises, légèrement bleutées, s’enfonçant dans l’ombre des rayonnages où on les avait installées de façon à être visibles de la rue.
Il y avait un café à droite, en dessous. Je ne savais où donner de la tête, que devais-je prendre en photo en premier ? La plaque de rue, me dis-je alors, c’était la première chose à faire, si je ne devais plus retrouver l’endroit… Celle-ci, je la revois encore dans mon viseur. Son libellé était terriblement long du genre « rue du Maître Truc dans la commune de… bla-bla-bla, à… bla-bla-bla, sous…bla-bla-bla… », et je me lassais progressivement (et bizarrement) devant cette kyrielle de mots. Curieusement, car si c’était le nom de la rue, il fallait pourtant la prendre telle quelle, ne pas tergiverser. Mais pris-je finalement la photo ? Je me revois ensuite, en train de demander ‒ à un passant ? A un consommateur du café ? ‒ s’il s’agissait bien des statues de X, installées à l’origine en France plutôt, mais disparues ensuite. Le type paraissait me le confirmer, quoique sans être tout à fait catégorique, même plutôt hésitant, instillant le doute en moi….
Je commençais simultanément à me demander si je pourrais retrouver mes compagnons avec la voiture, car ni eux ni moi n’avions convenu d’un moyen de nous retrouver.
Je me réveillai alors, brutalement, à cause de la lumière du soleil qui filtrait à travers mes rideaux. Consternation : il n’y aurait aucune photo conservée, puisque tout ceci n’était qu’un rêve et qu’on ne rapporte aucune photo des pays de ses rêves (hélas…). Sentiment de dépit, voire de dégoût… C’était encore un de ces rêves où l’on fait une découverte exaltante, mais qui se vaporise dès la première minute du réveil…
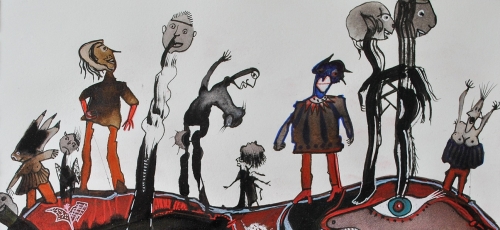
Bruno Montpied, onze personnages en silhouettes, détail d'un dessin terminé ces jours-ci, intitulé Onze nés des strates, 30 x 30 cm, 2021.
16:11 Publié dans Environnements populaires spontanés, Rêves | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : rêve, statues d'environnements, onirisme, quête déçue, bruno montpied |  Imprimer
Imprimer
15/03/2021
Un film nouveau sur Pape Diop, le dessinateur des murs de la Medina de Dakar
Tilleen, le débile et le génie, d’Ugo Simon (2021, France, 23 min), tel est le titre du court-métrage consacré au dessinateur compulsif de rue Pape Diop (déjà évoqué par moi sur ce blog l'année dernière) parmi douze autres petits films qui sont proposés sur le site de Mediapart dans le cadre de la section "Première Fenêtre" du festival Cinéma du Réel (se tenant du 12 au 31 mars, sans doute en ligne...). Sur le site de Mediapart (voir LIEN), c'est le 4e.
Photogramme extrait par moi du film d'Ugo Simon. Pape Diop (à gauche) place touts sortes de petits objets dans la main de Modboye (à droite, avec son tee-shirt marqué "Dakar Art Brut"), dans un échange étrange.
On y retrouve Modboye l'artiste médiateur sénégalais qui suit Pape Diop (un médiateur et un créateur, on retrouve ainsi "l'attelage" traditionnel qui signale que l'on a affaire à de l'art brut), et recueille les contreplaqués que ce dernier abandonne ou donne, sans souci apparemment de ce qu'ils pourraient devenir (je pense bien sûr au marché de l'art brut en Europe ; m'est avis qu'un petit malin ira bien le proposer un de ces jours dans une quelconque Outsider Art Fair ; il a déjà été exposé à Paris dans la galerie parisienne de la Fabuloserie, comme le contait la note que j'ai mise en lien ci-dessus).
Pape Diop dessine obsessionnellement sur le bitume, les murs, les bouts de contreplaqués... Photogramme extrait de Tilleen ,le débile et le génie, court-métrage d'Ugo Simon, 2021 ; je n'ai personnellement pas compris à quoi ou à qui correspondait ce mot de "Tilleen", le film étant assez avare de commentaires et d'explications, tissé surtout d'impressions visuelles.
Merci à Remy Ricordeau qui m'a envoyé le lien vers ce film.
23:19 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire religieux, Art visionnaire, Cinéma et arts (notamment populaires), Street art marginal (art de rue sauvage) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : ugo simon, cinéma du réel, pape diop, médina de dakar, art brut de rue, art brut africain, modboye, artiste médiateur, fabuloserie, débile et génie |  Imprimer
Imprimer
06/03/2021
Chouchan à la Fabuloserie-Paris
"Le Printemps de Chouchan", tel est le titre choisi par Sophie Bourbonnais et Marek Mlodecki pour leur nouvelle exposition dans la galerie parisienne de la Fabuloserie, à partir du 3 mars, prévue pour durer jusqu'au 3 avril 2021 (au départ, elle aurait dû se tenir de début novembre à fin décembre 2020, la pandémie a repoussé les dates).
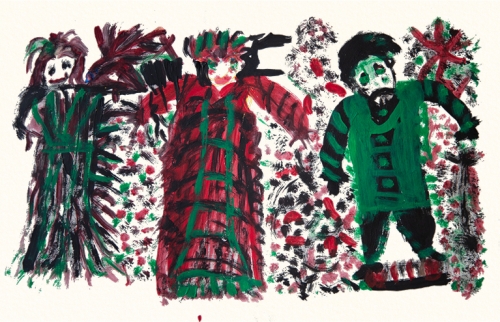
Une peinture de Chouchan, extraite du catalogue de l'expo.
Chouchan Kebadian (1911, née à Yozgat, en Arménie - décédée en 1995 à Montreuil-sous-Bois, en France) est une peintre autodidacte qui s'essaya à la peinture et au dessin (le dessin en fait avant la peinture) à partir de ses 73 ans. C'est une de ses jumelles (elle eut quatre enfants, dont le réalisateur de documentaire, Jacques Kébadian qui est quelque peu à l'origine de cette expo), Aïda Kébadian¹, qui, elle-même artiste spontanée (elle exposa à l'Atelier Jacob en 1975, ce qui ne fut sans doute pas pour rien dans l'idée de stimuler sa mère), lui suggéra de s'essayer à l'art en lui mettant entre les mains, vers 1984, des tubes de gouache, des crayons de couleur, un cahier à spirale, une pochette de feuilles Canson, afin de dépasser l'ennui que sa mère ressentait dans les années qui suivirent la perte, en 1972, de son mari Khoren. Sa famille fut surprise de découvrir à quel point elle se jeta dès lors à corps perdu dans la peinture .
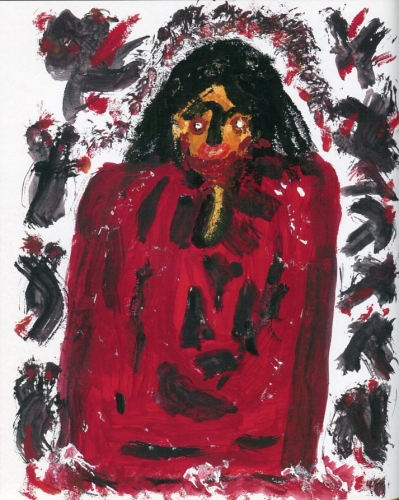
Chouchan.
On pense à d'autres exemples de personnes âgées venues comme elle à l'art sur le tard, tels M'an Jeanne dans l'Yonne, ou le Catalan Anselme Bois-Vives, lui aussi poussé à peindre par son fils artiste en Savoie, Joseph Barbiero, sculpteur et dessinateur à Clermont-Ferrand, Gaston Mouly dans le Lot, et plus généralement tous ces créateurs d'environnements qui, une fois arrivés à l'âge de la retraite, se prirent de passion pour la recréation de leur environnement immédiat (voir l'inventaire que j'en ai dressé dans mon livre Le Gazouillis des éléphants). Elle produisit d'abord des dessins, où le trait domine (ce que je préfère personnellement dans sa production), puis des peintures, et ce, pendant une grosse dizaine d'années.
Jacques Kébadian, dans le catalogue qu'a édité la Fabuloserie, écrit ceci: "Ma mère pensait qu'on allait se moquer d'elle, elle s'excusait presque de ne pas savoir "faire ressemblant"... Je l'ai emmenée alors dans les musées. Au musée Picasso... (...) A Beaubourg, elle a été émerveillée de découvrir que tout était possible... (...) Il y a eu aussi cette exposition Watteau au Grand Palais : elle n'arrivait pas à croire que l'on pouvait peindre des yeux et des mains avec autant de réalisme... Plus de trente ans après, je me replonge dans les valises et les cartons où sont conservés peintures, dessins et gouaches qui n'avaient plus été exposés après sa mort... J'en ai répertorié plus d'un millier de tous formats." Il est à noter que ces oeuvres, en elles-mêmes, ne manifestent aucune timidité, mais au contraire paraissent bien assurées, sans repentir ou complexe d'aucune sorte, comme le note pour sa part l'artiste arménien Sarkis.

Cette peinture, représentant un couple (il n'y a jamais de titre proposé, ni de date, ni de signature semble-t-il), se trouve encadrée comme de prédelles brouillonnes, à la mode d'un Alechinsky brut...
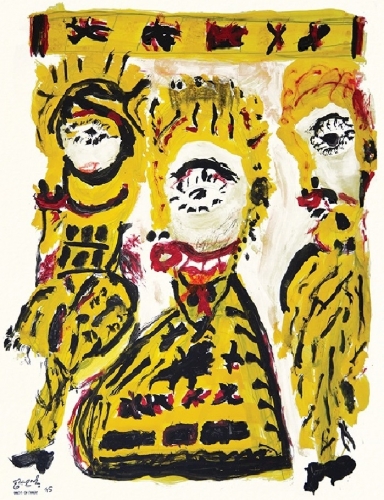
Peinture paraissant peut-être évoquer un souvenir de costumes traditionnels arméniens?
Cette peinture évoque des souvenirs de famille, explore les rapports entre les tons, la composition, par le jeu de certaines formes (fleurs, plantes), et se concentre avec délectation dans l'emploi des couleurs par touches automatiques laissées "flottantes", appliquées sans désir de netteté, très gestuelles. Peut-être cette activité improvisée servit-elle de moyen pour redonner vie aux souvenirs d'amour, au bonheur de vivre dans une communauté familiale soudée, à la fin de sa vie, marquée au départ (elle avait 4 ans) par le massacre de son père (en compagnie de tous les autres hommes de son village) par les Turcs durant la période traumatisante du génocide arménien de 1915.
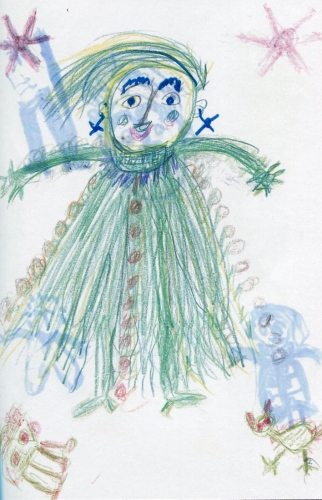
Dessin extrait d'un cahier édité en reprint par la Fabuloserie.
10:14 Publié dans Art Brut, Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : chouchan, aïda kébadian, jacques kébadian, la fabuloserie-paris, atelier jacob, art spontané et troisième âge, art immédiat, art brut, boix-vives, barbiero, m'an jeanne, gaston mouly, environnements spontanés, sophie bourbonnais, génocide arménien |  Imprimer
Imprimer
04/03/2021
Les éditions Ion
On peut se demander si cet éditeur, afin de dénicher un nom original, n'aurait pas par hasard délibérément choisi de redoubler la dernière syllabe – ou diphtongue? (je sens qu'un linguiste distingué de ma connaissance va nous préciser cela) – du mot "éditions". Ion, c'est donc son nom, maison située à Angoulême, avec un site web: www.ionedition.net. A feuilleter leur catalogue, on se dit que l'on a affaire à des graphistes nouvelle génération, peut-être stimulés par le festival de la Bande Dessinée qui se tient régulièrement dans la préfecture de la Charente. Un libraire qui m'alimente depuis longtemps en documentation intrigante, Pascal Hecker "de" la Halle Saint-Pierre (il n'est pas encore anobli, mais ça pourrait venir), a sélectionné deux opuscules au sein de leur catalogue qui valent le coup d'être signalés.
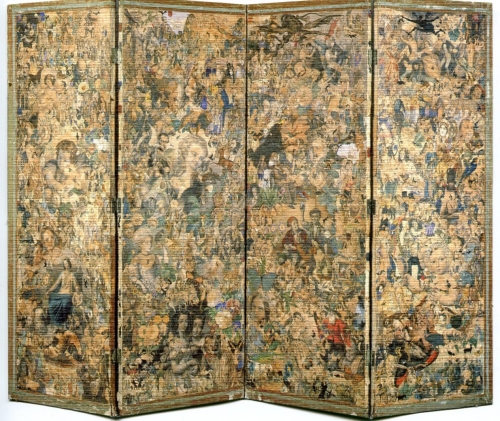
Paravent couvert de collages d'Hans Christian Andersen, édité sous forme de marque-page pliant par la Galerie 1900-2000 en 2003, à l'occasion d'une exposition sur le collage surréaliste.
L'un est consacré aux découpages d'Hans Christian Andersen, qui nous rappelle que ce merveilleux conteur fut aussi adepte d'expérimentations primesautières, comme le collage (il composa ainsi tout un paravent) et les découpis de silhouettes. La plaquette éditée par Ion (en 2018, avec un titre, je dois dire, un peu approximatif, "Les Contes découpés"... ; j'écris "approximatif" parce que les découpages d'Andersen n'étaient pas spécialement des illustrations pour contes qu'il réécrivait), cette plaquette, si elle a le mérite de raviver la mémoire de ces travaux oubliés, ne s'élève cependant pas à la qualité d'un autre petit livre édité par Jacques Damase qui, en 1990, avait déjà présenté les mêmes productions d'Andersen, qui étaient plus diverses et variées, parfois en couleur, mêlant écritures manuscrites, collages et découpages que ce que présente un peu chichement l'édition de Ion. Cette dernière fonctionne comme un rappel.

Deux pages du livre des éditions Jacques Damase sur Andersen.
Le petit livre de Jacques Damase, intitulé Le Monde magique d'Hans Christian Andersen. Papiers collés, déchirés, découpés, avait eu en outre l'heureuse idée de proposer deux petits textes biographiques sur le "vilain petit canard" d'Odensée, l'un assez idéalisé d'H.G. Olrik, daté de 1930, et un autre, de Patrick Griolet, paru dans le Monde en 1984, rétablissant des vérités plus réalistes concernant le conteur, qui resta vierge toute sa vie, et craignait par-dessus tout d'être enterré vivant, entre autres angoisses.
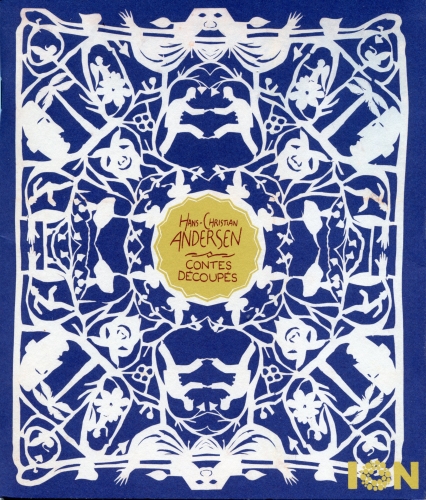
La brochure sur les découpages d'Andersen, version Ion.
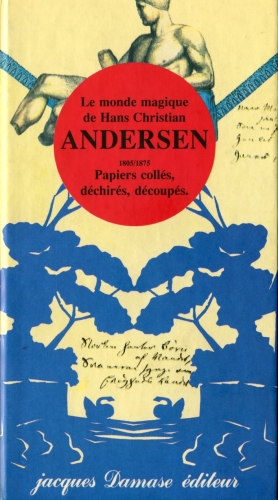
L'édition Jacques Damase de 1990.
C'est une deuxième brochure de cet éditeur charentais qu'il faut surtout mentionner, à la vilaine couleur de couverture, hélas (on reste perplexe devant un tel ratage, lorsque l'on découvre le contenu, excitant pourtant, de cette même plaquette) : Boîtes, consacrée aux sculptures au couteau de Levi Fisher Ames (18433-1923), conservées à la Kohler foundation, dans le Wisconsin, aux USA bien sûr (voir la page consacrée sur leur site web à cet ancien charpentier, vétéran de la Guerre de Sécession).
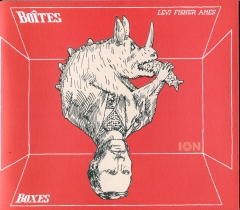
La couverture de la brochure consacrée par Ion aux sculptures en boîte, genre mini dioramas, de Levi Fishers Ames.
Cet autodidacte réalisa ainsi une "immense galerie de figurines en bois: animaux tant naturels que mythologiques ou bizarroïdes (...) qu'il abritait dans des vitrines articulées qui s'ouvraient comme des livres. il les montrait dans les foires sous des tentes..." (présentation anonyme du livre). Il lui arrivait de raconter des histoires tout en sculptant devant le public, dans des sortes de démonstrations. Il ne vendit jamais lui-même sa collection, conscient qu'on la comprendrait mieux en la contemplant dans son entier. C'est sa famille qui s'en chargea au moment de la crise de 1929. Heureusement, un petit-fils racheta l'ensemble dix ans plus tard pour le donner à la Kohler foundation. Il faut faire confiance aux petits-enfants...
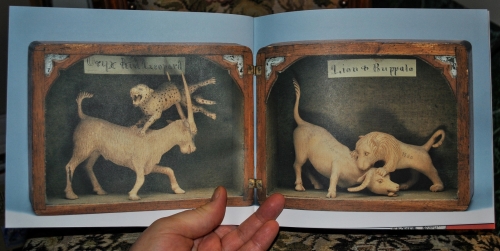
Levi Fisher Ames, oryx et léopard, lion et buffle, Ion éditions.
Les sculptures contenues dans ces boîtes articulées sont proprement étonnantes, et pleines de charme. qu'on en juge ci-dessus et ci-dessous où je donne deux exemples, parmi beaucoup d'autres présents dans ce livret.
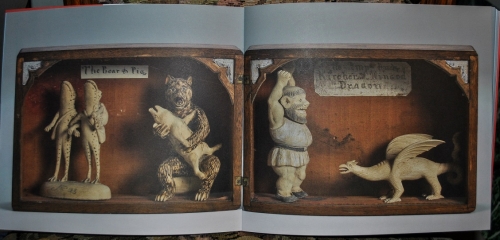
Levi Fisher Ames, ours et porc, the Imp and kirchers winged dragon, Ion éditions.
On trouvera le(s) livre(s) des éditions Ion à la librairie de la Halle Saint-Pierre et bien sûr aussi en commande sur leur site web.
22:49 Publié dans Art forain, Art immédiat, Art moderne méconnu, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : hans-christian andersen et ses papiers découpés, ion éditions, jacques damase, patrick griolet, levi fishers ames, sculptures au couteau, bestiaire bizarroïde, pascal hecker, librairie de la halle saint-pierre |  Imprimer
Imprimer
26/02/2021
"Ogres et croquemitaines" se termine le 7 mars
C'est – il faudra bientôt dire "c'était" – une de ces expositions fantômes comme il y en a pas mal ici et là dans notre beau pays, que seules les mouches auront vue, hormis quelques visiteurs au début, à son ouverture ou à son vernissage l'été dernier. Le Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers de Laval qui l'a(vait) montée en propose in extremis une visite virtuelle (avec plutôt de l'art plastique contemporain et de l'art singulier, mais pas du tout d'art naïf...). Moi, j'ai horreur de ce type de visite, d'habitude (ça ne remplacera jamais le contact direct avec les œuvres, bien sûr). Mais là, c'est un peu un pis-aller, compris comme cela, je pense, par la communication et le commissariat de l'expo. Cherchez bien si vous voyez les quatre petites peintures de Bruno Montpied accrochées entre les deux salles principales de l'expo... Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr : https://musees.laval.fr/360-ogres-et-croquemitaines/index...
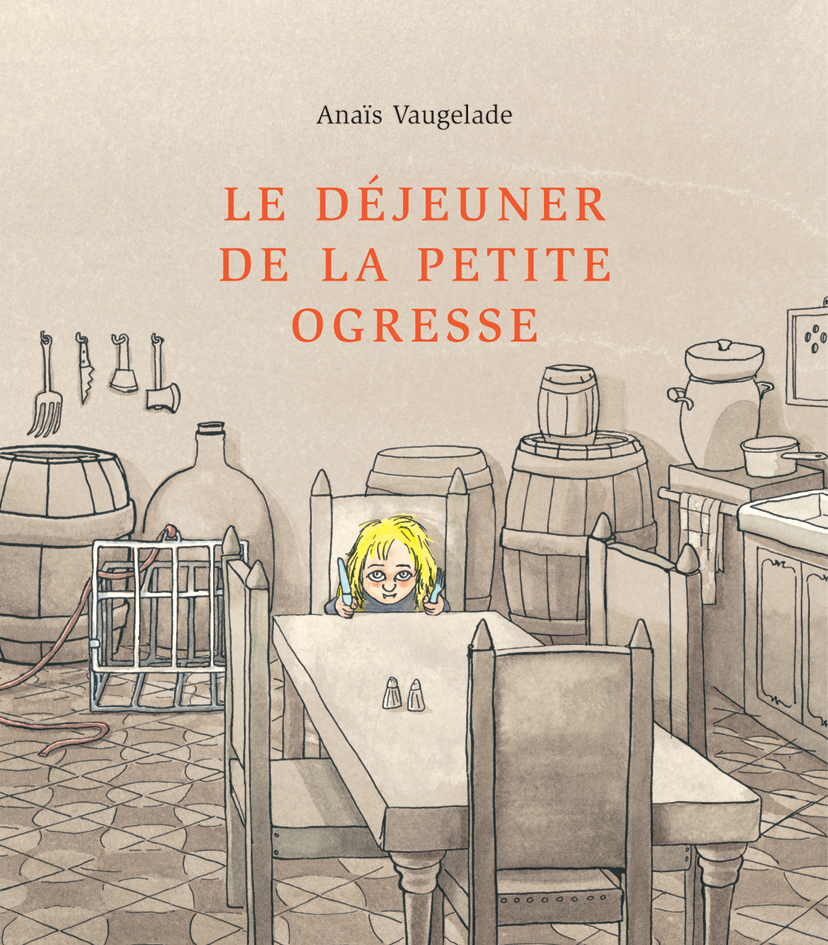
Album d'Anaïs Vaugelade
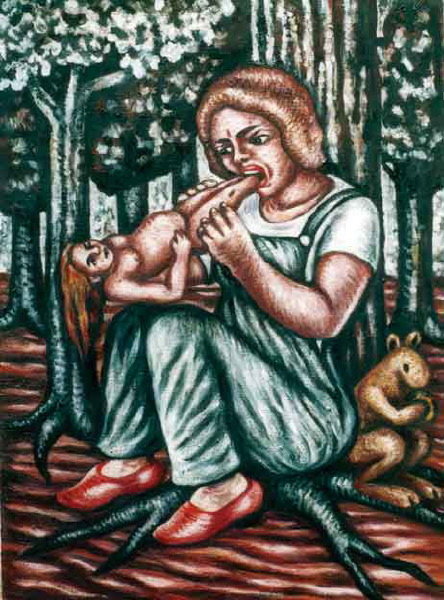
Une ogresse d'Anne Van der Linden...
15/02/2021
Le carnaval de Nice, la fête des masqués pourtant, annulé... Alors, un film sur Martine Doytier et ce carnaval
Voici un lien vers un nouveau film d'Alain Amiel consacré à l'affiche que fit Martine Doytier pour le Carnaval de Nice de 1981, affiche qui fut rééditée en 1984 pour le centenaire de la manifestation. C'est à cette occasion qu'en allant regarder le carnaval de cette année-là avec mon amie Christine Bruces (en même temps qu'une expo Gustav-Adolf Mossa au musée Jules Chéret et un petit tour rituel au Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky), j'avisai avec grand intérêt l'affiche de cette artiste que je découvris alors sans en apprendre beaucoup plus à l'époque (internet n'existait pas encore, d'une manière aisément accessible au tout venant). J'en reproduisis un fragment dans mon fanzine La Chambre rouge en 1985. J'ai consacré depuis quelques notes à cette artiste singulière qu'une association de ses amis s'évertue à ressusciter, préparant une rétrospective "dans un musée de la ville" pour bientôt (c'est annoncé à la fin du film).
00:53 Publié dans Art moderne méconnu, Art naïf, Art singulier, Art visionnaire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : martine doytier, carnaval de nice, la chambre rouge, christine bruces, alain amiel, masques |  Imprimer
Imprimer