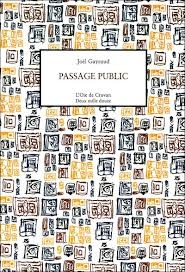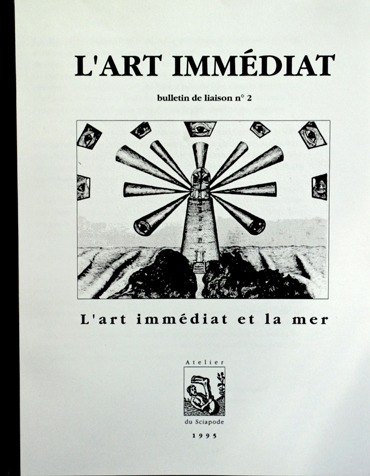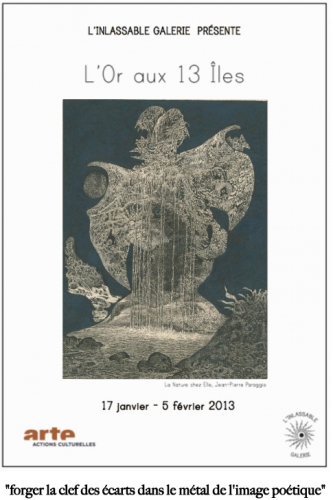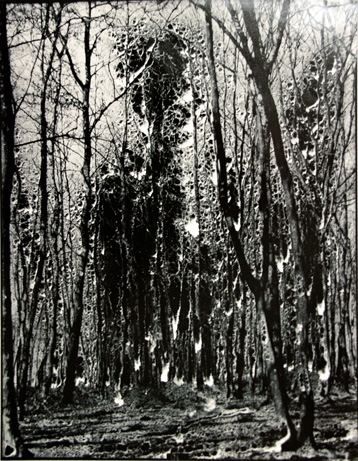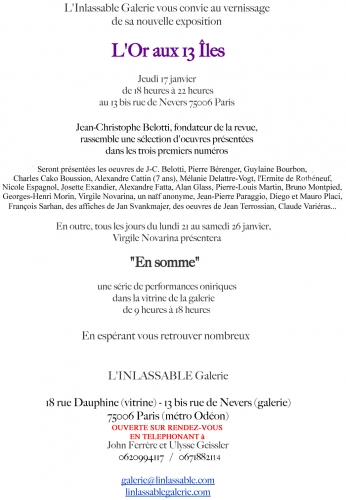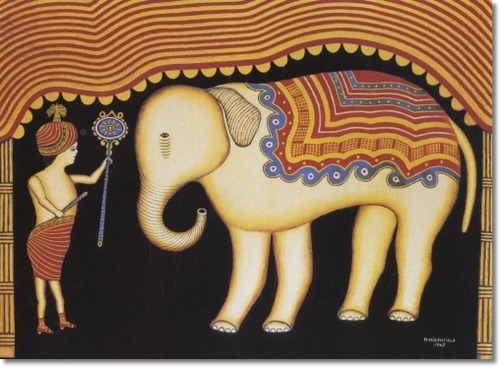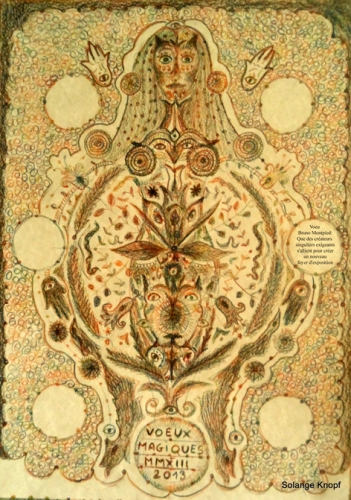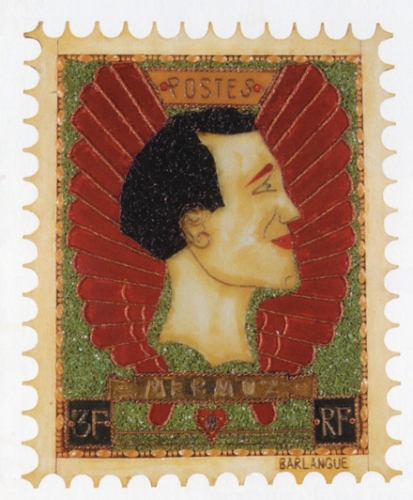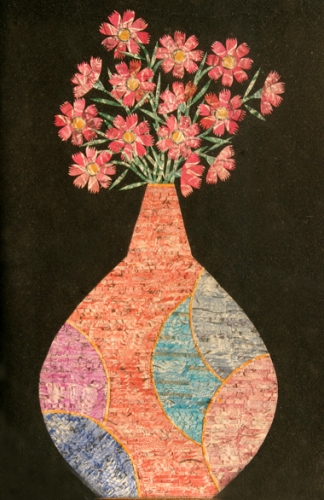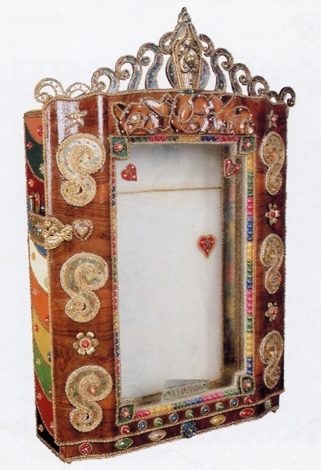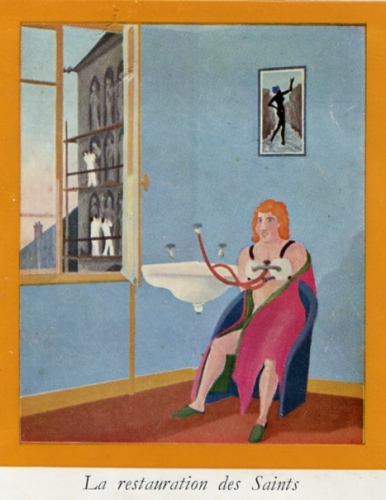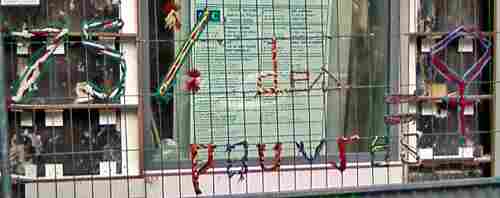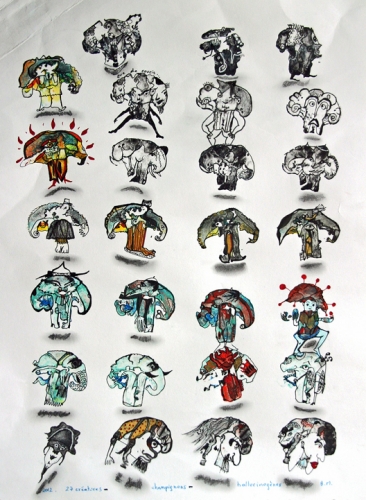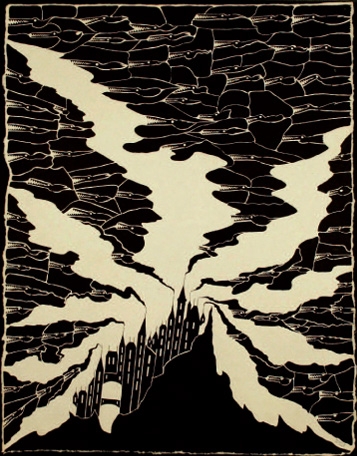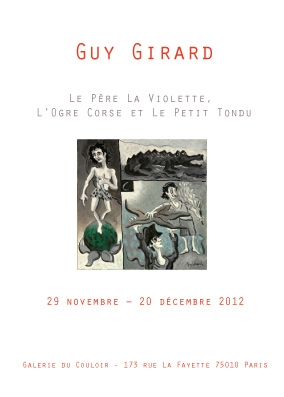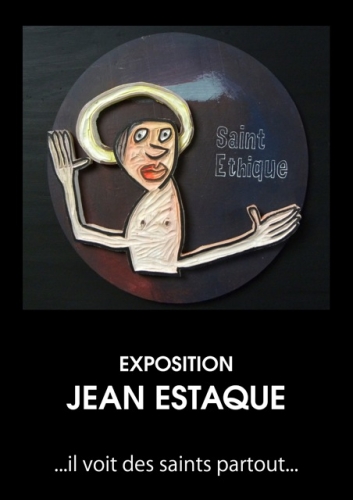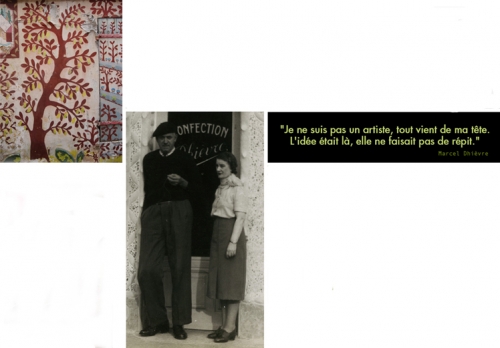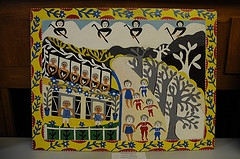18/02/2013
Martine dans tous ses états
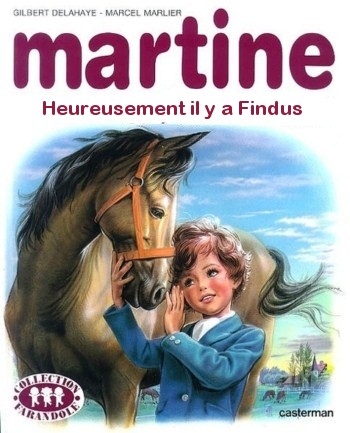
D'une certaine mode actuelle du détournement...
17/02/2013
Hemijki, Hemijhù, Hernijhui, ou quoi encore?

Peintre non identifié (Hemijhui?), huile sur toile, 51x33,5 cm, 1961
Voici une œuvre trouvée aux Puces, que j'ai acquise ne pouvant quasiment faire autrement car elle me faisait de l'œil avec insistance, ce qui est le critère dominant dans mes choix d'acquisition. La signature est difficile à lire, au début il y a un H puis on peut raisonnablement croire à EMIJ mais à la fin, c'est plus dur...KI? HÙ? J'ai cherché sur internet à différentes orthographes, et n'ai rien trouvé qui puisse indiquer que ce peintre ait laissé d'autres traces au moins sur la Toile.
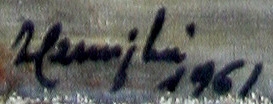
Signature agrandie comme demandé par RG dans les commentaires à cette note...
L'écriture de cette peinture est assez composite. On se croirait en présence d'un artiste moderne des années 60 lorgnant du côté d'une certaine abstraction, ou peut-être plus exactement de l'art dit informel. En même temps, par son aspect relâché, traîne-savates, aux limites d'une concentration totalement évanouie, hésitant entre basculement dans l'hébétude ou dessin automatique, cette toile se rapprocherait d'une certaine forme d'art brut. A-t-on affaire à un professionnel ou à un amateur? Ou bien à un peintre d'un pays peu fourni en adeptes d'une modernité telle que celle en usage dans les pays occidentaux, et qui aurait tenté malgré tout de suivre l'exemple de ses collègues européens ou américains...? Le patronyme semble indiquer une origine aux frontières de l'Europe de l'Ouest, ayant des consonnances proches du serbo-croate (Hemijski est le nom d'une université à Belgrade, à ce que j'ai vu sur la Toile). Quelqu'un en saurait-il plus?
14:23 Publié dans Art Brut, Art moderne méconnu, L'oeil du Sciapode | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art moderne méconnu, art moderne anonyme, art informel inconnu, art brut hypothétique, hemijhù, hemijki |  Imprimer
Imprimer
16/02/2013
La montagne de la tête
Ce soir, j'ai envie de m'épancher, de me répandre à propos d'un de mes dessins produit durant ces deux derniers jours. Vite arrivé... Et pourtant, pour une fois, j'en suis fort satisfait. C'est un bébé qui n'a pas l'air comme les autres. Dans le flot (façon de parler!) de ma production, il y a en effet pas mal de clones, de répétitions, de visages et de compositions déjà-vus. Des leitmotivs, des séries, des obsessions, des façons de composer ou de tracer qui reviennent régulièrement, parfois après de longues éclipses, mais tout de même persévérantes, refaisant surface fidèlement de loin en loin. Et puis, il y a les cas à part, les enfants uniques, les solitaires, et c'est généralement à ceux-ci que je m'attache, que je n'aime pas vendre et laisser partir. Le dernier venu est du lot.

Bruno Montpied, La Montagne de la tête, 29,7x21 cm, 2013
De taches d'encre semées au début, distribuées aléatoirement sur la feuille de papier, avec des frottages de mine de plomb, de crayons noirs dont les traits, les gribouillis furent étalés au doigt - technique souvent utilisée ces temps derniers - peu à peu, en rajoutant ici et là des traits apposés comme souvent, au jugé, a fini par émerger tout d'un coup une tête, une énorme tête, aux dimensions d'un paysage. Fichée, tel un chef coupé sur une pique de Sans-Culotte, mais cette fois au sommet d'un pic, d'une montagne à l'horizon. Cette dernière se reconnaît du reste grâce à ses verts pâturages où paissent de drôles de ruminants, où se pavane un volatile faisant l'important. Des têtes monumentales de ce calibre, je n'en ose pas si souvent que cela. Je l'ai laissée venir par hasard, elle s'est imposée à mon regard, plusieurs heures après avoir été dessinée, ou du moins après que les traits, les frottis et les taches qui la constituent eurent été posés, chargés de représenter autre chose, en l'occurrence des surfaces abstraites, et des corps en équilibre improbable (le personnage ocre) ou comme virevoltant...
Tout à coup, je vis une tête aux yeux complètement assymétriques, une mèche lui tombant tout du long de sa joue droite, manquant de couvrir la bouche ocre (qui est simultanément le corps du personnage en équilibre), vaguement boudeuse, mais aussi à l'expression résolue, têtue. Ce personnage ocre tend le bras gauche vers l'œil droit de la tête géante comme cherchant à recueillir ce globe oculaire prêt à se détacher de son orbite telle une larme en formation. De son bras droit, il tient en équilibre sur une barre, où reposent également ses deux jambes (une "cinquième jambe" qui a tout l'air d'une espèce de phallus considérable se fait sentir ou embrasser par les lèvres lippues d'une ombre de bestiole, hésitant entre ombre et nuage...). La barre paraît tenue assez fermement dans un manchon, ou un immense gant de boxe d'un ocre presque brun, placé sous le menton d'un personnage barbichu assis sur un curieux fauteuil rouge (un fauteuil dont le dossier rampe en épousant le bas du dos du barbichu). Ce dernier porte des sortes de minuscules nattes rigidifiées, hérissées et terminées par des perles. De la tête gigantesque poussent des excroissances ténébreuses qui ressemblent à des cornes assez semblables à celles d'un bouc. Est-ce le Diable ?
Souvenir, réminiscence d'une randonnée ancienne en montagne dans le Mercantour avec Christine, lorsque au bout de trois ou quatre jours d'ascension continue depuis la mer Méditerranée, voyant à l'horizon le col vers lequel nos pas nous portaient et nous emportaient, nous rêvions sur le nom de cette barre rocheuse plus haute que tous les reliefs avoisinants, le Pas du Diable, immense chaos rocheux que nous escaladâmes dans un silence sauvage, des filaments nuageux glissant par-dessus nous qui montions, épuisés et oppressés? Au sommet, après un petit défilé, nous trouvâmes un petit lac comme un miroir de bijoutier, et en dessous une étroite vallée très minérale qui par un sentier artificiellement tapissé d'un semis de gravier écru et bordé de fleurs fragiles et minuscules nous permit de descendre, en extase, vers la Vallée des Merveilles où d'autres randonneurs nous attendaient, ayant transformé par l'affluence de leurs tentes de camping le site en un nouveau Woodstock transféré par magie (si l'on peut dire...) dans les Alpes.
23:29 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bruno montpied, têtes, montagnes, art singulier, pas du diable, mercantour, diable, vallée des merveilles, woodstock |  Imprimer
Imprimer
12/02/2013
Sur le catalogue de "La Création Franche s'emballe! (Itinérance d'une collection insoumise)"
Avec la première exposition prévue pour être itinérante, a priori dans la région Aquitaine aux dernières nouvelles, d'une partie de la Collection du Musée de la Création Franche à Bègles (elle se termine le 14 février, soit dans deux jours), réalisée en collaboration avec des étudiants en master professionnel Régie des Œuvres et Médiation de l'Architecture et du Patrimoine de l'université talençaise Michel de Montaigne, est paru un catalogue où l'on retrouve une discussion fort instructive à propos du projet qui fut celui de Gérard Sendrey, le principal initiateur du musée.

Portrait de Gérard Sendrey (assez semblable à un clergyman ce jour-là...), sur le seuil du musée de la Création Franche à Bègles, 1997, ph. Bruno Montpied
Je ne ferai pas mystère, moi qui ai toujours été franc avec lui (au point de commencer dans mes tout premiers rapports épistolaires en 1988 – et non pas en 1990, comme il le dit dans la discussion ci-dessus évoquée ; c'est lui qui m'écrivis le premier, le 24 septembre 1988, alors qu'il venait de créer sa galerie Imago dans une petite maison à côté de la mairie de Bègles, il cherchait alors des adresses, des créateurs, ce que je n'hésitai pas à lui fournir sur le champ – au point de commencer, donc, par me disputer avec lui, à deux doigts de nous brouiller même), je ne ferai pas mystère que j'ai toujours trouvé la prose de Gérard extrêmement touffue, labyrinthique et pour tout dire de façon plus abrupte (l'art abrupt, ça existe aussi!), assez lourde en somme. Je ne pense pas que, parmi tous les médiums qui se soient proposés à lui, ce soit dans l'écriture que Gérard Sendrey se sente le plus à l'aise. Par contre, dès que l'on publie des propos de Gérard, des discussions, des interviews (non trop réécrites par lui), des paroles, on trouve un Sendrey parlant plus clair et franc, ce qui donne une immédiate assise à ses propos. C'est ce qui se passe dans le débat avec divers intervenants qui est publié dans ce catalogue. On tient là (enfin, serais-je tenté de dire) une véritable profession de foi, faisant office de manifeste et de définition de la création franche, qui pourra servir dans le futur.
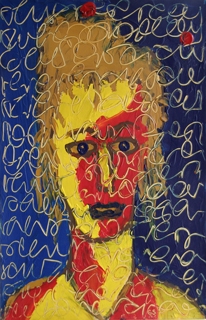
Gérard Sendrey, portrait de Marie, 50x32 cm, 2003, coll. BM
A bien lire et écouter Sendrey, on comprend que ce terme de Création Franche recouvre un ensemble de créations très variées que l'on ne peut identifier avec l'Art Brut, comme certains dans ce débat tentent de l'instiller (je pense notamment au "maître de conférence" spécialisé en histoire de l'art contemporain à l'université Michel de Montaigne, Richard Leeman, qui pense que l'on devrait utiliser les termes d'Art Brut au sens galvaudé par les journalistes et les ignorants du corpus, de manière à l'appliquer tout uniment à l'ensemble de la collection de la Création Franche : bel exemple de manque de rigueur – on a pourtant affaire à un enseignant). Il insiste aussi sur la distinction nécessaire à faire entre artistes et créateurs, ou auteurs "francs" (cet adjectif signifiant avant tout "libres", "indépendants" pour lui), ce que ses auditeurs ne paraissent pas toujours intégrer du reste... Ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné la mode actuelle qui cherche à amalgamer l'art brut, les créations marginales, produits par des personnes extérieures au monde des Beaux-Arts, avec le reste de l'art contemporain produit par des professionnels. Cela Sendrey ne l'évoque pas, se plaçant plutôt... sur un terrain anthropologique disons.
On sent bien à travers ses réponses aux diverses questions qui lui sont posées que Gérard Sendrey a été préoccupé avant tout de rassembler à côté de sa propre recherche (à la manière d'un Dubuffet dont il est visiblement imprégné mais qui collectionnait des créateurs nettement moins communicatifs), toute une série de créateurs possédés par leur inspiration, créant sans souci impérieux de reconnaissance, des Naïfs, des Surréalistes contemporains, des Bruts, des handicapés mentaux, des personnes écorchées, des auteurs issus des couches populaires, etc. Son projet se rapprocherait davantage d'une vision d'un art outsider que d'un art brut. Le curseur ne se déplaçant jamais du côté du conceptuel, des vidéastes, des amateurs de performance, de "happenings", etc. parce qu'il reste profondément attaché à la création qui est avant tout plastique. La notion de partage entre l'auteur et le public est également réaffirmée par Sendrey, ce point à lui seul distinguant la création franche de l'art brut, production de personnes nettement plus introverties.
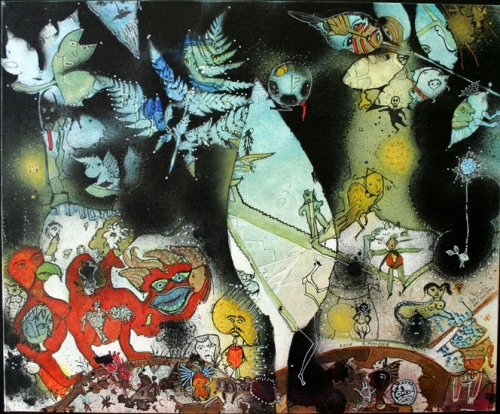
Bruno Montpied, Par la porte des feuilles, 38x46cm (8F), technique mixte sur carton entoilé, 2004, collection du Musée de la Création Franche
Pour conclure cette note qui se doit de rester circonscrite, je souhaite apporter une précision quant à un faux souvenir qu'il émet page 23 du catalogue (en face d'une reproduction bien sombre d'un tableau à moi faisant partie du musée, voir ci-dessous). Gérard évoque la fondation de la revue Création Franche en 1990 et dit que c'est moi, Joe Ryczko et Jean-Louis Lanoux qui sommes venus le voir pour l'inciter à créer une revue. Il commet ici une erreur à mon avis. Les trois qui l'incitèrent furent plutôt Jean-François Maurice, Ryczko et Lanoux. Je parlais certes, parallèlement, avec lui dans nos courriers depuis nos premiers contacts en 1988 de l'idée de faire une revue sur les arts spontanés (Raw Vision venait d'apparaître dans le monde anglo-saxon, son premier numéro sortit au printemps 89, tandis que je rêvais depuis plusieurs années d'une revue sur les mêmes sujets qui aurait paru en France). Mais les trois que j'ai cités plus haut vinrent le voir sans m'en parler, à part Ryczko (bien que j'aie aidé à mettre toutes ces personnes en contact les unes avec les autres ; contrairement à ce qu'affirme Sendrey, nous nous connaissions bien tous...). L'un d'eux, comme je m'en suis déjà ouvert dans une note précédente, m'écartait comme un individu difficile à gérer... La revue ne fut pas donc initiée par moi, je refusais de participer aux deux premiers numéros tant que l'individu qui m'évinçait comme membre du comité de rédaction serait directeur de la publication. Ce n'est que lorsque cet individu fut écarté du poste, que j'acceptai de participer à la revue. L'avenir prouva que ma supposée ingérabilité était largement imaginaire. On avait utilisé l'argument, à mon humble avis, par un réflexe de banale et mesquine jalousie.
12:51 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : création franche, gérard sendrey, bruno montpied, la création franche s'emballe!, art brut, art singulier |  Imprimer
Imprimer
05/02/2013
Le gagnant du quizz des vedettes de Guy Brunet
Il était temps de proclamer les résultats de notre jeu de début d'année. Cela commence à ruer dans les brancards du côté des joueurs. Alors voici tout d'abord les noms des stars qu'il fallait reconnaître: 1. Jane Birkin, 2. Danielle Darrieux, 3. Romy Schneider, 4. Catherine Deneuve, 5. Micheline Presle, 6. Paul Meurisse, 7. John Wayne, 8. Burt Lancaster.

Chatherine Deneuve et ses collègues chez Guy Brunet, ph Bruno Montpied, 2012
J-C. et C.B. étaient bien partis pour les quatre premiers mais ont fléchi sur les trois suivants avant de se reprendre sur le dernier, mais cela n'a pas suffi. Luc M. de Rézé a participé ensuite, tout au plus en effet... Emmanuel Boussuge comme J-C. et C.B. était bien parti et s'est effondré ensuite, malgré Presle et Lancaster reconnus (ce n'est pas facile pour la délicieuse Micheline Presle qu'on a tendance à oublier, à tort), il a accumulé trois erreurs rédhibitoires. Darnish a fait trois fautes (et demi), voyant une Brigitte Bardot à la place d'une Jane Birkin (mais il y eut interchangeabilité entre les deux à un moment dans la vraie vie, alors il n'était pas loin). Il y a eu aussi un autre joueur (Cosmo?), mais son commentaire a été malencontreusement effacé par ma maladresse (contacté, il n'a pas renvoyé ses réponses, qui de toute manière étaient entachées de trop d'erreurs).

Elizabeth Taylor et ses copines, chez Guy Brunet, ph BM, 2012
Non, celui qui a fait le moins de fautes, seulement une, Simone Valère (qui se souvient encore d'elle pourtant? Seulement Spiritobono!) au lieu de Romy Schneider, c'est le sus-nommé Spiritobono à qui je dois maintenant annoncer en privé son succès, si d'aventure il ne croisait pas sur ce blog. Oui, il est bon physionomiste, et plus que cela, il sait lire du Guy Brunet dans le texte! Il gagne donc un catalogue de la collection de l'Art Brut (à signaler que les seconds, par ordre d'arrivée, sont J-C. et C.B., suivis en troisième position par Emmanuel Boussuge, ceci dit au cas où le gagnant ne se manifesterait pas pour recevoir son lot...).

Acteurs et producteurs anglais et américains, Woody Allen, Hitchcock, Von Stroheim... Chez Guy Brunet, ph BM, 2012
23:28 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Cinéma et arts (notamment populaires) | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : guy brunet, spiritobono, art modeste, cinéma et art populaire, art naïf |  Imprimer
Imprimer
04/02/2013
Une Cecilia Gimenez complètement "destroy"
Bon, voici, en écho aux derniers commentaires sur Cecilia Gimenez, la "profanatrice" involontaire de Borja en Espagne, le portrait que le peintre Eric Lefeuvre lui a consacré (visible sur son site). Je la trouve ainsi complètement destroy la Cecilia. Un portrait en vieille dingue prête à exploser. Pas sûr que cela lui plairait...

Eric Lefeuvre, Retrato de Cecilia Gimenez, 2013
22:55 Publié dans Art moderne ou contemporain acceptable | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : cecilia gimenez, éric lefeuvre, dessin contemporain, borja, destroy |  Imprimer
Imprimer
Le Fol de Chaillot, Gérald Stehr étend son linge au Palais, Thibaud Thiercelin jouant les bonus
Gérald Stehr a une imagination picturalo-littéraire étourdissante. J'en reste à chaque fois plus baba. Voici qu'il va exposer ses "Homo Rorschachiens", des peintures bleues sur toile tout en hauteur (voir illustrations ci-dessous) comme on étend son linge, dit-il plaisamment, au Palais de Chaillot, invité par le chorégraphe Alban Richard. Le vernissage de l'expo aura lieu le 13 février prochain, à partir de 21h30, après la première de Pléiades, la chorégraphie de ce dernier montée sur une partition pour percussions de Iannis Xenakis.
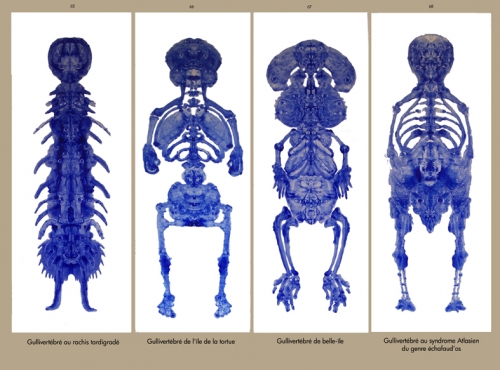
Gérald Stehr, une des planches d'Homo Rorschachiens
Il a intitulé cette présentation " Le septième voyage de Gérald", prévue pour durer à peine dix jours, du 13 au 23 seulement aux heures ouvrables de Chaillot (mais curieusement sur le site de ce dernier, l'expo est intitulée "Les variations de la figure"). Il y aura une section de 72 Homo Rorschachiens (le groupe entier en compte 144). Pourquoi "Rorschachiens"? Parce que Gérald Stehr depuis des années travaille les taches et les empreintes, avec pliage à la manière des tests de Rorschach (du nom du psychiatre qui les inventa en 1921 pour soigner ses malades, en s'inspirant de jeux graphiques qui avaient déjà au XIXe siècle une longue tradition derrière eux).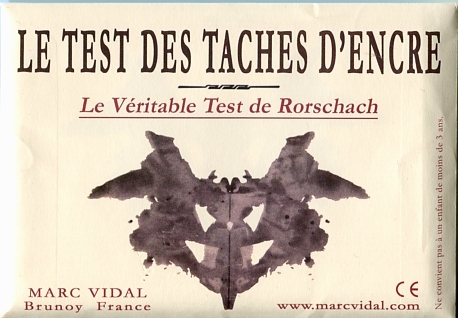 Il produit par des aller-retours continuels entre expérimentations et interprétations toute une smala de personnages plus incroyables les uns que les autres, extrêmement impressionnants je dois dire. Il devrait logiquement frapper l'imagination de beaucoup, si les petits cochons ne le mangent pas d'ici là (pourquoi ne lui a-t-on pas proposé d'exposer davantage depuis le temps? C'est un des grands mystères de ce temps, la cécité de nos médiateurs professionnels).
Il produit par des aller-retours continuels entre expérimentations et interprétations toute une smala de personnages plus incroyables les uns que les autres, extrêmement impressionnants je dois dire. Il devrait logiquement frapper l'imagination de beaucoup, si les petits cochons ne le mangent pas d'ici là (pourquoi ne lui a-t-on pas proposé d'exposer davantage depuis le temps? C'est un des grands mystères de ce temps, la cécité de nos médiateurs professionnels).
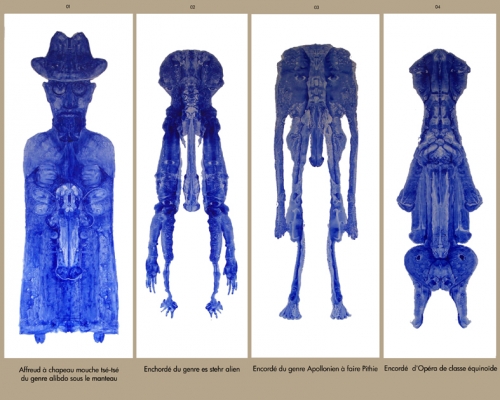
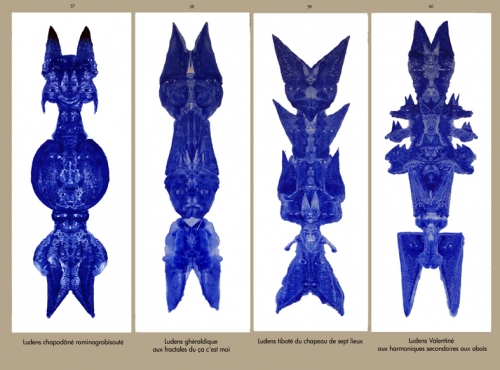
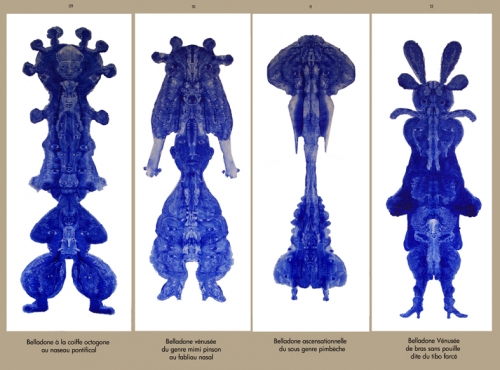
Gérlad Stehr
Avec Gérald Stehr, exposera également Thibaud Thiercelin, un de ses complices, avec 4 modestes toiles (de 2 x 2 m tout de même). Voir ci-dessous. Avis donc aux amateurs, voici encore une expo à ne pas manquer.

Thibaud Thiercelin, Mes Îles, 2 x 2 m
10:14 Publié dans Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : gérald stehr, alban richard, pléiades, xénakis, percussions de strasbourg, thibaud thiercelin, homo rorschachiens, taches d'encre, tests de rorschach, empreintes |  Imprimer
Imprimer
02/02/2013
Guy Harloff, le Hollandais volant
C'est le retour d'un peintre en ce moment, Guy Harloff (1933-1991), à la Galerie Les Yeux Fertiles (27, rue de Seine, Paris VIe ardt ; expo du 19 janvier au 28 février avec des peintures de Yolande Fièvre, des oeuvres de très belle qualité de Henri Goetz, Jiri Kolar, Christian d'Orgeix -on aimerait en voir plus de ce dernier- Mimi Parent, Jean Terrossian), sorte de peintre fantôme de la modernité passablement oublié, et peut-être inaperçu déjà de son temps, malgré des expositions marquantes en 1961 à la Galerie La Cour d'Ingres, ou chez Arturo Schwartz à Milan, ou encore à Venise. Peintre globe-trotter d'origine hollandaise, qui voyagea passablement en Italie, en Turquie, en Iran, dans le monde arabe, aux USA, et ailleurs en Europe, c'est peut-être pour cette raison qu'il n'eut pas le temps de marquer les mémoires dans les lieux traversés (je pense aussi à une autre artiste, apparentée au surréalisme, Alice Rahon-Paalen, qui voyagea beaucoup, exposa partout, fut une peintre inventive vite oubliée ; un DVD de la collection Phares d'Aube Elléouët a su réparer récemment cet oubli).
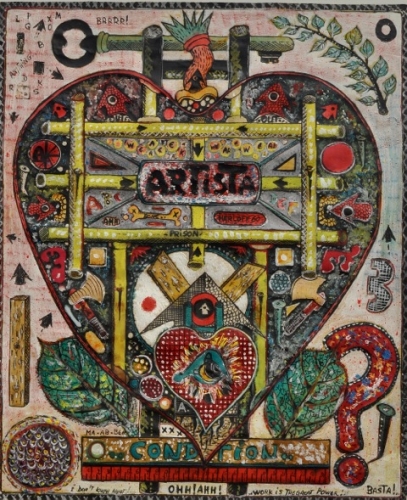
Guy Harloff, Heart, 1960, technique mixte sur papier, 41x34 cm
Sa peinture est un agglomérat de symboles venus de diverses cultures, entre autres orientales. Voici ce qu'écrivait à ce sujet Nanos Valaoritis en 1963 dans le n°28 de la revue Bizarre, numéro entièrement consacré à Harloff (j'avais ça chez moi sans l'avoir jamais lu, tout arrive): "Toujours entourés d'objets et enrichis d'inscriptions et exclamations diverses en toutes langues et écritures, apparaissent des soleils resplendissants, des roses des vents, belles comme des mariées, des roues du Destin, des feuilles, des ammonites, l'œil dans l'œil, le cœur dans le sexe, le triangle hermétique, images dont l'intention se rapporte plutôt au lyrisme et à la poésie spontanée qu'à la signification cachée, au défi et à la protestation ouverte d'esprit didactique, plutôt qu'à la cabale phonétique". Que "l'intention se rapporte plutôt à la poésie spontanée qu'à la signification cachée" me ravit et me séduit, parce que généralement les langages symboliques me paraissent d'une insupportable lourdeur. Ici, avec Harloff, rien de tout cela. Une qualité plastique indéniable que l'on soit dans le noir et le blanc du stylo Bic (travaux très proches de certains embrouillaminis visionnaires et ténébreux de l'art brut) ou dans la jubilation chromatique.
Une qualité plastique indéniable que l'on soit dans le noir et le blanc du stylo Bic (travaux très proches de certains embrouillaminis visionnaires et ténébreux de l'art brut) ou dans la jubilation chromatique.

Guy Harloff, une des oeuvres exposées aux Yeux Fertiles
Cet artiste se tint apparemment en lisière des courants dominants de son époque, restant sincère, concentré sur son inspiration et son chemin personnel. Il paraît de la même race que d'autres créateurs indépendants d'après-guerre, comme Jacques Le Maréchal, Michel Macréau, Jan Krisek, Hans Reichl (à qui Harloff reconnaissait devoir beaucoup) ou encore Gaston Chaissac. Il pourrait faire figure comme eux de grand ancêtre des créateurs "singuliers", ce mot si dévalorisé actuellement mais que je continue d'employer pour désigner les créateurs en marge du cirque médiatique, les périphériques de l'art contemporain ne se résignant pas à abandonner les arts plastiques traditionnels, les vrais purs, non vénaux...

Galerie Les Yeux Fertiles, vue de l'exposition Guy Harloff
Les "Singuliers" d'aujourd'hui souscriraient peut-être à cette envolée lyrique et pleine d'un bel excès de Guy Harloff parue elle aussi dans le même numéro 28 de Bizarre:
"Je pense que la peinture devrait rentrer dans la clandestinité ; tout comme les premiers chrétiens dans leurs catacombes. Il serait salutaire qu'elle redevienne, au moins pour un certain temps, souterraine, interdite. On peindrait en cachette, sans montrer ce que l'on fait. Pour soi-même. C'est mon désir le plus cher, et le plus secret.
En effet notre travail supporte un poids énorme et écrasant. Il est la proie des marchands, l'enjeu des spéculations, le gagne-pain et le moyen de faire fortune de beaucoup d'individus qui, sans la peinture, se tourneraient vers d'autres occupations tout aussi lucratives. Il faut produire pour ce marché, en accepter les liens, la tyrannie, les conséquences, ou bien rester dans l'ombre, solitaire, et crever de faim. La plupart d'entre nous travaillent dans des conditions désastreuses, sollicités de toutes parts, assaillis, vilipendés ou portés aux nues, toujours à la limite de l'endurance physique et spirituelle. Il s'ensuit généralement un abaissement de la qualité de la peinture, et bien des œuvres commencées dans la réalité et la vérité finissent en queue de poisson. Actuellement, nous sommes saturés de mauvaise peinture, et l'on voit un peu partout des tableaux et des dessins, signés même par des grands noms, qui auraient intérêt à être déchirés, ou tout au moins, à ne pas sortir de l'atelier.
C'est pourquoi je propose, le plus sérieusement du monde, qu'une loi internationale, ou quelque chose dans le genre, soit votée qui interdise la vente des tableaux, et l'acte de peindre.
Ceux qui continueraient malgré tout (moi, par exemple), les vrais mordus, ceux qu ne peuvent faire autrement, eh bien, ils peindraient quand même, mais en cachette, et cela serait toléré..." (Guy Harloff, extrait de "Où il est question de quelque chose d'autre...").

Guy Harloff, dessins au stylo Bic, expo à la galerie Les Yeux Fertiles
15:25 Publié dans Art moderne méconnu, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : guy harloff, alchimie, art singulier, périphérie de l'art moderne, art moderne méconnu, galerie les yeux fertiles, alice paalen, dvd les phares |  Imprimer
Imprimer
27/01/2013
Rêve sur rue
Donc, l'action de rêver en vitrine a bien eu lieu. Je n'ai pas d'information pour le moment sur ce que cela a donné. Voici quelques photos prises le jeudi 24 janvier. A la tête du dormeur équipé d'un bandeau oculaire et de boules Quiès, enfoncé dans une chaude couette écarlate, on voit que des textes ont été produits, tandis que les deux numéros de la revue qui accueillit ce rêveur en performances, l'Or aux 13 îles, se tiennent en sentinelles près du rêveur. Amusante coïncidence, l'après-midi où je suis passé, à quelques mètres de la vitrine au dormeur, était garé un camion de déménagement exhibant en trompe-l'œil une charmante baigneuse faisant ses ablutions moussantes en lisière de rue elle aussi. L'esprit du dedans-dehors soufflait fort ce jour-là, rue Dauphine...

Virgile Novarina l'intrigant dormeur de l'Inlassable Galerie, jeudi 24 vers 15h, ph Bruno Montpied

Plus près...

On peut lire le texte récemment produit à un réveil: "Pour une femme téléchargée, vous êtes bienveillante..."

Se baigner ou rêver devant tout un chacun, l'imaginaire qui tend à devenir réel
26/01/2013
Mes récentes publications (Info-Miettes n°21 bien narcissiques car centrées sur ma pomme)
"Art populaire et art brut, quelques exemples de comparaison", Actes I du séminaire sur l'art brut 2010-2011, dirigé par Barbara Saforova, éditions ABCD, 2012
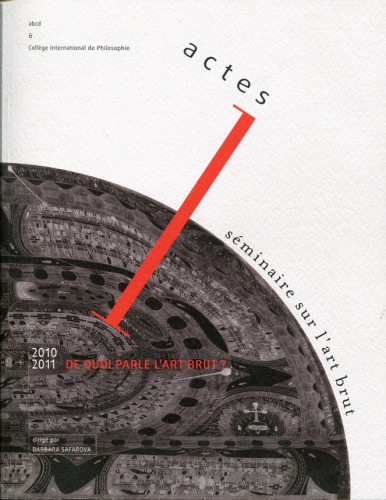 J'ai participé à ce séminaire qui se déroule dans les locaux du Collège International de Philosophie afin de présenter quelques éléments pemettant de mettre en regard art brut et art populaire insolite. Le but était de tenter de mettre en lumière à quel point, tout au moins pour une bonne part des collections d'art brut de Dubuffet transférées à Lausanne, l'art brut recélait des œuvres dont le style et les sujets étaient visiblement proches ou dérivés, malgré des ruptures, d'œuvres faisant partie des corpus de l'art populaire des campagnes d'autrefois. Comme je l'ai dit (briévement) dans mon intervention (dont le texte est donc paru dans ses Actes I publié l'année dernière), cette couleur populaire des collections était apparente surtout dans les premières décennies de la collection (commencée comme on sait vers 1945).
J'ai participé à ce séminaire qui se déroule dans les locaux du Collège International de Philosophie afin de présenter quelques éléments pemettant de mettre en regard art brut et art populaire insolite. Le but était de tenter de mettre en lumière à quel point, tout au moins pour une bonne part des collections d'art brut de Dubuffet transférées à Lausanne, l'art brut recélait des œuvres dont le style et les sujets étaient visiblement proches ou dérivés, malgré des ruptures, d'œuvres faisant partie des corpus de l'art populaire des campagnes d'autrefois. Comme je l'ai dit (briévement) dans mon intervention (dont le texte est donc paru dans ses Actes I publié l'année dernière), cette couleur populaire des collections était apparente surtout dans les premières décennies de la collection (commencée comme on sait vers 1945).
Depuis quelque temps, l'art brut tend à être redéfini dans différents travaux, notamment ceux de la directrice de ce séminaire Barbara Safarova, travaux qui insistent sur la dimension transgressive de l'art brut, détachée de tout souci de communication, quasi volcanique, se limitant à la matière pure du signe. Le rapport à la culture, à une présupposée absence de culture (même seulement artistique), est moins abordé désormais. L'aspect sociologique est beaucoup moins présent (l'aspect de démocratie directe dans l'art n'intéresse pas les commentateurs actuels, peu politiques). On se concentre désormais davantage sur le côté anthropologique (comme le fait par exemple dans ces Actes une Céline Delavaux) ou esthétique des productions de l'art brut (voire poétique, comme le fait l'assez délirant Manuel Anceau, toujours un peu à la limite de la voyance).
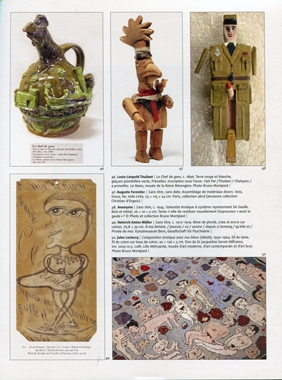
Une page d'illustrations de "Art populaire et art brut, quelques éléments de comparaison", intervention de Bruno Montpied, p.77 (de haut en bas et de gauche à droite, Thuilant, Forestier, un anonyme au De Gaulle membré -voir sur ce blog-, Müller et Leclercq)
Au sommaire de ces Actes I, on retrouve outre mon texte, illustré d'oeuvres comme les autres contributions (le tout édité avec le goût extrême que l'on reconnaît à chaque publication de l'Association ABCD, et je vous prie de croire que je ne leur fais pas de la léche), des interventions de Philippe Dagen sur Marcel Réja, de Céline Delavaux sur une réaffirmation qu'il ne faut pas limiter l'art brut à l'art des fous, de Baptiste Brun qui revient sur la notion d'homme du commun mise en avant par Dubuffet au début de ses recherches d'après-guerre, de Lise Maurer sur Laure Pigeon, de Béatrice Steiner (avec des illustrations montrant d'intéressantes oeuvres – je ne parle pas ici de celles de Serge Sauphar, assez mièvres, mais plutôt de celles d'un Adrien Martias – venues des archives de la section du patrimoine de la Société Française de Psycho-pathologie de l'Expression et d'Art-Thérapie) et enfin de Manuel Anceau interrogeant "L'art brut: une contre-culture?", mais ne répondant pas vraiment à la question, préférant céder à une dérive au fil de la plume, basculant la plupart du temps en termes abscons et se révélant à d'autres moments capables de traits de lumière, comme dans l'envolée finale de son texte où il cite une nouvelle de Philippe K. Dick dont le propos devient un beau symbole de ce que peut représenter l'art brut.
Actes I, séminaire sur l'art brut, "De quoi parle l'art brut?", dirigé par Barbara Safarova, 2010-2011, 160 p., 29€, éd.ABCD, sd, 2012. Disponible en vente à la librairie de la Halle Saint-Pierre, à la galerie ABCD, 12, rue Voltaire à Montreuil, et à la Collection de l'Art Brut à Lausanne. Voir également le site d'ABCD. A signaler en outre que la galerie de Montreuil est ouverte en ce moment pour l'exposition "Voodoo Chile" consacrée à J-B.Murray et Mary T.Smith le samedi et le dimanche de 12h à 19h jusqu'au 17 mars.
*
Cinéscopie n°26, 2012: BM, "Brunius, un cinéaste surréaliste en DVD"
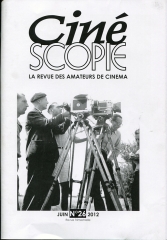
Bon, je vais pas la ramener trop encore sur Jacques Brunius, parce que j'en ai déjà abondamment parlé dans cette colonne de notes sans fin (ou presque). Le compte-rendu que j'ai publié dans la revue ci-dessus citée, en juin 2012, est une reprise de la note qui a paru ici même et qui est donc désormais aussi fixée sur papier (car les blogs durent ce que durent les fleurs, en un peu plus longtemps seulement...). A noter que cette revue destinée aux fondus de cinéma amateur, notamment Super 8, animée par un passionné fort sympathique, par ailleurs dessinateur autodidacte de grand talent (voir ci-dessous un de ses dessins), Michel Gasqui (alias Migas Chelsky), s'est aussi intéressée aux Bricoleurs de Paradis entre autres pour mes films Super 8 des années 1980 qui se retrouvent dans les bonus du DVD paru avec mon livre Eloge des Jardins Anarchiques, et dans certaines des incrustations du film.
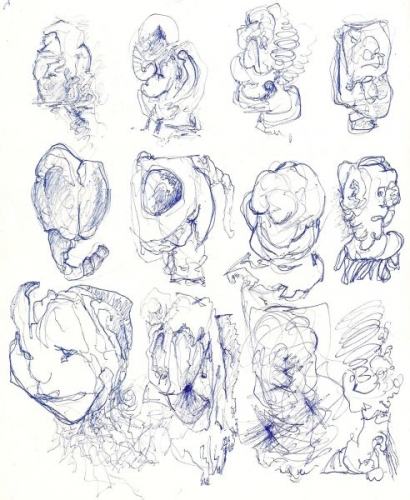
Migas Chelsky, Bidule 1
Pour obtenir Cinéscopie, voir le blog http://cinescopie.unblog.fr/
*
Création Franche n°37, décembre 2012, BM: "Bernard Jugie, un petit musée à usage interne"
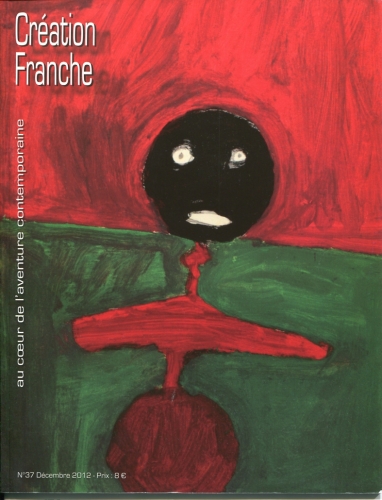
Autre découverte que j'ai faite l'été dernier, avec la maison Péridier et autres merveilles dont je devrais bientôt parler, voici un petit article, avec de belles photos en couleur, bien imprimées (j'en suis très fier, si, si) sur un créateur populaire à la retraite, Bernard Jugie. Je l'avais repéré en passant un jour par Billom dans le Puy-de-Dôme, du moins n'avais-je entraperçu que des petits décors naïfs placés au-dessus d'une porte et d'une fenêtre en rez-de-chaussée. J'ai attendu deux ans pour faire le tour du petit musée qui se cachait à l'étage. Quelques merveilles nous y attendaient moi et les deux camarades de dérive de cet été-là. Dont certaines se retrouvent ainsi photographiées et en pleine page dans ce dernier numéro de Création Franche. C'est la révélation d'un attachant créateur populaire caché au fond de l'Auvergne.
Je l'avais repéré en passant un jour par Billom dans le Puy-de-Dôme, du moins n'avais-je entraperçu que des petits décors naïfs placés au-dessus d'une porte et d'une fenêtre en rez-de-chaussée. J'ai attendu deux ans pour faire le tour du petit musée qui se cachait à l'étage. Quelques merveilles nous y attendaient moi et les deux camarades de dérive de cet été-là. Dont certaines se retrouvent ainsi photographiées et en pleine page dans ce dernier numéro de Création Franche. C'est la révélation d'un attachant créateur populaire caché au fond de l'Auvergne.
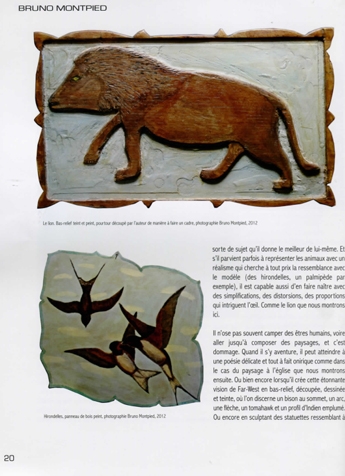
Une des pages consacrées au petit musée de Bernard Jugie, Création Franche n°37

Bernard Jugie, un renard taillé dans de l'aggloméré, coll. et photo inédite BM, 2012
A noter au sommaire de cette livraison d'autres contributions de Gérard Sendrey sur "Lucie M. dite de Syracuse", de Bernard Chevassu sur Christian Guillaud, de Joe Ryczko sur un "Monsieur Grosjean, constructeur d'automobiles en chambre", un projet des étudiants de l'association Campus dynamique sur une prochaine exposition du musée de la Création Franche hors les murs ("La Création Franche s'emballe! Itinérance d'une collection insoumise", du 4 au 14 février 2013 au Bâtiment 20 des Terres Neuves aux lisières de Bordeaux et de Bègles, première étape d'une exposition d'une centaine d'œuvres de la collection qui devrait partir en balade, nous dit-on, excellente initiative...), un texte de Pascale Marini sur Aloïse et Dubuffet et aussi des contributions de Paul Duchein sur Labelle et Dino Menozzi sur Enrico Benassi.
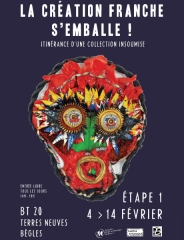
On reconnaît sur cette affiche un masque de Simone Le Carré-Galimard
La revue est disponible au musée ou en écrivant au contact du site web du musée.
*
Les Maçons de la Creuse, bulletin de liaison n°15, daté juin 2011 (en réalité imprimé et disponible en janvier 2013), avec deux textes de BM: "François Michaud n'était pas seul, quelques exemples d'environnements populaires créés avant le Palais Idéal du Facteur Cheval" et "La dynastie des Montégudet, inspirés de père en fils"
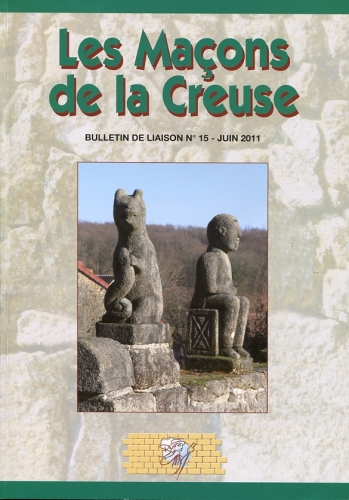
Dans ce bulletin, le deuxième texte sur les Montégudet, je l'avoue sans peine, est le même que celui publié dans mon livre Eloge des Jardins Anarchiques (qui lui-même était dérivé des notes parues sur ce blog...). Il est cependant mis en page différemment et comporte des photos supplémentaires inédites du petit musée privé de René et Yvette Montégudet, descendants et continuateurs de Ludovic Montégudet l'ancien maire de la commune creusoise de Lépinas qui avait créé un espace ludique et poétique avec statues et divertissements variés autour de son étang.
Le premier texte quant à lui, "François Michaud n'était pas seul", est par contre une amplification d'un texte précédent paru dans Création Franche n°28 en 2007 (« François Michaud et les autres, quelques exemples d’environnements populaires sculptés avant le Palais Idéal du facteur Cheval »). De nouvelles photos inédites et des paragraphes nouveaux évoquent quelques sites anciens ayant précédé les Facteur Cheval, abbé Fouré ou abbé Paysant. Par exemple les statues du sabotier Jean Molette auteur dans les monts du Lyonnais d'une œuvre naïve, taillée dans la pierre et le bois, tout à fait remarquable. Il fit des Napoléon, Ier et IIIe du nom, une immense Madone, une fontaine ornée d'un écu et de lions, des croix de chemin, le tout en plein air (certains restaurés par les architectes des Monuments Historiques, car ils sont classés à l'Inventaire). Ce bulletin me permet aussi de présenter un extraordinaire panneau sculpté du même Molette – en 1854, excusez du peu... –, parfaitement inédit jusqu'à présent, consacré à la gloire de l'Empereur Napoléon III dont ce sabotier était raide dingue (comme François Michaud le tailleur de pierre de la Creuse dont mon article le rapproche). "Le Tableau des Souverains de France" étant le titre de l'œuvre de Molette entièrement vouée à chanter les louanges impériales (Napoléon III est représenté à cheval entouré de 78 médailles chargées de figurer les rois de France que l'Empereur surclasse selon l'auteur). Ce bas-relief fut longtemps conservé dans les archives locales jusqu'à ce qu'il parte chez les brocanteurs à une date récente, et de là dans une collection privée parisienne. Ces représentations naïves et populaires de Napoléon correspondent au regain de bonapartisme que l'on put observer dans diverses campagnes auour de 1852 en France lors du retour au pouvoir d'un Bonaparte. On trouve maintes références à cette napoléonimania, qui ressemble à un culte, sous la forme de statuettes ou d'imagerie, voire de fresques.
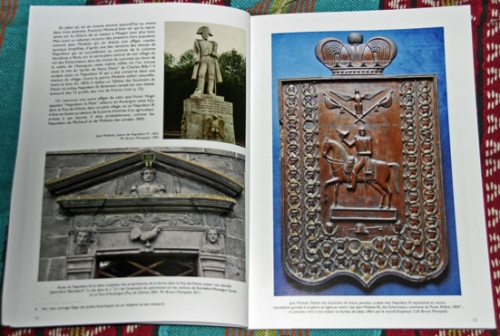
Le Napoléon Ier et le panneau sculptés par Jean Molette, et autres décors situés en plein air avant le Palais Idéal... Les Maçons de la Creuse n°15, pages de l'article de BM
Dans ce bulletin, je donne un autre exemple de décor napoléonolâtre photographié (là aussi, c'est complètement inédit) dans le Puy-de-Dôme près de La Tour d'Auvergne (voir ci-dessus). D'autres décors sculptés sur des maisons rurales du Cantal, que m'avait naguère signalés Emmanuel Boussuge sont également présents dans le numéro. Par ailleurs, l'article est flanqué d'encarts dus à la rédaction du bulletin (Roland Nicoux) et de nombreuses photos qui ajoutent de précieux renseignements sur les sculptures de François Michaud à Masgot. L'édition du livre que nous avions fait à plusieurs en 1993 sur ce créateur précurseur des environnements bruts et naïfs du XXe siècle aux éditions Lucien Souny étant désormais épuisée, ces précisions et photos sur Michaud viennent redonner un peu de lumière au sujet.

Raymond Arthur, arrière-petit-fils de François Michaud, sur le seuil de sa maison en 2009, ph. BM
J'en profite pour signaler également ici la disparition récente de Raymond Arthur dans sa 92e année, l'arrière petit-fils de François Michaud qui avait pieusement conservé l'œuvre de son aïeul et soutint le travail de médiation et de mise en valeur du site par l'association des Amis de la Pierre basée sur la commune (Fransèches, son président est le maire, M. Delprato), tout en livrant les souvenirs qui lui restaient à propos de son ancêtre (c'est à lui que l'on doit de connaître le surnom qu'avait Michaud auprès de ses concitoyens, "Navette"). Il fut le véritable passeur entre son aïeul et les générations actuelles, en même temps que l'ardent défenseur du patrimoine bâti et sculpté de son village.
Pour se procurer ce bulletin n°15, il faut écrire à: Les Maçons de la Creuse, 2, Petite Rue du Clocher, 23500 Felletin. Tél 05 55 66 90 81 ou 05 55 66 86 37. Lebulletin vaut 19€.
20:29 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Cinéma et arts (notamment populaires), Confrontations, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : abcd, barabara saforova, art brut, actes i séminaire, art populaire, bruno montpied, manuel anceau, céline delavaux, baptiste brun, cinéscopie, migas chelsky, création franche n°37, brunius, bernard jugie, art populaire contemporain, françois michaud, montégudet, jean molette, les maçons de la creuse, raymond arthur |  Imprimer
Imprimer
22/01/2013
Un nouvel écrivain nous est né
Certains écrivains se révèlent sur le tard. C'est le cas de Joël Gayraud. Après avoir fait paraître aux éditions José Corti son premier livre d'une certaine ampleur, La Peau de l'Ombre (car on ne retiendra peut-être pas le modeste ouvrage, Si je t'attrape, tu meurs, qu'il signa en 1995 de son nom aux éditions Syros, collection Souris Noire, plus alimentaire qu'autre chose et destiné à la jeunesse), publié ici ou là quelques plaquettes de poésie en prose, signé plusieurs traductions prestigieuses (Leopardi, Giorgio Agamben, Straparola), et commis plusieurs préfaces ou postfaces à divers textes, le voici qui nous revient avec un excellent recueil de petites proses ou notations poétiques, Passage Public, édité au Québec par L'Oie de Cravan.
On y retrouve quelques textes qui avaient paru il faut bien le dire confidentiellement dans diverses revuettes. Deux d'entre eux, A Fleur d'os et Un Inspiré en sa demeure, furent même parmi ses tout premiers textes publiés: par mézigue, dans mes revues auto-éditées, respectivement La Chambre Rouge n°4/5 (1985, le titre étant alors L'inspiré de la rue de Gyrokastër ; à noter que le texte a été amplement complété par rapport à cette première édition ) et L'Art Immédiat n°2 (1995 ; là aussi la version insérée dans Passage public comporte des modifications).
Si l'homme avait une conversation brillante à ces époques, stimulante à bien des égards, et si ses aperçus reposaient sur une documentation des plus originales, par ailleurs il ne paraissait pas chercher à publier des écrits (on était alors à une époque où l'on cherchait, dans les milieux se voulant d'avant-garde, à créer et à vivre des situations plutôt que conquérir des places dans le cirque médiatique). Médiateur dans l'âme comme je suis, je n'hésitai pas à lui mettre le pied à l'étrier. Peu importait que ces premiers essais d'écriture soient à cette époque par trop redevables à des styles et des contenus admirés. Il fallait commencer. Le temps passant, Joël s'est affirmé comme un brillant styliste et un écrivain poétique de toute première force.
 Une courte nouvelle parue dans la revue québécoise Le Bathyscaphe n°2 (juin 2008 ; la revue, qui a publié huit numéros, est disponible chez Anima à Paris, rue Ravignan dans le XVIIIe ardt ou en écrivant à le.bathyscaphe@gmail.com ; le n°2 est accessible en ligne ici même), une courte nouvelle intitulée Le Centaure de Santorin m'avait déjà alerté sur la métamorphose en cours, et notamment révélé à quel point il peut se montrer à l'aise dans des textes qui hésitent entre littérature et documentaire poétique sur les misères de notre monde. Les courts textes de Passage public sont de cette eau. Divers et variés, ils évoquent parfois Léon-Paul Fargue (la Couleur des rues), s'intéressent au fantastique social (Un Inspiré à sa demeure), retranscrivent des dérives flâneuses dans Paris (Matériaux pour une cartographie révolutionnaire de Paris, Sans feu ni lieu, ou Après le virage, ce dernier étant un texte que publia naguère ce blog, devenant du coup un peu plus espace de pré-publication...), critiquent "la définitive imbécillité de la compétition sportive" (Vive le catch!) ou campent la hantise de l'énergie atomique (Le Nez du monstre), font l'éloge des chiens grecs et leur bienheureuse paresse.
Une courte nouvelle parue dans la revue québécoise Le Bathyscaphe n°2 (juin 2008 ; la revue, qui a publié huit numéros, est disponible chez Anima à Paris, rue Ravignan dans le XVIIIe ardt ou en écrivant à le.bathyscaphe@gmail.com ; le n°2 est accessible en ligne ici même), une courte nouvelle intitulée Le Centaure de Santorin m'avait déjà alerté sur la métamorphose en cours, et notamment révélé à quel point il peut se montrer à l'aise dans des textes qui hésitent entre littérature et documentaire poétique sur les misères de notre monde. Les courts textes de Passage public sont de cette eau. Divers et variés, ils évoquent parfois Léon-Paul Fargue (la Couleur des rues), s'intéressent au fantastique social (Un Inspiré à sa demeure), retranscrivent des dérives flâneuses dans Paris (Matériaux pour une cartographie révolutionnaire de Paris, Sans feu ni lieu, ou Après le virage, ce dernier étant un texte que publia naguère ce blog, devenant du coup un peu plus espace de pré-publication...), critiquent "la définitive imbécillité de la compétition sportive" (Vive le catch!) ou campent la hantise de l'énergie atomique (Le Nez du monstre), font l'éloge des chiens grecs et leur bienheureuse paresse.
Mes préférés sont dans l'ordre du sommaire Parade napolitaine, où Joël montre clairement et parfaitement comment l'anarchie, comme le disait Elisée Reclus qu'il cite en exergue, est bien "la plus haute expression de l'ordre", Averse et Cresson, délicieuse rêverie sur un souvenir de passage à Uzerche ("la luzerne à Luzarches, l'usure de l'été à Uzerche..."), et ces deux textes qui tissent avec un égal bonheur, et grande virtuosité, rêve et état de veille, réussissant à montrer à quel point les deux peuvent se mêler, sans que cela débouche, comme cherche à le démontrer Caillois dans L'incertitude qui vient des rêves, sur une crainte et une méfiance à l'égard de l'activité onirique, j'ai nommé Chaleur sur la ville et L'erre.
Défauts de mémoire, qui clôt le mince recueil, enfonce encore davantage le clou de l'intrication du rêve et de la réalité telle que la littérature peut nous la révéler et nous la montrer désirable. Bref, on l'aura compris, avec Passage public, le lecteur raffiné aura en main une lecture délectable.
Joël Garyaud, Passage public, L'Oie de Cravan, 2012 (5460 rue Waverly, Montréal H2T 2X9 ; www.oiedecravan.com).
18:38 Publié dans Littérature, Littérature jeunesse | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : joël gayraud, passage public, l'oie de cravan, l'art immédiat, la chambre rouge, le bathyscaphe, élisée reclus, anarchie, onirisme |  Imprimer
Imprimer
D'autres bonhommes neigeux signés Darnish et Samantha
"Grands esprits" se rencontrant avec mes fanto-bonhommes, sur les bords de fenêtres s'entend, sans qu'on se soit consulté, Darnish et Samantha façonnaient eux aussi à peu près au même moment que moi des petits personnages glacés, cette fois à Rennes, pas plus épargnée par la neige que Paris. Ce sont des autoportraits, me disent-ils. Je leur trouve un côté un peu japonais.
Autoportraits en neige, Darnish et Samantha, photo Samantha, 2013
17:00 Publié dans Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : darnish, bonhommes de neige, art immédiat, land art spontané |  Imprimer
Imprimer
20/01/2013
Fanto-bonhommes de neige
Max T. ne m'envoie plus de photos de ses bonshommes de neige, alors je prends le relais. Sur le bord de ma fenêtre, se sont dressés des petits personnages aux bras écartés qui avaient simultanément tout l'air d'être aussi des fantômes. Ils paraissaient cogner à la vitre pour que je leur ouvre. Mais moi, sans pitié, je les ai laissés à leur glaciale atmosphère. J'ai assez de revenants en moi.
Ce sont de bons exemples d'art immédiat et éphémère en tout cas, qui ne sont pas de mon seul ressort, si l'on s'en réfère à l'espèce de Père Ubu écroulé sur le capot d'une voiture rue de Nevers, hier, et reproduit ci-après.
Fanto-bonhomme de neige, photo et façonnage Bruno Montpied, 19 janvier 2013
Deuxième mini bonhomme de neige, ph. et façonnage BM, 20 janvier 2013
Rue de Nevers, 19 janvier 2013 (les petites canailles à droite ne sont pas les auteurs), ph BM
Le même, passablement écroulé, ph BM
20:08 Publié dans Art de l'enfance, Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bonhommes de neige, land art spontané, bruno montpied, max t., art éphémère, fantômes, neige |  Imprimer
Imprimer
13/01/2013
J'expose avec "l'Or aux 13 îles" à l'Inlassable Galerie
Cette note contient une mise à jour du 14 janvier
C'est pour bientôt, dans une galerie que je ne connaissais pas, l'Inlassable Galerie, divisée en deux parties, une où le public entre, au 13 bis, rue de Nevers (une des rues les plus étroites de Paris, digne d'une nouvelle de Jean Ray), et une autre cachée derrière une vitrine au n°18 de la rue Dauphine, le tout dans le VIe ardt à Paris, à deux pas de la rue Guénégaud, dans le quartier des galeries de la Rive Gauche. C'est une galerie, je le souligne, qui ouvre sur RENDEZ-VOUS (tél: 0620994117 ou 0671882114), en dehors du jour de vernissage s'entend, et l'après-midi de 14h à 20h tous les jours, même le dimanche.
La revue de Jean-Christophe Belotti, L'Or aux 13 îles,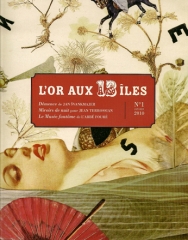 dont j'ai déjà plusieurs fois parlé ici (pour y avoir publié dans ses deux premiers numéros un dossier sur l'abbé Fouré et ses bois sculptés et un dossier sur une sélection d'art immédiat),
dont j'ai déjà plusieurs fois parlé ici (pour y avoir publié dans ses deux premiers numéros un dossier sur l'abbé Fouré et ses bois sculptés et un dossier sur une sélection d'art immédiat),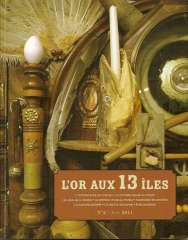 présente quelques créateurs dans une ambiance de cabinet de curiosités de façon à attirer de nouveau quelque peu l'attention sur ce qui se joue en elle et autour d'elle.
présente quelques créateurs dans une ambiance de cabinet de curiosités de façon à attirer de nouveau quelque peu l'attention sur ce qui se joue en elle et autour d'elle.
Sur le verso de l'invitation ci-dessus, on retrouve une image de Jean-Pierre Paraggio
Bruno Montpied, La chamane entre en danse par le charleston, 43x30 cm, 2010 (un des trois dessins que j'exposerai, les deux autres s'intitulant le Charrieur et l'Idéaliste emplumé)
Cela ira des dessins d'un enfant de 7 ans, Alexandre Cattin, récente découverte de Mauro Placi qui en parlera plus largement dans le futur n°3 de la revue de Jean-Christophe, jusqu'à divers artistes surréalistes comme Jan Svankmajer (présent sous forme d'affiches),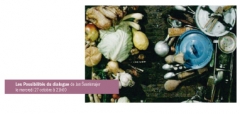 Jean Terrossian, Nicole Espagnol, Georges-Henri Morin, Josette Exandier, ou Alan Glass (dont Jean-Christophe présentera des photos des assemblages), en passant par des créateurs plus "singuliers" comme moi (j'exposerai trois dessins d'environ 40x30 cm), ou Charles Cako Boussion (voir ill. ci-contre),
Jean Terrossian, Nicole Espagnol, Georges-Henri Morin, Josette Exandier, ou Alan Glass (dont Jean-Christophe présentera des photos des assemblages), en passant par des créateurs plus "singuliers" comme moi (j'exposerai trois dessins d'environ 40x30 cm), ou Charles Cako Boussion (voir ill. ci-contre), des photographies (Pierre Bérenger, Pierre-Louis Martin, Diego Placi, Alexandre Fatta - un commentateur habitué de mon blog, celui-ci - des cartes postales anciennes de l'Ermite de Rothéneuf - en provenance de ma collection - plus deux de mes photos montrant le site de l'abbé de nos jours), des créateurs héritiers de l'inspiration surréaliste comme Jean-Pierre Paraggio, Guylaine Bourbon, ou encore Jean-Christophe Belotti qui exposera à cette occasion certains de ses collages.
des photographies (Pierre Bérenger, Pierre-Louis Martin, Diego Placi, Alexandre Fatta - un commentateur habitué de mon blog, celui-ci - des cartes postales anciennes de l'Ermite de Rothéneuf - en provenance de ma collection - plus deux de mes photos montrant le site de l'abbé de nos jours), des créateurs héritiers de l'inspiration surréaliste comme Jean-Pierre Paraggio, Guylaine Bourbon, ou encore Jean-Christophe Belotti qui exposera à cette occasion certains de ses collages.
Pierre-Louis Martin, sans titre, photographie (exposée à cette occasion), vers 1996
Des artistes dont je connais moins le travail seront également présents, Mélanie Delattre-Vogt (voir le n°2 de l'Or aux 13 îles et image en noir et blanc ci-dessous), François Sarhan (artiste ayant plus d'une corde à son arc apparemment), Claude Variéras, et le poète Mauro Placi venu tout spécialement d'Helvétie. L'idée générale, on l'aura compris, est de rendre hommage à l'ensemble de ce qui a été présenté dans la revue depuis ses débuts en 2010.
L'idée générale, on l'aura compris, est de rendre hommage à l'ensemble de ce qui a été présenté dans la revue depuis ses débuts en 2010.
Petite expérience appelée peut-être à grandement intriguer les passants de la rue Dauphine qui y circuleront entre 9h et 18h, derrière la vitrine du n°18 on pourra également voir Virgile Novarina se livrer, de façon diurne donc et devant les passants, à un sommeil destiné à provoquer des rêves qu'il notera et publiera peut-être à l'occasion (voir le n°2 de la revue où l'on parle de ses expériences précédentes). La "performance" en question aura lieu du 21 au 26 janvier. Autour de lui seront exposés différents éléments liés à la revue L'Or aux 13 îles.
La vitrine attendant la performance onirique de Virgile Novarina
Le vernissage, en même temps que le début de l'exposition, sont donc prévus pour le jeudi 17 janvier, et tous les lecteurs du Poignard Subtil sont bien entendu cordialement invités. La manifestation se déroulera jusqu'au 5 février 2013 (ouverture sur rendez-vous, téléphonique ou par mail, je le répète).
12:20 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier, Paris populaire ou insolite, Photographie, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'or aux 13 îles, jean-christophe belotti, l'inlassable galerie, abbé fouré, ermite de rothéneuf, bruno montpied, art immédiat, art singulier, josette exandier, jean-pierre paraggio, pierre bérenger, pierre-louis martin, charles cako boussion, jan svankmajer, georges-henri morin, nicole espagnol, diego et mauro placi, françois sarhan, mélanie delattre-vogt, virgile novarina, rêve en public, surréalisme |  Imprimer
Imprimer
11/01/2013
Une orgie de colloques et de séminaires
Et c'est reparti pour les conférences, colloques et autres séminaires où l'on veut tourner et retourner la question de l'art brut avec conséquence –imprévue?– de le cuire et recuire à l'infini. Cela risque de devenir immangeable à la longue, comme on s'en doute.
Cependant, on en apprend toujours au tournant de quelques phrases, devant telle ou telle image montrée par le conférencier, ou bien dans la friction de tels ou tels intervenants amenés à relativiser le côté trop péremptoire de certaines affirmations. C'est pourquoi il ne faut pas bouder son plaisir d'aller de temps en temps faire un tour dans ces parlotes. En ce qui me concerne, il m'arrive régulièrement d'y opérer des mises à jour grâce aux recherches des jeunes (têtes) chercheuses (car il semble qu'il y ait plus de filles que de garçons dans ces colloques) qui sont repassées sur des chemins que je croyais connus, or, bernique, il y avait une information que je n'avais pas relevée. Cela va peut-être arriver samedi 12 janvier, demain matin donc, à l'initiative du CrAB, salle Walter Benjamin, au rez-de-chaussée de l'INHA, dans la Galerie Colbert (c'est un passage parisien que je crois avoir déjà évoqué sur la colonne sans fin de ce blog). Elle relie la rue Vivienne à la rue des Petits-Champs (près des métros Bourse ou –non, pas la vie– Pyramides). C'est une galerie couverte très cholie, peut-être un peu aseptisée, qui longe à côté la plus célèbre Galerie Vivienne. Le thème de la matinée est "le Brut et le Naïf", car le CrAB veut documenter les rapports entre les deux, et la question de savoir si on doit vraiment les opposer. Et sur ce blog, la question m'intéresse grandement, il suffit de regarder la catégorie "art naïf" dans ma colonne de catégories pour se rendre compte du nombre de fois où j'évoque le sujet.
Morris Hirschfield, cornac et jeune éléphant (prêts à gazouiller sans nul doute...), taille approximative 32x44 cm, 1943
De 9h30 à 13h, il y aura deux jeunes femmes qui viendront s'étendre, pour l'une, sur la réception et la reconnaissance de l'art naïf américain dans les années 30 aux USA, et pour l'autre sur les rapports Chaissac/Jakovsky. Dans ce dernier cas, ce sera aussi l'occasion d'évoquer la gué-guerre entre Jakovsky et Dubuffet à propos des délimitations entre art brut et art naïf, et peut-être de ce fait adventice que Chaissac, de son côté, aurait préféré qu'on s'en tienne, pour qualifier son art, au label forgé par lui, avec ingéniosité, de "peinture rustique moderne".
« Du folk art au self-taught : la reconnaissance de l’art naïf aux États-Unis (1932-1942) » par Marion Alluchon, doctorante en histoire de l'art à Paris I.
« Dans l’orbite de Gaston Chaissac, l’homme orchestre (1952) : Gaston Chaissac et Anatole Jakovsky au regard de l’art brut et de l’art naïf » par Vanessa Noizet, étudiante en M2 d'histoire de l'art à Paris IV.
10:20 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : crab, marion alluchon, vanessa noizet, inha, gaston chaissac, anatole jakovsky |  Imprimer
Imprimer
05/01/2013
Arlette Reynaud est partie en avril
C'est par le blog très précisément documenté de la galerie-librairie d'Alain Paire à Aix-en-Provence, dans une note consacrée à Raymond Reynaud, que j'ai appris avec tristesse la disparition de son épouse Arlette le 10 avril dernier. Cela faisait un moment que je me demandais (vaguement) ce qu'elle devenait depuis la disparition de son époux, le "maître de Sénas du Mouvement Singulier Raymond Reynaud", en 2007. On apprend toujours dans la même note que leur maison sera prochainement vendue. Il y a de quoi s'inquiéter...
Raymond et Arlette (derrière King-Kong qui porte les lunettes et la casquette de Raymond) à Sénas, quartier de la Peyronnette, ph. Bruno Montpied, 1989
Raymond et Arlette à Mallemort, sur le site bizarre d'hommage à Nungesser et Coli de "Monsieur Zé", 1989, ph. BM
Car la maison et le petit domaine qui l'entourait, la bordille qu'avait constituée Raymond non loin, parce que les dépotoirs étaient en péril dans sa région et avec eux les matériaux dont il se servait pour constituer ses assemblages-totems (ce que j'aimais particulièrement dans son travail, voir le "King-Kong" ci-dessus), avec quelques décors (des sortes de cariatides –crois-je me souvenir?– installées sur une façade au début des années 90 lorsque je passai 4 jours en leur compagnie), décors destinés à donner une allure d'environnement singulier au bâtiment, l'ensemble de cette propriété paraissait voué à devenir le siège d'un musée, d'une fondation Raymond Reynaud, même si ce dernier avec son épouse ne paraissaient pas rouler sur l'or.
Raymond Reynaud prodiguant ses conseils dans le cadre de son atelier du Quinconce Vert à Salon-de-Provence, 1989, ph. BM
Ne vendant que peu ses oeuvres, ayant constitué dans une salle à part un petit musée d'oeuvres de créateurs amis ou en relation avec eux, notamment les créateurs qu'il initiait à la liberté de créer dans ses ateliers du Quinconce Vert à Salon-de-Provence (il n'y avait que des femmes lorsque je leur rendis visite ; un des rares créateurs masculins fut André Gouin, un cultivateur voisin des Reynaud, voir ci-contre sa "Perrette"), Raymond Reynaud avait amassé sans nul doute au fil des années une imposante collection d'œuvres en tous genres. Si la vente de la maison de ces deux artistes devait amener la dispersion de cette collection hors du nid où elle fut constituée, ce serait certes un beau gâchis.
Raymond Reynaud avait amassé sans nul doute au fil des années une imposante collection d'œuvres en tous genres. Si la vente de la maison de ces deux artistes devait amener la dispersion de cette collection hors du nid où elle fut constituée, ce serait certes un beau gâchis.
Arlette Reynaud, la soeur du maire célibataire dans le roman Jean de Florette, env. 29,7 x 21 cm, vers 1989, ph. et coll. BM
Arlette avait une période créatrice au moment où je les visitai (quoique je me sois toujours demandé si elle avait continué après une période "Jean de Florette", que tous au Quinconce Vert à un moment s'étaient mis en tête d'illustrer sous la férule du "Maître"). Par ces essais d'alors, elle manifestait un don naïf comme les peintres-paysans, à la différence de son mari qui avait plus de métier du point de vue de la technique picturale (c'était notamment un grand coloriste, d'une méticulosité et d'un acharnement dans la précision totalement obsessionnels) et une culture aux soubassements très distincts de ceux de son épouse (je me demandais s'il ne lorgnait pas du côté d'un certain psychédélisme, des bandes dessinées, et plus généralement des contre-cultures, reconverties au fil du temps en ce que l'on appelle aujourd'hui "les cultures urbaines"). Je le lui avais dit au cours de mon séjour. J'avais acquis du reste une de ses oeuvres délaissant celles de Raymond qui me touchaient au fond un peu moins. Il est cependant possible que je n'eusse pas alors vu les meilleures de ses productions qui ont pu progresser dans les années suivantes. Je les perdis de vue par la suite, du fait de mon éloignement géographique et de mes découvertes ultérieures d'autres créateurs. Mais j'ai gardé d'eux un grand souvenir.
Arlette Reynaud, le boulanger du roman Jean de Florette, env. 29,7 x 21 cm, vers 1989, ph. BM
Le texte que j'ai consacré à Raymond et à son Mouvement Singulier dans le n°4 de Raw Vision en 1991 (il est daté de 1989), peu diffusé (il était en français dans un supplément pour les francophones, tiré à peu d'exemplaires et glissé en édition séparée dans le numéro en anglais), se centrait sur le mouvement et le prosélytisme de Raymond, vu avant tout comme un prolétaire qui s'était toqué de devenir artiste et de propager sa passion parmi d'autres gens simples, eux aussi issus des couches populaires de la société. C'était à mes yeux le plus remarquable dans son expérience. Ce texte, qui mériterait que je le réécrive et le retravaille grandement (l'ordinateur était alors inconnu de mézigue ce qui m'empêchait de reprendre facilement mes textes), fut en outre quelque peu massacré à un endroit par les rédacteurs de Raw Vision qui oublièrent un morceau entier de phrase. J'ai rétabli, en annotation manuscrite, ce membre castré dans le fichier PDF que je mets en ligne ici et qui reproduit donc le fameux article. J'y ai également rétabli le titre exact, "Le retour de Raymond-la-Science, ou la bande à Reynaud". J'y tenais à ce "à", boudi...
C'était à mes yeux le plus remarquable dans son expérience. Ce texte, qui mériterait que je le réécrive et le retravaille grandement (l'ordinateur était alors inconnu de mézigue ce qui m'empêchait de reprendre facilement mes textes), fut en outre quelque peu massacré à un endroit par les rédacteurs de Raw Vision qui oublièrent un morceau entier de phrase. J'ai rétabli, en annotation manuscrite, ce membre castré dans le fichier PDF que je mets en ligne ici et qui reproduit donc le fameux article. J'y ai également rétabli le titre exact, "Le retour de Raymond-la-Science, ou la bande à Reynaud". J'y tenais à ce "à", boudi...
19:31 Publié dans Art naïf, Art singulier, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : arlette reynaud, raymond reynaud, galerie-librairie alain paire, art singulier, art naïf, andré gouin, atelier du quinconce vert, mouvement d'art singulier raymond reynaud |  Imprimer
Imprimer
01/01/2013
Quizz de nouvel an avec Guy Brunet
Pour commencer l'année avec un nouveau cadeau, j'offre le catalogue récemment paru de la Collection de l'Art Brut à Lausanne.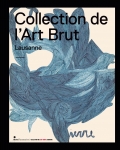 Oui, mais il faut trouver qui se cache derrière les silhouettes peintes par Guy Brunet que je mets en ligne ci-dessous... Ce sont des vedettes de cinéma, de celles qui font les délices de Guy Brunet concernant le Hollywood de la grande époque et le cinéma français d'avant la Nouvelle Vague.
Oui, mais il faut trouver qui se cache derrière les silhouettes peintes par Guy Brunet que je mets en ligne ci-dessous... Ce sont des vedettes de cinéma, de celles qui font les délices de Guy Brunet concernant le Hollywood de la grande époque et le cinéma français d'avant la Nouvelle Vague.
Je vous en soumets huit. Il faut les identifier toutes. Si les huit ne sont pas trouvées, le vainqueur sera celui qui aura le plus identifié de vedettes correctement (attention, le délai dans lequel arriveront les réponses compte aussi pour l'obtention du livre). Il y a des vedettes françaises, des vedettes américaines, une vedette autrichienne, une anglo-française (pour ces deux dernières, j'aide un max, je trouve)... Prêts? Un, deux, trois, partez...
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
15:45 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Cinéma et arts (notamment populaires) | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : guy brunet, hollywood, cinéma français, cinéma et arts populaires, art modeste, art naïf |  Imprimer
Imprimer
28/12/2012
Voeux 2013 de Solange Knopf (à partager, d'ailleurs j'y joins les miens)
Voici les vœux qui commencent à tomber comme à Gravelotte. Derniers reçus, et particulièrement jolis, les vœux de l'artiste belge Solange Knopf dont j'apprécie particulièrement les travaux. Voici ce qu'elle propose en outre, joint à son envoi:
"Chers amis,
Je vous envoie des vœux magiques, remplissez un ou plusieurs cercles de vos souhaits les plus chers, gardez un cercle vide pour le "Grand Mystère"..."
J'ai donc suivi à la lettre cette demande et j'ai incrusté dans un des cercles un de mes vœux "les plus chers" du moment...
Bonne année 2013...
11:01 Publié dans Art singulier, Voeux de bonne année | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : solange knopf, bruno montpied, art singulier, voeux 2013 |  Imprimer
Imprimer
26/12/2012
Arsène Vasseur, un autre créateur anonyme en Picardie
Cela fait quelque temps que Laurent Jacquy (du blog Les Beaux Dimanches, voir liens en colonne de droite) m'a fait passer une minuscule brochure consacré à un autodidacte inconnu nommé Arsène Vasseur, document qui paraît être la seule trace qu'ait bien voulu laisser transpirer le Musée de Picardie, en organisant à Amiens du 27 février au 28 mars 1999 une exposition au Centre Culturel du Safran.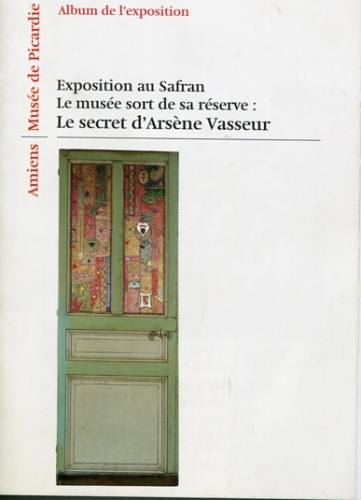
Il s'agissait pour ce musée de faire découvrir, à l'occasion d'un événement exceptionnel (la quatrième édition de la série "Le Musée sort de sa réserve"), les objets, les "œuvres", les meubles décorés – voire certains documents photographiques ? – qui furent légués au musée après la mort du créateur. Arsène Vasseur, né en 1914, est en effet décédé en 1994. Malheureusement, peut-être par manque de sous?, ou par manque de motivation (plus probable, hélas, mais je ne voudrais pas me montrer trop pessimiste...), l'exposition, apparemment, n'a pas fait l'objet d'un catalogue (si je m'en tiens à ce que m'en a dit Laurent Jacquy). C'est bien dommage, étant donné que c'était la première fois qu'on sortait le bonhomme des réserves où il se retrouve enfoui... A peine a-t-on songé à laisser aux enfants un petit livret-questionnaire agrémenté de quleques minuscules photos qui me laissent personnellement grandement sur ma faim, mais qui constitue en même temps le seul tremplin dont mon imagination se saisit, tentant de vous transmettre une curiosité que j'espère contagieuse. Ce livret évoque les créations de ce Vasseur, à mon grand étonnement de lecteur éloigné, avec un sous-entendu que son œuvre est bien connue... Tu parles...
Arsène Vasseur, Magic délirium cacophonic
Vue de l'intérieur de la maison d'Arsène Vasseur avec différents tableaux d'hommage, à sa femme entre autres, et télévision décorée au premier plan
Il semble que l'homme ait eu deux passions, sa femme et ses violons d'Ingres qui consistaient à orner sa demeure de mosaïques de perles, de tableaux d'assemblages, de meubles richement ornés de matériaux divers agglomérés par-dessus (voir le tourne-disques à cornet que j'immisce au bas de cette note, ou la télévision recouverte d'un décor), s'élevant à la hauteur d'oeuvres commémoratives assez insolites, comme le meuble d'hommage à la Tour Eiffel bizarroïde ci-dessous...
En farfouillant sur internet, on ne trouve que fort peu de choses sur Arsène Vasseur. Le Musée de Picardie ne dispose pas d'une numérisation de ses collections les plus secrètes. Seul un entrefilet extrait d'un vieux numéro de L'Œil (n°504, mars 1999) apporte de maigres précisions: "Personnalité discrète, douée d’un véritable génie inventif, cet autodidacte a su créer un art original, à mi-chemin entre art populaire et art forain, inspiré tantôt par sa vie familiale, tantôt par son environnement urbain ou ses occupations domestiques (la philatélie). Dans ses reliefs, composés de matériaux de récupération – et principalement de plastique – prédominent un principe d’accumulation et le choix de couleurs vives, mêlées arbitrairement". "Arbitrairement", cela me paraît discutable, mais passons... Quant à la philatélie, en effet, on y pense en tombant sur le tableau qui ressemble à un projet (ou une copie ?) de timbre commémorant les exploits de l'aviateur Jean Mermoz (je n'en connais pas la taille, le livret n'apportant bien entendu aucune précision sur le sujet... Pas davantage du reste que sur les autres pièces reproduites).
ne dispose pas d'une numérisation de ses collections les plus secrètes. Seul un entrefilet extrait d'un vieux numéro de L'Œil (n°504, mars 1999) apporte de maigres précisions: "Personnalité discrète, douée d’un véritable génie inventif, cet autodidacte a su créer un art original, à mi-chemin entre art populaire et art forain, inspiré tantôt par sa vie familiale, tantôt par son environnement urbain ou ses occupations domestiques (la philatélie). Dans ses reliefs, composés de matériaux de récupération – et principalement de plastique – prédominent un principe d’accumulation et le choix de couleurs vives, mêlées arbitrairement". "Arbitrairement", cela me paraît discutable, mais passons... Quant à la philatélie, en effet, on y pense en tombant sur le tableau qui ressemble à un projet (ou une copie ?) de timbre commémorant les exploits de l'aviateur Jean Mermoz (je n'en connais pas la taille, le livret n'apportant bien entendu aucune précision sur le sujet... Pas davantage du reste que sur les autres pièces reproduites).
Arsène Vasseur, Mermoz, la légende "Barlangue" en bas à droite me laisse quelque peu perplexe, auriez-vous des éclaircissements à apporter, vous qui me lisez? [Ah merci à Luc M de Rézé (voir commentaire ci-dessous) qui, comme il fallait bien sûr le faire, a cherché sur Internet et a compris qu'il s'agit d'une signature, et que donc ce tableau d'Arsène est probablement une copie agrandie d'un timbre existant]
Plus généralement, la façon de mosaïquer, d'assembler de toutes petits fragments évoque les collages de morceaux de timbres comme il s'en est fait beaucoup au cours du XXe siècle.
Anonyme, XXe siècle, collage de timbres pour représenter un vase et un bouquet, anc. coll. Michel Boudin, actuellement coll. BM
Sans oublier que cela possède aussi des rapports avec les bannières commémoratives sur tissu des soldats réchappés de campagnes militaires, ainsi qu'avec la marquéterie ou les reliquaires. "L'armoire à illusion" ci-dessous, dont je ne sais ce qu'elle abritait d'illusionniste, aide à se l'imaginer.
Arsène Vasseur, Illusion
A noter enfin que notre héros devait probablement goûter passablement la musique (il est rapporté dans le livret que son affection se portait plus vers la "Marinella" de Tino Rossi que vers des rythmes rock n'roll), à voir son tourne-disques rudement embelli et son panneau magico délirant "cacophonic" (voir ci-dessus).
00:24 Publié dans Art Brut, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arsène vasseur, le sfran, musée de picardie, laurent jacquy, art modeste, art naïf, reliquaires, philatélie, collage de timbres, mermoz, tour eiffel, tino rossi |  Imprimer
Imprimer
25/12/2012
Noël pour loup-garou
01:29 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : père noël, bruno montpied, art signulier, loup-garou, lycanthrope, noël |  Imprimer
Imprimer
22/12/2012
Louis-Auguste Déchelette et les saints...
Ce petit tableau de Louis-Auguste Déchelette aperçu récemment sur la couverture d'une ancienne plaquette préfacée par Anatole Jakovsky, avec un texte de Franco Cagnetta, le tout ayant servi de catalogue pour une expo à la galerie Le Cadran Solaire vers 1966 (deux ans après la mort de Déchelette), fait partie d'un dossier que j'ai ouvert en privé ce jour sur les tableaux-calembours (du nom du reste que cette expo du Cadran Solaire avait pris) et d'une nouvelle rubrique que j'insère à partir d'aujourd'hui dans ma colonne de catégories, "L'œil du sciapode", qui sera consacrée aux tableaux que je trouve remarquables en dépit de leur méconnaissance par le public.
Je mets le tableau de Déchelette en parallèle avec une autre peinture relevant de la même catégorie des calembours visuels, d'Armand Goupil cette fois, frère par l'esprit (sinon par le style) de Déchelette.
Louis-Auguste Déchelette (notez les ouvriers derrière la fenêtre que l'on voit sur un échafaudage en train de restaurer des statues...)
Armand Goupil, Corps nue, cornue, 8-V-62
14:10 Publié dans Art inclassable, Art naïf, Confrontations, L'oeil du Sciapode | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-auguste déchelette, armand goupil, tableaux-calembours, anatole jakovsky, art naïf |  Imprimer
Imprimer
16/12/2012
La chute de la maison Péridier, la fin d'une merveille?
Un des mes souvenirs d'enfants les plus enchantés se rapporte à une balade que nous avions faite en compagnie de ma mère et de mon frère à Saint-Jean-de-Monts en Vendée il y a maintenant près de 50 ans... Comme il est d'usage, ce souvenir s'est bien entendu décomposé puis recomposé, lentement modifié au fil du temps. Je nous vois, entraînés par moi qui étais pourtant le plus petit des trois, à aller s'enquérir d'un bâtiment que je trouvais étrange, ses toits et tourelles émergeant des frondaisons d'une pinède à l'horizon, loin derrière les limites de la ville (ce paysage, dans mon souvenir, se tient comme un monde parallèle, situé à côté de la dernière maison de la cité sur le front de mer, la limite de la ville à cette époque étant marquée d'une façon nette, presque irréelle, la dernière maison étant suivie par une dune, des joncs, la pinède plus loin, etc.). Je prêtais à la demeure éloignée des charmes qui attisaient ma curiosité, il fallait à toute force qu'on aille y voir de plus près. Nous l'atteignîmes après quelques centaines de mètres, qui sont plutôt des kilomètres dans ma mémoire, et tournâmes autour, le bâtiment se révélant désaffecté, fermé en tout cas à une exploration plus poussée, ce que nous n'aurions sans doute pas pu faire de toute façon en cas de portes ouvertes, ma mère timorée veillant prudemment à la légalité de nos actions. Je me souviens encore que je supputais en regardant à travers les soupirails de la maison en apparence délaissée sur l'identité de son habitant. Il y avait de la hantise dans ce lieu...
Mais je me souviens aussi surtout de la quête, peu importait au fond ce que nous aurions trouvé dans la maison. Il y avait au bout de cet horizon un pôle de curiosité recélant toute forme possible d'enchantement. Et c'est cela que j'ai à nouveau éprouvé en lisant la note que Dom (qui se présente comme un "fouineur, héliotrope, naturiste, voire randonueur, canyonneur") mit en ligne il y a quelque temps déjà sur son excellent blog Hérault Insolite à propos de ce qu'il avait baptisé "La Villa Mystère" à Castries. Très extraordinaire demeure en vérité!... Et site d'art brut majeur, je n'hésite pas à l'affirmer.
Vue depuis la rue du domaine de Feu Roger Péridier à Castries, ph. Bruno Montpied, juillet 2012
Cette maison ressemble à un château, ou à une demeure princière, aristocratique, avec ses longues balustrades imitant celles du Château de Versailles (c'est le résultat de moulages à partir de balustres récupérés), ses têtes d'angelots incrustés un peu partout, son jardin fort allongé qui constitue, depuis le portail portant altièrement le monogramme du propriétaire,
son jardin fort allongé qui constitue, depuis le portail portant altièrement le monogramme du propriétaire, une véritable mise à distance du passant (Dom écrit dans la seconde note qu'il a consacrée sur son blog à Péridier, qu'il s'agit d'une petite "folie, digne héritière populaire des folies montpelliéraines de l’aristocratie languedocienne" ; oui, mais soulignons bien que le propriétaire de cette "folie" était un ouvrier, ce que l'adjectif de "populaire" dans le texte de Dom ne dit pas assez). La bâtisse au bout de la perspective ne paraît être qu'une façade, analogue au fond à un décor de théâtre. Enfoncée quelque peu dans le sol, étirée de façon incroyable, surmontée d'une coupole d'observatoire, d'une éolienne... Très étrange tout cela décidément...
une véritable mise à distance du passant (Dom écrit dans la seconde note qu'il a consacrée sur son blog à Péridier, qu'il s'agit d'une petite "folie, digne héritière populaire des folies montpelliéraines de l’aristocratie languedocienne" ; oui, mais soulignons bien que le propriétaire de cette "folie" était un ouvrier, ce que l'adjectif de "populaire" dans le texte de Dom ne dit pas assez). La bâtisse au bout de la perspective ne paraît être qu'une façade, analogue au fond à un décor de théâtre. Enfoncée quelque peu dans le sol, étirée de façon incroyable, surmontée d'une coupole d'observatoire, d'une éolienne... Très étrange tout cela décidément...
Vue rapprochée de la "folie" du sieur Péridier, ph. BM, juillet 2012
Si l'on regarde plus attentivement, on s'aperçoit tout à coup que sont semées au loin, devant la maison, des statues de style incontestablement naïvo-brut, représentant des personnages qui pourraient bien être les acteurs de la pièce dont la bâtisse constitue le décor précisément. Un toréador, une "Bohémienne" qui a perdu les attributs qui permettraient de l'identifier ainsi (à moi, elle me paraît avant tout, à l'origine, ressembler à une danseuse espagnole, le peigne fiché au sommet de sa chevelure, un éventail à la main droite ), un Africain en chéchia (chargé de signaler par un ingénieux mécanisme l'arrivée d'un visiteur en tapant sur un tam-tam), des animaux (autruche?, fauve, chèvre), un cavalier à califourchon sur un taureau...
Toreador, en juillet 2012, il brandissait à l'origine une muleta... qui a depuis disparu, de même que ses chapeaux... De plus son bras droit est ici en position levée, alors qu'à l'origine il était baissé, on doit donc supposer qu'il a été tordu... ph.BM
Voici comment était le toréador dans son état neuf, la muleta au bout du bras droit, la pique au bout du bras gauche, et il a son chapeau, ph archives Péridier (publiée sur le blog Hérault insolite), date? Peut-être les années 90? ; à noter qu'un dispositif lui permettait de tourner pour être plus commodémeent orienté vers le taureau qu'il était censé mater...
 A noter que sur cette photo, le toreador a un chapeau plus traditionnel... Ph Archives Péridier (blog Hérault insolite)
A noter que sur cette photo, le toreador a un chapeau plus traditionnel... Ph Archives Péridier (blog Hérault insolite)
La "Bohémienne" devant la maison, tournée d'une façon qui ne correspond pas à sa position initiale, et divers de ses attributs d'origine ayant disparu, ph BM, juillet 2012
Roger Péridier au milieu de son jardin, derrière la "Bohémienne", femme espagnole à la jupe jaune, tenant un éventail à la main et un peigne fiché au sommet de sa tête, ph Archives Péridier (sur le blog Hérault insolite), années 90?
Un cavalier chevauchant un taureau, ph Archives Péridier (blog Hérault insolite) ; le taureau est toujours debout en 2012, mais le cavalier gît à terre renversé dans les herbes qui envahissent tout désormais...
Vue de face du jardin avec la demeure en fond de perspective, archives blog Hérault insolite, années 90?
La plupart de ces figures sont fort abîmées, renversées à terre, recouvertes par la végétation qui envahit peu à peu le domaine en pleine décadence, passablement saccagé par des vandales insensibles à la magie et à la rareté du lieu.
On trouve aussi sur internet un clip de jeunes musiciens qui se sont filmés dans le domaine en ruine, poussant la désinvolture à se montrer dansant avec l'Espagnole qu'ils font virevolter. Certes, leur démarche procède certainement à leurs yeux d'une volonté de faire connaître le lieu, mais les escalades qu'ils y font, le jeu avec l'Espagnole, il est vrai pourvue elle aussi d'un système rotatif, peuvent avoir des conséquences imprévisibles sur d'autres plus vandales qu'eux.
Autruche (?) et autre statue renversées, ph BM, juillet 2012
Le domaine Péridier est en effet à l'abandon, les héritiers de l'endroit étant divisés sur le sort à lui faire. Dom a pu cependant rencontrer deux petits-enfants, Amélie et Stéphan, qui ont su conserver au moins quelques traces photographiques révélant comment se présentait le site du temps de sa splendeur. Le père de ces deux petits-enfants affiche lui aussi la volonté de faire quelque chose pour sauver ce patrimoine (non seulement familial, mais aussi collectif dans la mesure où les spectateurs qui passent devant cette demeure devraient avoir leur mot à dire sur cet ensemble architectural et artistique s'imposqnt dans le paysage commun.
Le temps de sa splendeur n'était probablement pas très éloigné d'aujourd'hui, puisque Roger Péridier, le créateur, ancien couvreur-zingueur et bricoleur de génie, n'est décédé qu'en 2003 (il était né en 1914, et créa son domaine des années 30 à la fin des années 70, affirme Dom), mais la ruine se propage vite hélas.
Roger Péridier au milieu de son domaine, vers la fin de sa vie? Ph. Archives Péridier (blog Hérault insolite)
Roger Péridier a fait sa folie à partir d'un emplacement où il y avait à l'origine un cabanon inséré au milieu des vignes. Il avait la conviction, au rebours de la plupart de ses voisins, qu'il pouvait dénicher une source sur cette terre en apparence aride. Le voisinage du viaduc de Castries tout proche devait l'inspirer...
Fontaine et périscope fiché dessus, ph. BM, juillet 2012
Il se mit à creuser un puits avec les moyens du bord et il parvint à faire jaillir de l'eau! Le puits est toujours en place aujourd'hui, sous l'éolienne, à quelques mètres d'une fontaine munie d'un périscope destiné à propager la lumière par un jeu de miroirs jusque dans les étages creusés en dessous. Car Péridier, en bâtisseur et bricoleur inspirés, avait aussi taillé des salles souterraines, de même qu'il avait installé toutes sortes d'ingénieux dispositifs que Dom détaille excellemment sur son blog Hérault insolite, et que je ne reprends pas ici, vous renvoyant à lui.
Fauve, ph BM, juillet 2012
L'ensemble de cette propriété aujourd'hui en pleine décadence, saccagée par toutes sortes de squatteurs inconscients, qui ne réalisent pas le génie mis en œuvre par Péridier et l'exemple qu'il nous donne en matière d'ingéniosité, d'économie d'énergie (ses éoliennes bricolées par lui, ses moteurs fabriqués à partir de fragments de machines-outils récupérées, un monte-charge...), déployées non seulement par souci écologique mais plus sûrement par goût du jeu et de l'ingéniosité recherchée pour elle-même, l'ensemble de cette propriété devrait bien entendu être sauvé, même si son charme a disparu depuis que son auteur nous a quittés. Elle ne doit pas être vendue, ni modifiée. Aux armes, amateurs des génies des bords de routes! C'est la poésie la plus pure qui meurt là-bas au milieu de l'Hérault...
L'Africain en chéchia renvoyé à la jungle... Ph BM, juillet 2012
11:44 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : roger péridier, villa mystère à castries, hérault insolite, habitants-paysagistes, sculpture naïve, folies aristocratiques, environnements populaires spontanés |  Imprimer
Imprimer
08/12/2012
Graffiti cousus sur grille, du nouveau dans les inscriptions urbaines
Dans mon périmètre d'arpentage perpétuel (j'ai souvent comme ça de ces moments à tuer) situé peu ou prou dans les Xe et XIe arrondissements, je suis tombé il y a quelques temps sur une drôle d'inscription à signification socio-politique quoique... Elle était brodée, si je puis dire, par-dessus les mailles du grillage d'une barrière de chantier. Et elle n'était vraiment pas facile à lire, vu qu'elle épousait étroitement les tiges métalliques. On pouvait passer devant sans la voir.
Mais qui avait pu passer autant de temps à tisser d'une telle façon ce texte sur un support des plus exposés à toutes les vicissitudes?
Le texte protestait contre le fait suivant (je n'ai pas vérifié si la statistique est bien fondée): "75% des pauvres = [le symbole de la gent féminine]", 75% des pauvres sont des femmes... C'était une protestation féministe apparemment, dans une technique traditionnellement impartie aux femmes. Exemple unique à ma connaissance dans l'art du graffito (au terme peu idoine en l'occurrence) et de l'inscription politique, en tout cas...
Inscription tissée avenue Parmentier Xe ardt, octobre 2012, ph. Bruno Montpied
Plus grande...
Encore plus rapprochée
17:03 Publié dans Art immédiat, Graffiti, Inscriptions mémorables ou drôlatiques, Paris populaire ou insolite, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : inscriptions insolites, créations textiles, graffiti, féminisme, paris insolite |  Imprimer
Imprimer
02/12/2012
Un troisième exemple de créateur brut iranien

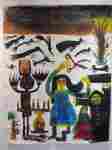 Oui, j'ai bien dit trois, car il y avait eu jusqu'ici Mokarrameh Ghanbari (voir ci-contre le mur peint dans sa maison) et Akram Sartakhti (voir ci-contre les personnages peints sur toile, dont une femme en bleu) naguère exposée à la Halle saint-Pierre. J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce blog . Voici en outre, présenté par la Galerie Hamer de Nico Van Der Endt à Amsterdam (qui avait elle aussi exposé autrefois Sartakhti), un troisième créateur de toute première force, Davood Koochaki, né en 1939 dit le carton de l'exposition, dans la partie nord de l'Iran, dans une région de rizières. Son œuvre essentiellement graphique s'apparente à d'autre dessins rangés habituellement dans l'art brut.
Oui, j'ai bien dit trois, car il y avait eu jusqu'ici Mokarrameh Ghanbari (voir ci-contre le mur peint dans sa maison) et Akram Sartakhti (voir ci-contre les personnages peints sur toile, dont une femme en bleu) naguère exposée à la Halle saint-Pierre. J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce blog . Voici en outre, présenté par la Galerie Hamer de Nico Van Der Endt à Amsterdam (qui avait elle aussi exposé autrefois Sartakhti), un troisième créateur de toute première force, Davood Koochaki, né en 1939 dit le carton de l'exposition, dans la partie nord de l'Iran, dans une région de rizières. Son œuvre essentiellement graphique s'apparente à d'autre dessins rangés habituellement dans l'art brut.

Davood Koochaki, Couple, 100x70 cm, crayon sur papier, Galerie Hamer
Sa biographie ressemble à celles d'autres exemples de création autodidacte, une enfance pauvre et difficile (il travailla dès l'âge de 7 ans et n'apprit à lire et à écrire que par ses propres moyens quand il fut plus âgé), une origine ouvrière (il fut réparateur de voitures), aucune formation en dessin, et un fils artiste qui l'incite à persévérer dans le hobby qu'il se découvre à 40 ans, le dessin, et qu'il systématise à 60, dès qu'il se retrouve avec plus de temps à sa disposition. L'influence du fils artiste, on la retrouve chez des créateurs européens comme Boix-Vives ou Joseph Barbiero. Cela fonctionne comme un stimulant, encouragé qu'on est à créer par une instance normalisée alors qu'on se sentait par trop atypique peut-être...
Koochaki, Créatures, 100 x 70 cm, Crayons, Galerie Hamer
Il dessine aux crayons graphite et de couleur des créatures imaginaires, semi mythologiques, parfois proches de l'humain. Les oiseaux font de fréquentes incursions sur ses pages. Il paraît dessiner de façon automatique, accueillant ce qui surgit avec hospitalité, ne regrettant pas qu'une œuvre plus "esthétiquement correcte" ne soit pas venue finalement, alors qu'il l'avait pourtant désirée au départ. Ayant de la sympathie pour le parti communiste iranien, il pense que l'étrangeté de ses créatures sont peut-être à mettre en rapport avec son passé difficile.
Koochaki, figure, 100 x 70 cm, crayon, Galerie Hamer
Sa figuration tout en hachures juxtaposée, noires ou en couleur, campe des êtres qui en raison de leur densité, de leur compactage, de leurs contours ambivalents, sont à mi-chemin des règnes animaux, végétaux et minéraux. Des sortes de fantômes d'êtres non advenus, laissés à l'état de possibles, pour une autre planète...
Expo Davood Koochaki du 17 novembre au 5 janvier 2013. Galerie Hamer, leliegracht 38, Amsterdam. www.galeriehamer.nl.
18:57 Publié dans Art Brut, Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : davood koochaki, mokarrameh, akram sartakhti, art brut iranien, galerie hamer, nico van der endt |  Imprimer
Imprimer
26/11/2012
Des créatures champignonnesques
 e viens de produire une planche d'échantillons à base d'empreintes de champignons sectionnés. Le champignon joue toujours les tampons avec facilité. Je n'en avais pas refait depuis des années. Les créatures apparues sont curieuses je trouve. Ça et là, des éléphants pointent le bout du museau, lorsque ce ne sont pas, à la place, des visages surmontés de fardeaux portés somme toute d'un air conciliant.
e viens de produire une planche d'échantillons à base d'empreintes de champignons sectionnés. Le champignon joue toujours les tampons avec facilité. Je n'en avais pas refait depuis des années. Les créatures apparues sont curieuses je trouve. Ça et là, des éléphants pointent le bout du museau, lorsque ce ne sont pas, à la place, des visages surmontés de fardeaux portés somme toute d'un air conciliant. Des chapeaux sont bien arrimés, jouant un rôle important dans ces apparitions, ces réminiscences de personnages entrevus peut-être au départ (mais quand?) dans la réalité ou dans l'imaginaire du cinéma (un des mes anciens camarades, Thierry Tricard, avait bien remarqué l'invasion de ces couvre-chefs par ailleurs). Des cheveux flottent au vent. Des barbiches, des mentons pointus de vieux prêtres russes ou de rabbins. Des bras poussent dans les crânes... Un profil d'homme aux lèvres fardées songe doucement à la gorge d'une femme cachée dans sa joue, tandis que divers autres personnages se promènent dans sa tête.
Des chapeaux sont bien arrimés, jouant un rôle important dans ces apparitions, ces réminiscences de personnages entrevus peut-être au départ (mais quand?) dans la réalité ou dans l'imaginaire du cinéma (un des mes anciens camarades, Thierry Tricard, avait bien remarqué l'invasion de ces couvre-chefs par ailleurs). Des cheveux flottent au vent. Des barbiches, des mentons pointus de vieux prêtres russes ou de rabbins. Des bras poussent dans les crânes... Un profil d'homme aux lèvres fardées songe doucement à la gorge d'une femme cachée dans sa joue, tandis que divers autres personnages se promènent dans sa tête.
Ailleurs, ce sont des corps-grumeaux, des agrégats ambulants, compacts, résolus et fatalistes, malgré une ou deux mines effarées près d'eux, (se doutant peut-être des menaces d'éclatement qui pèsent sur les corps-grumeaux, perpétuellement en danger de morcèlement, de fragmentation). Un clown tente un pas de danse, guère de mise dans un tel régiment bien rangé. Une sorte de cangaceiro enfantin piètine allégrement un chauve masochiste. En somme une planche d'échantillons de convenables hallucinations comme en lévitation (voir les ombres noires à leurs pieds)...
Bruno Montpied, 27 créatures-champignons-hallucinogènes, 40 x 30 cm, 2012
6 créatures agrandies... Celui que je désigne comme un "cangaceiro" est en haut à droite
Un dominant et un qui le supporte avec philosophie?
23:30 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : bruno montpied, art singulier, thierry tricard |  Imprimer
Imprimer
24/11/2012
Info-Miettes (20)
Boudin et Jakobowicz arrivent à Bègles
Prochaine expo au Musée de la Création Franche, qui continue de permettre aux artistes et créateurs de la collection permanente de montrer leurs derniers travaux, Marie Jakobowicz et Michel Boudin. Ce dernier, on le sait, propose des dessins à l'encre où des petites bêtes ne cessent de tarabuster les êtres humains, histoire peut-être de leur rabattre le caquet.
Michel Boudin, sans titre, encre sur papier vélin, 65 x 51 cm
Sur la seconde, voici le texte qu'elle m'avait dans un premier temps demandé pour la présenter de façon franche (c'était son souhait à elle, des gens qui diraient le pour et le contre, et l'entre deux...) et qu'elle a finalement fait remplacer par une autre présentation:
"Marie Jakobowicz me laisse perplexe. Si j’apprécie ses anciens pastels, discipline qu’elle pratique avec une aisance qu’elle a fini (bizarrement !) par trouver suspecte, je reste réservé en ce qui concerne toutes sortes d’autres travaux qu’elle veut de contenu « engagé » comme on disait dans les années 70. Ce choix à mon avis plombe l’envolée du merveilleux dont elle était aussi dépositaire.
Et je me demande si ses réticences, sa suspicion à l’égard de sa maîtrise du pastel ne viendrait pas de son traumatisme concernant l’extermination des Juifs par les Nazis. Une descendante des familles massacrées ne pouvant plus pratiquer la moindre forme d’expression sans se sentir obligée à la vigilance… Si cela était avéré, on mesurerait là à quel point cette tragédie et cette folie ont poussé loin leurs ruptures et leurs censures. N’y a-t-il donc plus de place, Marie, pour un merveilleux sans hantise du massacre ?"
Marie Jakobowicz et Michel Boudin au Musée de la Création Franche du 7 décembre 2012 au 20 janvier 2013.
*
Guy Girard, lui, expose dans un couloir
Guy Girard expose quant à lui à partir de jeudi prochain 29 novembre dans la Galerie du Couloir, espace dédié paraît-il aux petits formats (ce qui semble adéquat avec le nom de la galerie). Les horaires et jours de monstration sont assez particuliers. Le jeudi 29 novembre, c'est de 19h30 à 22h. Puis c'est entrée libre le samedi 1er décembre ainsi que le dimanche 2 de 14h à 18h. Ensuite, du 3 au 20, on visite sur rendez-vous: 06 19 63 64 51. Pour les artistes, l'heure est venue des jeux de pistes. L'art sincère d'aujourd'hui se cache au fond d'un labyrinthe. Il est passé par ici, il repassera par là...
*
Jean Estaque voit des saints partout
Il expose cette fois à Montluçon, avec une proposition de nouveaux saints qui n'auraient pas déplu au marquis de Bièvre qui était grand amateur comme on sait de calembours bons. Ci-dessous par exemple voyez le portrait de saint-Ethique.
Trouverons-nous encore dans cette expo Saint-Bol, Sainte-Hure, et peut-être aussi Saint-Dé, Saint-Trait et Saint-Plaie?
Galerie Ecriture, 1 rue Pierre Petit (ça ne s'invente pas, mais ce n'est sans doute pas le même qui est bien connu dans l'art brut), Montluçon, exposition du 28 novembre 2012 au 14 février 2013.
*
Alexis Lippstreu exposé chez Berst et au Madmusée
En cette fin d'année, on assiste à une déferlante Alexis Lippstreu à Liège et à Paris. Trois expos simultanées se tiennent pour vanter le travail de ce créateur handicapé qui s'est fait une spécialité (ou à qui on a fait une spécialité?) de transposer des chefs-d'œuvre de l'art dans une sorte de réduction graphique tout à fait fascinante (j'ai déjà eu l'occasion de montrer des images sur ce blog). Il paraît être en même temps un cheval de bataille exemplaire pour ceux qui voudraient mélanger art brut, art moderne et art contemporain dans la même arlequinade artistique ("artification", qu'ils disent, sans lésiner sur les néologismes effroyables).
Alexis Lippstreu au Madmusée du 1er décembre 2012 au 16 février 2013. A la Galerie Christian Berst, du 7 décembre 2012 au 12 janvier 2013. Au BAL (musée des Beaux-Arts de Liège), du 30 novembre 2012 au 16 février 2013.
*
L'art brut italien à travers le cinéma documentaire, une programmation de Pierre-Jean Wurtz et Denis Lavaud
C'est à la Halle Saint-Pierre (sans laquelle on ne sait pas ce que l'on deviendrait) que cela va se passer, durant le week-end du 15 et du 16 décembre. Un second programme de films courts a en effet été programmé pour ces dates. A découvrir ci-dessous:
Samedi 15 décembre 13h30 - 17h30
- Pennarelli (Antonio Dalla Valle) di La Manica Lungo officina creativa, 2003, 29’.
En présence d’Alain Bouillet, commissaire d’expositions, écrivain (c'est sur un atelier de créateurs handicapés, si je ne me trompe pas? NDR)
- Nella prospettiva della chiusura lampo de Paolo Pisanelli, 1997, 54’.
En présence d’Alain Bouillet
- Pietro Ghizzardi de Muriel Anssens, 2004, 10’
- Alla ricerca del giardino incantato (Marcello Cammi) di Piero Farina, Marisa Fogliarini con Marco Farotto, 2012, 21’, (c'est tout en italien, sur le jardin détruit de Cammi)
- Luci Sospese. L’opera irriducibile (Mario Andreoli) de Gabriele Mina, 2010, 27’. (Là aussi, c'est pas sous-titré, mais il y aura sans doute un interprète dans la salle, enfin on verra bien...)
En présence de Gustavo Giacosa, commissaire de l’exposition
La "Crèche" de Mario Andreoli telle qu'elle s'illumine aux alentours de Noël sur une colline ligure, ph extraite du site de la Galerie Rizoi à Turin
La colline de M. Andreoli, de jour... ph Gabriele Mina
Dimanche 16 décembre 13h30 - 17h30
- Un « facteur Cheval » en Sardaigne (Fellicu Fadda) de Giuseppe Trudu, 2004, 47’.
En présence du réalisateur
- Un sculpteur de l’île aux ânes blancs (Enrico Mereu) de Giuseppe Trudu, 2009, 38’.
En présence du réalisateur
- Melina Riccio de Gustavo Giacosa, 2009, 10’. En présence du réalisateur
- Eugenio Santoro de Dominique Clément, Chantal Woodtli, 1994, 12’. (A signaler que ce film est édité dans le DVD intitulé "Art Brut" avec deux autres courts, un consacré à Ni-Tanjung par Erika Mannoni et un autre de la même Mannoni consacré à Lobanov; le film sur Santoro est plus précisément intitulé dans ce DVD "Les jardins de l'imaginaire" ; le tout est édité par la Collection de l'Art Brut et la Télévision Suisse)
- Antipasti (surprises à l’italienne) 45 ‘.
Suite de petits plats (films) divers et variés, exubérants, bigarrés, goûteux. (Dont paraît-il des films de Bernard Dattas sur des "choses" vues en Sardaigne)
Pour tout renseignement complémentaire, on peut contacter Denis Lavaud himself : 01 42 45 19 67/06 75 94 16 48.
*
A la Halle Saint-Pierre encore, le retour du "Petit Paris" de Marcel Dhièvre
Marcel Dhièvre est connu depuis les années 70 grâce au livre Les Inspirés du Bord des Routes de Jacques Lacarrière et Jacques Verroust où l'on peut voir cinq belles photos et un fragment de témoignage de Dhièvre. C'est peut-être grâce à ce livre que sa maison richement décorée de fresques et d'ornementations diverses peintes et parfois sculptées en relief parvint à être classée monument historique dès 1984 (né en 1898, il décéda en 1977).
Image récupérée sur le site d'une association qui défendait, notamment sur la toile, "le Petit-Paris", l'association Entre-Tenir ; l'affirmation "je ne suis pas un artiste" avait été très justement repérée par ce site web, avis aux "artificateurs"...
Il avait en effet réalisé une magnifique décoration naïve, brute, ou simplement populaire, sur les murs d'angle à l'extérieur de son magasin de vêtements (il était vendeur en confection dans la lingerie et les vêtements de travail) à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Il avait poussé le bouchon plus loin en peignant (ce n'était pas un mosaïste) les murs intérieurs de la petite bâtisse, mais aussi divers petits sujets, des animaux, des tableaux de fleurs, des paysages. C'était comme il le disait lui-même également un tour de force dans la mesure où, paralysé de la main droite, il avait dû tout faire de la main gauche.
Marcel Dhièvre, la façade d'"Au Petit Paris", vers 1976, ph Jacques Verroust
Il avait appelé cette maison "Au Petit Paris", car la ville-lumière, où il allait se fournir chaque semaine, l'avait charmé au point de le pousser à représenter dans des médaillons l'Arc de Triomphe sur sa façade, ainsi que la Tour Eiffel, la Madeleine, les quais de la Seine, et la nef symbole de la capitale. L'ensemble connut quelques vicissitudes pendant de nombreuses années. Diverses bonnes volontés tentaient régulièrement d'alerter l'opinion pour essayer de sauver une maison qui visiblement résistait dans le souvenir de la population de St-Dizier (cet attachement d'une ville populaire à un tel monument naïf est assez touchant je trouve). L'illustratrice Kathy Couprie racheta à un moment le magasin, y faisant quelques réparations, puis ce fut la mairie, sous l'impulsion d'un maire UMP, François Cornut-Gentille (comme l'a signalé entre autres un article paru cet été dans La Croix, dû à Aude Carasco), qui l'acquit dans les années 2000. Là aussi, comme dans le cas de Gabriel Albert en Charente-Maritime, on veut "valoriser", on parle d'installer dansle Petit Paris un "café associatif", et d'installer à côté l'atelier d'art-thérapie de l'hôpital psychiatrique voisin... Surtout, on a fait rénover, terme plus exact que "restaurer", les peintures intérieures et extérieures (on peut juger du résultat sur une galerie d'images mises en ligne sur Flickr par la mairie), les tableaux, les petits sujets divers et variés que la mairie a récupérés. Si l'on compare ces rénovations, dues à M. Renaud Dubrigny, un employé municipal à la peinture qui s'est passionné, nous dit-on pour ce travail de renaissance d'un chef-d'oeuvre populaire, aux photos du livre de Jacques Verroust, on pourrait dire que les couleurs de la rénovation sont un peu flashy, mais baste, on s'en contentera, car y avait-il moyen de faire mieux avec les subsides disponibles? On peut aussi s'en consoler en constatant que le restaurateur a remis les décors à l'identique, quant aux sujets représentés, du moins si l'on en juge à travers les informations de la presse et d'internet.
Deux tableaux de Marcel Dhièvre restaurés par la ville de St-Dizier
Simplement, il faut bien être conscient qu'un Marcel Dhièvre ne peut ressusciter, et que lon a désormais autre chose à la place de sa maison décorée de son vivant, comme le musée d'une inspiration, soit un beau paradoxe...
Enfin signalons qu'un livre vient de paraître qui traite de ce monument, celui de Henri-Pierre Jeudy, Le Naïf, le Brut, le Primitif, au Petit Paris, aux éditions Châtelet-Voltaire (basées dans la Haute-Marne). Il viendra en parler à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre samedi 1er décembre à 16h.
20:41 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel boudin, marie jakobowicz, jean estaque, guy girard, musée de la création franche, alexis lippstreu, madmusée, galerie christian berst, banditi dell'art, cinéma et arts populaires, mario andreoli, art brut italien, pierre-jean wurtz, denis lavaud, marcello cammi, environnements spontanés, au petit paris, marcel dhièvre |  Imprimer
Imprimer
18/11/2012
Merveille de l'art naïf anonyme, un dessin d'un(e?) certain J.A.B.
J.A.B, Liria (un prénom? Le nom d'une ville espagnole?... Mystère, mystère...), crayon sur papier, 42 x 30 cm, 1922, coll. Bruno Montpied
L'art naïf n'a plus le vent en poupe, paraît-il. Le goût nous en serait passé, répète-t-on à l'envi. L'art brut est passé par là, bien sûr, avec les oukases des Dubuffet et des Thévoz, à qui toutes sortes de nouveaux fans ont emboîté le pas comme un seul homme. Du coup, conséquence sympathique en dépit de son aspect paradoxal, la foule des emboîteurs de pas ne fraye plus par ces chemins, et surout pas du côté des Naïfs anonymes. Ils sont légion ces derniers. On ne sait rien d'eux, ils débarquent sur les brocantes et les vide-greniers sans autre lettre de créance que leur bonne mine, leur mine étrange qui leur fait comme un bouclier quasi surnaturel. C'est leur apparence seule qui les défend du vandalisme, de l'anéantissement. Preuve que l'anonymat n'est point si rédhibitoire... Et qu'au contraire, il accompagne presque à coup sûr une valeur intrinséque, qui se passe de tout qu'en dira-t-on, de toute rumeur ou réputation flatteuses. C'est ce que j'aime en lui, dans ces tableautins sans pedigree qui circulent entre collectionneurs, tous comme membres d'une société secrète d'admirateurs des beautés silencieuses de l'ombre.
On n'en parle pas assez de ces anonymes insolites, à la figuration onirique ou merveilleuse, parfois aussi adeptes d'une inquiétante étrangeté. Regardez la petite fille ci-dessus. Elle m'a regardé dans les yeux et je n'ai pu faire autrement que de l'acquérir, sans discuter. Elle serait peut-être d'origine espagnole, selon les mots du marchand qui la présentait sur son stand à la dernière Foire de la Bastille à Paris. Elle tient peut-être avant tout par sa robe, immense, à la géométrie rigoureuse, dessinée avec soin et méticulosité dirait-on presque. La moue aux coins des lèvres également nous retient. Le nœud au sommet de sa tête. Ses bottines petites et pointues, ses bras dissymétriques, et ce ballon au bout de son bras, protégé dans un filet comme une résille. En 1922, en Espagne, les filles jouaient donc aussi au ballon.
Simplement dessinée au bout d'un crayon au tracé poudreux, on eût pu la croire d'une éphémère existence, mais elle a résisté jusqu'ici au temps, mirage solide. Elle est d'une présence indiscutable, et j'oserais même dire qu'elle se pose là. Sans doute avant tout par la jeunesse de sa présence, captée peut-être plus aisément en raison de la jeunesse – peut-être! – de celui (ou de celle?) qui a signé au bas de l'oeuvre, modestement, de ses simples initiales, J.A.B., et dont l'histoire n'a pas retenu d'autre trace (si?)...
17:18 Publié dans Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin naïf, art naïf, art naïf anonyme, j.a.b., liria, foire de la bastille |  Imprimer
Imprimer
17/11/2012
Postérité des environnements (7): Gabriel Albert sous cloche?
Transmis par Patrick Métais, un article de Sud-Ouest m'apprend que le jardin de Gabriel Albert a reçu la visite de l'ineffable Ségolène Royal, la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, qui a fait part de son désir de valoriser et préserver le site et que sa région soit maître d'œuvre de ce point de vue. Il semblerait, à lire cet article, que l'Etat, via la DRAC, et la Région travailleraient sur un projet de valorisation culturelle et scientifique du jardin. On souhaiterait ainsi créer sur place un centre d'interprétation et un atelier de restauration des statues. Ces dernières sont on le sait passablement abîmées, tandis que plusieurs ont disparu, victimes de voleurs.
Le jardin de Gabriel Albert (que l'on voit coiffé d'une casquette au fond devant le moulin), avec Christine Bruces-Cerisier, Anita Albert, Jean-Louis Cerisier, le jour où nous visitâmes les Albert en 1988, ph. Bruno Montpied
Il paraît que l'on songe même à mettre l'ensemble du site dans une serre... Alors Gabriel, bientôt comme le fromage, sous cloche? Cela illustre bien les conséquences de la reprise en main d'un site d'art populaire par une instance conservatrice. Avec la perspective de le faire entrer dans la postérité et de l'installer dans une certaine pérennité, le site se métamorphose en autre chose, de plus pétrifié. Un comble pour un jardin de statues en ciment armé... Du coup, par contraste avec ce qui risque d'advenir quand on l'aura réifié sous un dôme (comme chez Euclides da Costa Ferreira), ce ciment reviendra dans nos souvenirs, à l'époque où son auteur était encore vivant, moins solide, presque palpitant.
Mais l'on dira bien sûr, en chœur, "c'est mieux que rien..." Ah, mais je m'interroge décidément sur ce "rien". Pas sûr, pas sûr... Mais, bon, on pourrait dire aussi, un jardin, ça peut se mettre sous serre, argument habile...
La Maison Bleue d'Euclides da Costa Ferreira à Dives-sur-Mer, vue de la rue, état en juillet 2012 (le site fut recouvert d'un dôme en urgence, avec les moyens du bord, dans l'idée de le mettre hors d'eau, mais la situation perdure... Peut-être faut-il voir dans ce sarcophage plus ou moins translucide comme la métaphore d'une chrysalide dans laquelle une mue s'opère, prélude à l'essor d'un futur nouveau papillon?), ph BM
00:27 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gabriel albert, région poitou-charentes, conservation des environnements spontanés, jardin de gabriel albert, les amis du jardin de gabriel, sculpture naïve, maison bleue, habitants-paysagistes, environnements spontanés, inspirés du bord des routes |  Imprimer
Imprimer
11/11/2012
Couleau subtil
Il n'y a pas grand chose à dire du sieur Couleau que Gilles Manero et Anne Billon ont découvert récemment sur une brocante de l'Entre-Deux-Mers... On ne sait pas ce qu'il faisait dans la vie, juste qu'il lui est arrivé de tailler le bois d'une manière qui pourrait le faire classer dans un art populaire moderne. A quelle époque? Au XXe siècle sûrement peut-être dans les années 60-70, parce qu'il a représenté un De Gaulle (que j'aimerais bien voir, Gilles et Anne sont arrivés trop tard, donc, si l'acheteur lit internet, qu'il nous le dise...), mais bien entendu c'est une hypothèse assez aventurée.
Couleau, Philippe le Hardi, h. 30 cm env., bois sculpté, coll. Bruno Montpied, ph. Gilles Manero
Il aimait les sujets historiques en tout cas, comme on le voit avec le roi ci-dessus, qu'une inscription à moitié effacée sous la statuette désigne au crayon comme "Philippe le Hardi" (c'est Anne qui l'a vue, félicitations). Il y eut deux Philippe Le Hardi dont l'un au XIVe siècle fut duc de Bourgogne, peut-être plus célèbre que l'autre (l'autre vécut au XIIIe, fut roi de France sous le nom de Philippe III et se fit connaître pour avoir cédé l'Agenais au Roi d'Angleterre de l'époque, ce qui le désigne peut-être comme celui que Couleau a représenté, car ce dernier paraît originaire de la région de Marmande, après avoir vécu à Bergerac aussi). Notre hardi qui porte couronne (ce qui renforce peut-être l'hypothèse qu'il s'agit du roi du XIIIe siècle que du duc de Bourgogne) tenait peut-ête un sceptre à la main droite, mais il en a été visiblement dépossédé dans la suite des temps... Jolie tête en tout cas, bien enfantine, stylisée d'une manière qui lui confère une sorte de signature à la longue attachante.
Couleau, Vierge à l'enfant, bois sculpté, coll Manero/Billon, ph. GM
Couleau, gaveuse d'oie (semble-t-il, à moins qu'elle ne se cramponne à sa bouteille), coll. Manero/Billon, ph.GM
On retrouve la même expression aux limites de l'archaïsme des têtes de marionnettes sur les autres statuettes chinées par Manero et Billon. Que l'on ait affaire à une Madone à l'enfant Jésus ou à une gaveuse d'oie. C'est une bien belle sauvegarde qu'ont opérée là Anne et Gilles en tout cas. Si des lecteurs reconnaissent l'auteur ou ont des informations à nous communiquer, qu'ils ne se gênent surtout pas, nous sommes preneurs. A la poursuite de Couleau...
Couleau, femme (?) au tablier, tentant de lancer la mode des uniques poches gigantesques triangulaires, coll Manero/Billon, ph.GM
18:40 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : couleau, gilles manero, anne billon, philippe le hardi, art populaire contemporain, art immédiat, sculpture naïve |  Imprimer
Imprimer
09/11/2012
Arnaud Mahuas, dit "Darnish", colleur et architecte d'images
On parle d'art nahuatl mais on ne parle pas d'art mahuas. Et pourtant la tribu existe, résumée à un seul individu, le surnommé Darnish, actif dans le secret d'une grande ville du Far West breton, j'ai nommé Rennes. Ce drôle de Peau-Rouge, natif de Vannes en 1973, ayant grandi à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan, travaille bien caché de la circulation, loin des FRAC et autres autoroutes de l'art contemporain, porté par un goût de créer qui visiblement l'occupe comme nous habite le principe germinatif responsable de la pousse de nos cheveux ou de nos ongles. Cela sort de lui comme l'eau du robinet qu'il a choisi depuis l'âge de 12 ans de laisser ouvert.
 Collages, architectures miniatures et légères faites d'assemblages de minuscules baguettes de bois récupérées, ruines et brisures d'images logées au fond de bouteilles tels des ex-voto profanes, lavis visionnaires où des silhouettes infimes, collées dans un coin, donnent aux étendues d'encre, abstraites en apparence, la force de s'imposer du seul fait de ces présences dans un coin de la feuille comme des paysages concrets tout au contraire, disques de bois aux compositions savantes, très constructivistes russes du début du siècle précédent, des gravures enfin, ultra stylisées, bricolées dans sa cuisine puis pressées en atelier, tout cela est charrié par Darnish avec un égal bonheur.
Collages, architectures miniatures et légères faites d'assemblages de minuscules baguettes de bois récupérées, ruines et brisures d'images logées au fond de bouteilles tels des ex-voto profanes, lavis visionnaires où des silhouettes infimes, collées dans un coin, donnent aux étendues d'encre, abstraites en apparence, la force de s'imposer du seul fait de ces présences dans un coin de la feuille comme des paysages concrets tout au contraire, disques de bois aux compositions savantes, très constructivistes russes du début du siècle précédent, des gravures enfin, ultra stylisées, bricolées dans sa cuisine puis pressées en atelier, tout cela est charrié par Darnish avec un égal bonheur.
Sans titre, paysage avec couple, collage et lavis, vers 2012, 44 x 30 cm
Sans titre, collages et bois insérés dans une bouteille, env. 15 cm, vers 2011
Sans titre, collage et bois dans une bouteille, env. 10 cm, vers 2012
Sans titre, deux autres bouteilles... env 20 cm
Il y a du Schwitters aussi dans ce Darnish, surtout dans ses bouteilles (anciens échos des bouteilles où les marins glissaient des bateaux, du reste Darnish a aussi fait des bateaux, mais dans son système cela devient des bateaux-visages de femmes) où il insère des ruines, ou des amas de débris frêles qui me font penser aux "misérables petits tas de secrets" que cachent paraît-il les hommes (qui a écrit cela? Je sens que l'Aigre de Meaux va nous le rappeler...). C'est comme si on avait mis le Merzbau en bouteille.
Sans titre, une des pièces de la série des bateaux à visage, env. 40 cm de long, vers 2011 ?
Mais ces récipients ne peuvent à eux seuls permettre une telle contention, Darnish dresse vers le ciel ce qu'il fait de meilleur à mon goût, des architectures fragiles où des images, empruntées aux chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art comme aux icônes du cinéma dont il est tout autant féru, se retrouvent mêlées dans ces tours de Babel mémorielles où elles prennent figure de kaléidoscopes de souvenirs en miettes échafaudées en désespoir de cause vers les nuages...
Des galeries et autres espaces d'exposition vouées à la promotion de ce qui se fait de mieux dans la création contemporaine feraient bien de s'intéresser d'un peu plus prés à ce jeune homme très sincèrement inspiré. Non?
09:48 Publié dans Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : darnish, architecture, kurt schwitters, merzbau, objets en bouteilles, collages, art singulier, assemblages, tours de babel |  Imprimer
Imprimer